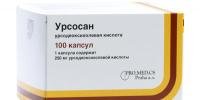Troisième paire de nerfs crâniens. Nerfs crâniens. Branches des nerfs vagues
Nerf olfactif (n. olfactif).
Les cellules des récepteurs olfactifs sont dispersées dans l'épithélium de la membrane muqueuse de la région olfactive de la cavité nasale. Les fines apophyses centrales de ces cellules sont rassemblées dans des filaments olfactifs, qui constituent le nerf olfactif lui-même. Depuis la cavité nasale, le nerf pénètre dans la cavité crânienne par les ouvertures de l'os ethmoïde et se termine dans le bulbe olfactif. À partir des cellules du bulbe olfactif, les voies olfactives centrales commencent jusqu'à la zone corticale de l'analyseur olfactif dans le lobe temporal du cerveau.
La perte bilatérale complète de l'odorat (anosmie) ou sa diminution (hyposmie) est souvent la conséquence d'une maladie du nez ou est congénitale (parfois dans ce cas associée à certains Troubles endocriniens). Les troubles unilatéraux de l'odorat sont principalement associés à un processus pathologique dans la partie antérieure fosse crânienne(tumeur, hématome, traumatisme crânien, etc.). Des sensations olfactives paroxystiques inhabituelles (parosmie), souvent une vague odeur désagréable, sont annonciatrices d'une crise d'épilepsie provoquée par une irritation du lobe temporal du cerveau. L'irritation du lobe temporal du cerveau peut provoquer diverses hallucinations olfactives.
Méthodologie de recherche. L'étude de l'odorat est réalisée à l'aide d'un ensemble particulier de substances aromatiques (camphre, menthe, valériane, extrait de pin, huile d'eucalyptus). Le sujet, les yeux fermés et la moitié du nez pincé, se voit présenter des substances odorantes et lui demande de dire quelle odeur il sent et s'il perçoit également bien les odeurs dans chaque narine séparément. N'utilisez pas de substances à forte odeur (ammoniac, acide acétique), car dans ce cas, une irritation des terminaisons du nerf trijumeau se produit, de sorte que les résultats de l'étude seront inexacts.
Symptômes de la lésion. Ils varient en fonction du niveau d'atteinte du nerf olfactif. Les principaux sont la perte de l'odorat - anosmie, la diminution de l'odorat - hyposmie, l'augmentation de l'odorat - hyperosmie, la perversion de l'odorat - dysosmie, hallucinations olfactives. Pour la clinique, une diminution ou une perte unilatérale de l'odorat est particulièrement importante, car L'hypo- ou l'anosmie bilatérale est causée par des symptômes de rhinite aiguë ou chronique.
L'hypoosmie ou anosmie survient lorsque les voies olfactives jusqu'au triangle olfactif sont affectées, c'est-à-dire au niveau du premier et du deuxième neurones. Étant donné que les troisièmes neurones ont une représentation corticale à la fois sur leur propre côté et sur leur côté opposé, les dommages au cortex dans le champ de projection olfactive n'entraînent pas de perte d'odorat. Cependant, en cas d'irritation du cortex de cette zone, des sensations d'odeurs inexistantes peuvent survenir.
La proximité des filaments olfactifs, du bulbe olfactif et des voies olfactives avec la base du crâne conduit au fait que lors des processus pathologiques à la base du crâne et du cerveau, l'odorat est également altéré.
Nerf optique (n. optique).
Il est formé par les axones des neurones de la couche ganglionnaire de la rétine, qui, à travers la plaque criblée de la sclère, sortent du globe oculaire par un seul tronc du nerf optique dans la cavité crânienne. À la base du cerveau, au niveau de la selle turcique, les fibres des nerfs optiques convergent des deux côtés, formant le chiasma optique et les voies optiques. Ces derniers continuent vers le corps géniculé externe et le coussin thalamique, puis la voie visuelle centrale va vers le cortex cérébral (lobe occipital). Une décussation incomplète des fibres des nerfs optiques provoque la présence dans le tractus optique droit de fibres provenant des moitiés droites et dans le tractus optique gauche - des moitiés gauches de la rétine des deux yeux.
Symptômes de la lésion .
Lorsque la conduction du nerf optique est complètement interrompue, la cécité survient du côté de la lésion avec perte de la réaction directe de la pupille à la lumière. Lorsque seule une partie des fibres du nerf optique est endommagée, perte focale champs de vision (scotomes). À destruction complète La cécité bilatérale se développe à partir du chiasma. Cependant, dans de nombreux processus intracrâniens, les dommages au chiasma peuvent être partiels - une perte des moitiés externe ou interne du champ visuel se développe (hémianopsie hétéronyme). Avec dommages unilatéraux aux voies optiques et sus-jacents parcours visuels une perte unilatérale des champs visuels du côté opposé se produit (hémianopsie homonyme).
Les dommages au nerf optique peuvent être de nature inflammatoire, congestive et dystrophique ; détecté par ophtalmoscopie. Les causes de la névrite optique peuvent être la méningite, l'encéphalite, l'arachnoïdite, la sclérose en plaques, la grippe, l'inflammation des sinus paranasaux, etc. Elles se manifestent par une diminution de l'acuité et un rétrécissement du champ de vision, qui n'est pas corrigé par l'utilisation de lunettes. Une papille du nerf optique congestionnée est le symptôme d’une augmentation de la pression intracrânienne ou d’une altération du débit veineux de l’orbite. À mesure que la congestion progresse, l’acuité visuelle diminue et la cécité peut survenir. L'atrophie du nerf optique peut être primaire (avec tabes dorsalis, sclérose en plaques, lésion du nerf optique) ou secondaire (à la suite d'une névrite ou d'un mamelon congestif) ; Il existe une forte diminution de l'acuité visuelle pouvant aller jusqu'à la cécité complète et un rétrécissement du champ de vision.
Fond d'œil– partie de la surface interne du globe oculaire visible lors de l’examen ophtalmoscopique (disque optique, rétine et choroïde). Le disque optique se détache sur le fond rouge du fond d'œil comme une formation arrondie avec des limites claires et une couleur rose pâle. Dans le pôle postérieur de l'œil se trouve la zone la plus sensible de la rétine - ce qu'on appelle la macula macula, qui a la forme d'un ovale horizontal de teinte jaunâtre. La macula est constituée de cônes qui assurent la vision diurne et participent à la perception précise de la forme, de la couleur et des détails d'un objet. À mesure qu’on s’éloigne de la macula, le nombre de cônes diminue et le nombre de bâtonnets augmente. Les tiges ont une très grande sensibilité à la lumière et permettent la perception des objets au crépuscule ou la nuit.
Méthodologie de recherche. Découvrez s'il y a des plaintes concernant une diminution de l'acuité visuelle, une perte du champ visuel, l'apparition d'étincelles, de taches brunes, de mouches, etc. devant les yeux.
L'acuité visuelle est examinée à l'aide de tableaux spéciaux sur lesquels les lettres sont représentées en rangées. De plus, chaque rangée du bas est plus petite que la précédente. Sur le côté de chaque rangée se trouve un numéro indiquant à quelle distance les lettres de cette rangée doivent être lues avec une acuité visuelle normale.
Les champs visuels sont examinés à l'aide du périmètre. Il est souvent nécessaire d’utiliser une méthode approximative pour mesurer les champs visuels. Pour ce faire, une personne s'assoit dos à la source lumineuse, ferme un œil, mais sans appuyer sur le globe oculaire. L'examinateur s'assoit devant le patient, demande au patient de fixer son regard sur un point devant lui, déplace le marteau de l'oreille du patient en cercle jusqu'à l'arête du nez et demande au patient de lui dire quand il le voit. Le champ de vision externe est généralement de 90 degrés. Les champs visuels interne, supérieur et inférieur sont examinés de la même manière et sont à 60, 60, 70 degrés. respectivement.
La perception des couleurs est étudiée à l'aide de tableaux polychromatiques spéciaux, sur lesquels des nombres, des chiffres, etc. sont représentés par des taches de différentes couleurs.
Le fond d'œil est examiné à l'aide d'un ophtalmoscope et d'un photoophtalmoscope, qui permettent d'obtenir des photographies en noir et blanc et en couleur du fond d'œil.
Nerf oculomoteur. ( n. oculomoteur).
Innerve les muscles externes de l'œil (à l'exception du droit externe et de l'oblique supérieur), le muscle qui soulève la paupière supérieure, le muscle qui contracte la pupille, le muscle ciliaire, qui régule la configuration du cristallin, qui permet la œil pour s’adapter à la vision de près et de loin.
La paire du système III se compose de deux neurones. Le centre est représenté par les cellules du cortex du gyrus précentral, dont les axones, faisant partie du tractus corticonucléaire, se rapprochent des noyaux du nerf oculomoteur à la fois de leur propre côté et du côté opposé.
Une grande variété de fonctions remplies par la troisième paire sont réalisées à l'aide de 5 noyaux pour l'innervation des yeux droit et gauche. Ils sont situés dans les pédoncules cérébraux au niveau des collicules supérieurs du toit du mésencéphale et sont des neurones périphériques du nerf oculomoteur. A partir des deux noyaux magnocellulaires, les fibres vont d'elles-mêmes vers les muscles externes de l'œil et partiellement vers le côté opposé. Les fibres innervant le muscle qui soulève la paupière supérieure proviennent du noyau du même côté opposé. À partir de deux noyaux accessoires de petites cellules fibres parasympathiques sont dirigés vers le muscle qui contracte la pupille, seuls et du côté opposé. Cela garantit une réaction amicale des pupilles à la lumière, ainsi qu'une réaction de convergence : constriction de la pupille tout en contractant simultanément les lignes droites. muscles internes les deux yeux. À partir du noyau central postérieur non apparié, également parasympathique, les fibres sont dirigées vers muscle ciliaire, régulant le degré de convexité de la lentille. Lorsque l'on regarde des objets situés près de l'œil, la convexité du cristallin augmente et en même temps la pupille se rétrécit, ce qui assure une image claire sur la rétine. Si l'accommodation est altérée, une personne perd la capacité de voir les contours clairs des objets à différentes distances de l'œil.
Les fibres du motoneurone périphérique du nerf oculomoteur partent des cellules des noyaux ci-dessus et émergent des pédoncules cérébraux sur leur face médiale, puis percent la dure-mère puis se poursuivent dans la paroi externe du sinus caverneux. Du crâne, le nerf oculomoteur sort par la fissure orbitaire supérieure et entre dans l’orbite.
Symptômes de défaite.
La violation de l'innervation de certains muscles externes de l'œil est causée par des lésions de l'une ou l'autre partie du noyau magnocellulaire ; la paralysie de tous les muscles de l'œil est associée à des lésions du tronc nerveux lui-même. Un signe clinique important qui permet de distinguer les lésions du noyau et du nerf lui-même est l'état d'innervation du muscle qui soulève la paupière supérieure et du muscle droit interne de l'œil. Les cellules à partir desquelles les fibres vont au muscle qui soulève la paupière supérieure sont situées plus profondément que le reste des cellules du noyau, et les fibres allant à ce muscle dans le nerf lui-même sont situées le plus superficiellement. Les fibres innervant le muscle droit interne de l’œil cheminent dans le tronc du nerf opposé. Ainsi, lorsque le tronc du nerf oculomoteur est endommagé, les premières à être touchées sont les fibres innervant le muscle qui soulève la paupière supérieure. Une faiblesse de ce muscle ou une paralysie complète se développe et le patient ne peut ouvrir l'œil que partiellement ou ne pas l'ouvrir du tout. En cas de lésion nucléaire, le muscle qui soulève la paupière supérieure est l'un des derniers à être touché. Lorsque le noyau est touché, « le drame se termine avec la chute du rideau ». En cas de lésion nucléaire, tous les muscles externes du côté atteint sont touchés, à l'exception du muscle droit interne, qui est isolé de manière isolée du côté opposé. En conséquence, le globe oculaire du côté opposé sera tourné vers l'extérieur en raison du muscle droit externe de l'œil - le strabisme divergent. Si seul le noyau magnocellulaire est touché, les muscles externes de l'œil sont touchés - ophtalmoplégie externe. Parce que lorsque le noyau est endommagé, le processus est localisé dans le pédoncule cérébral, et il est souvent impliqué dans le processus pathologique chemin de la pyramide et les fibres du tractus spinothalamique, un syndrome de Weber alterné apparaît, c'est-à-dire lésion de la troisième paire d'un côté et hémiplégie du côté opposé.
Il existe 13 paires de nerfs crâniens : 0 paire - nerf terminal, n. terminalis; je- olfactif, n. olfactif; II- visuel, n.optique; III - oculomoteur, n.oculomoteur; IV- bloc, n.trochléaire; V - trijumeau, n.trijumeau; VI - kidnappé, n. abducens; VII - soin du visage, n. facialis; Vjjj - vestibulocochléaire, n. vestibulocochléaris ; IX - glossopharyngé, n. glossofaryngeus; X - errant, n. vague; XI - supplémentaire, n. accessoire; XII - sublingual, n. hypoglosse.
DÉVELOPPEMENT ET PRINCIPES DE STRUCTURE DES NERFS CRANIENS
Les nerfs olfactifs et optiques sont des nerfs spécifiques des organes sensoriels qui se développent à partir du cerveau antérieur et en sont les excroissances. Les nerfs crâniens restants se différencient des nerfs spinaux et ont donc une structure fondamentalement similaire à celle-ci. Différenciation et transformation du primaire nerfs spinaux dans la région crânienne sont associés au développement des organes sensoriels et des arcs branchiaux avec leurs muscles associés, ainsi qu'à la réduction des myotomes dans la région de la tête (Fig. 227). Cependant, aucun des nerfs crâniens ne correspond complètement aux nerfs spinaux, puisqu'ils ne sont pas composés de racines antérieures et postérieures, mais seulement d'une seule antérieure ou postérieure. Les nerfs crâniens jjj, jV, Vj correspondent aux racines antérieures. Leurs noyaux sont situés ventralement, ils innervent les muscles développés à partir des 3 somites antérieurs de la tête. Les racines antérieures restantes sont réduites.
D'autres nerfs crâniens : V, Vjj, Vjjj, X, Xj et Xjj peuvent être considérés comme des homologues des racines dorsales. Ces nerfs sont associés à des muscles différenciés des muscles de l'appareil branchial et développés à partir des plaques latérales du mésoderme. Les nerfs forment deux branches : antérieure et postérieure. Chez les vertébrés supérieurs, la branche postérieure est généralement réduite.
Riz. 227. Nerfs crâniens d'un embryon humain.
Les arcs branchiaux sont marqués chiffres arabes, nerfs - Romain.
Certains nerfs crâniens (X, Xjj) ont une origine complexe, car ils sont formés par la fusion de plusieurs nerfs spinaux. En raison de l'assimilation des métamères du corps par la région occipitale de la tête, une partie des nerfs spinaux se déplace crâniennement et pénètre dans la région de la moelle allongée. Les nerfs crâniens jX et Xj se sont développés à partir d'une source commune - le nerf vague primaire et sont pour ainsi dire ses branches (Tableau 14).
Tableau 14. Corrélation des somites de la tête, des arcs branchiaux et des nerfs crâniens avec leurs racines


Riz. 228. Connexions des paires de nerfs crâniens IX, X et XI.
1 - fosse en forme de losange ; 2 - moelle épinière ; 3 - branches du nœud inférieur du nerf vague au tronc sympathique ; 4 - nerf laryngé supérieur ; 5 - nœud inférieur du nerf vague ; 6 - branche extérieure nerf accessoire; 7 - branche interne du nerf accessoire ; 8 - nœud supérieur du nerf vague ; 9 - nœud inférieur nerf glossopharyngé; 10 - longue branche du nerf vague ; 11 - nœud supérieur du nerf glossopharyngé ; 12 - racines crâniennes du nerf accessoire ; 13 - nerf vague; 14 - nerf glossopharyngé.
Les nerfs crâniens sont fonctionnellement répartis comme suit. Les nerfs somatiques sensibles comprennent les paires I, II, VIII, les nerfs somatiques-moteurs - les paires III, IV, VI, XI, XII, les nerfs mixtes contenant des fibres somatiques-motrices et viscérales sensibles (VII, IX, X paires) , ainsi que les fibres motrices viscérales - paires V, VII, IX, X.
Les paires V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII sont associées au rhombencéphale ; avec le mésencéphale - paires jjj et jV ; avec les paires intermédiaires - j et II de nerfs crâniens (Fig. 228).
0 PAIRE - NERFS TERMINAUX
Nerf terminal (0 paire), n. terminalis- Il s'agit d'une paire de petits nerfs étroitement adjacents aux nerfs olfactifs. Pour la première fois, ils étaient
trouvé chez les vertébrés inférieurs, mais leur présence a été démontrée chez les fœtus humains et chez les humains adultes. Ils contiennent de nombreuses fibres non myélinisées et de petits groupes associés de cellules nerveuses bipolaires et multipolaires. Chaque nerf passe le long de la face médiale du tractus olfactif, leurs branches percent la plaque criblée de l'os ethmoïde et se ramifient dans la membrane muqueuse de la cavité nasale. Au centre, le nerf est connecté au cerveau près de l'espace perforé antérieur et de la région septale. Sa fonction est inconnue, mais on pense qu'elle est partie de la tête le système nerveux sympathique, qui s'étend jusqu'aux vaisseaux sanguins et aux glandes de la muqueuse nasale.
J'APPAIRE - NERFS OLactifs
Nerf olfactifn. olfactif, formé de 15 à 20 filaments olfactifs, fila olfactive, qui sont constitués de fibres nerveuses - processus de cellules olfactives situées dans la membrane muqueuse de la partie supérieure de la cavité nasale. Les filaments olfactifs pénètrent dans la cavité crânienne par un trou dans la plaque criblée et se terminent au niveau des bulbes olfactifs, qui se poursuivent dans le tractus olfactif, tractus olfactif(voir p. 650).
II PAIRE - NERFS OPTIQUES
nerf optique,n.optique, se compose de fibres nerveuses formées par des processus de cellules nerveuses multipolaires rétine globe oculaire. Le nerf optique se forme sur l'hémisphère postérieur du globe oculaire et traverse l'orbite jusqu'au canal optique, d'où il sort dans la cavité crânienne. Ici, dans le sillon préchisal, les deux nerfs optiques se connectent pour former le chiasma optique, chiasma optique. Le prolongement des voies visuelles s'appelle le tractus optique, tractus optique. Au niveau du chiasma optique, le groupe médial de fibres nerveuses de chaque nerf passe dans le tractus optique du côté opposé et le groupe latéral continue dans le tractus optique correspondant. Les voies visuelles atteignent les centres visuels sous-corticaux.
III PAIRE - NERFS Oculomoteurs
nerf oculomoteur,n. oculomoteur, principalement moteur, se produit dans le noyau moteur, noyau n.oculomotorius, moyen-

Riz. 229. Nerfs de l'orbite ; vue de côté.
1 - nerf oculomoteur ; 2 - nerf abducens ; 3, 9 - nerf maxillaire ; 4 - branche supérieure du nerf oculomoteur ; 5 - nerf nasociliaire ; 6 - nerf frontal ; 7 - nerf mandibulaire ; 8 - nerf optique; 10 - nœud ptérygopalatin ; 11 - nœud ciliaire ; 12 - branche inférieure du nerf oculomoteur ; 13 - nerfs ciliaires courts ; 14 - nerf sous-orbitaire.
du cerveau et du noyau accessoire parasympathique, noyau accessoire. Il sort à la base du cerveau au bord médial du pédoncule cérébral et avance dans la paroi supérieure du sinus caverneux jusqu'à la fissure orbitaire supérieure, par laquelle il entre dans l'orbite et se divise en branche supérieure, r. supérieur, - au muscle droit supérieur et au muscle qui soulève la paupière, et à la branche inférieure, r. inférieur, - aux muscles droits médial et inférieur et aux muscles obliques inférieurs. Une branche part de la branche inférieure vers le ganglion ciliaire, qui est sa racine parasympathique (Fig. 229).
PAIRE IV - NERFS TROCLOCK
nerf trochléaire,n. trochléaire, moteur, prend naissance dans le noyau moteur, noyau n. trochléaire, situé dans le mésencéphale au niveau du colliculus inférieur. Il s'étend jusqu'à la base du cerveau vers l'extérieur à partir du pont et continue vers l'avant dans la paroi externe du caverneux.

Riz. 230. Nerf trijumeau.
1 - nœud trijumeau ; 2 - nerf optique ; 3 - nerf maxillaire ; 4 - nerf mandibulaire ; 5 - bas du ventricule JV ; 6 - nerf lingual ; 7 - nerfs des muscles masticateurs.
le sinus. Il pénètre dans l'orbite par la fissure orbitaire supérieure et se ramifie dans le muscle oblique supérieur.
PAIRE V - NERFS TRIJUMEAU
Nerf trijumeau,n. trijumeau, est mixte et contient des fibres nerveuses motrices et sensorielles. Innerve les muscles de la mastication, la peau du visage et la partie antérieure de la tête, coquille dure cerveau, ainsi que les muqueuses des voies nasales et cavité buccale, dents.
Le nerf trijumeau a structure complexe. On distingue : 1) les noyaux (1 moteur et 3 sensibles) ; 2) racines sensorielles et motrices ; 3) ganglion trijumeau sur la racine sensible ; 4) tronc du nerf trijumeau ; 5) 3 branches principales du nerf trijumeau : ophtalmique, maxillaire Et nerfs mandibulaires(Fig. 230).
Les cellules nerveuses sensibles, dont les neurites forment les branches sensorielles du nerf trijumeau, sont situées dans le ganglion trijumeau, ganglion trijumeau. Le ganglion du trijumeau repose sur la dépression du trijumeau, impression trijumeau, la face antérieure de la pyramide de l'os temporal dans la cavité trijumeau, le creux trijumeau, formé par la division de la dure-mère. Le nœud est plat, de forme semi-lunaire, de 14 à 29 mm de long et de 5 à 10 mm de haut. Chez les personnes ayant un crâne brachycéphale, il est court et haut, tandis que chez les dolichocéphales, il est long et bas.
Les cellules du ganglion trijumeau sont pseudounipolaires et dégagent un processus qui, à proximité du corps cellulaire, est divisé en deux : central et périphérique. Forme des neurites centraux racine sensible,la base sensorielle, et à travers lui, ils pénètrent dans le tronc cérébral, atteignant les noyaux sensoriels du nerf : noyau de pont,noyau pontin n. trijumeaux, dans le pont spinal(noyau inférieur du nerf trijumeau), noyau spinal (inférieur) n. trijumeaux, - dans la partie inférieure du pont médullaire et dans la moelle oblongate, ainsi que noyaux du tractus mésencéphale,noyau mesencéphalique n. trijumeaux, - dans le mésencéphale. Les dendrites périphériques font partie des branches principales répertoriées du nerf trijumeau.
Les fibres nerveuses motrices proviennent noyau moteur du nerfnoyau moteur n. trijumeaux, couché à l'arrière du pont. Ces fibres quittent le cerveau et forment racine du moteur,base motrice. L'endroit où la racine motrice sort du cerveau et l'entrée sensorielle est situé à la transition du pont vers le pédoncule cérébelleux moyen. Entre les racines sensorielles et motrices du nerf trijumeau se trouvent souvent (dans 25 % des cas) des connexions anastomotiques, à la suite desquelles un certain nombre de fibres nerveuses passent d'une racine à l'autre.
Le diamètre de la racine sensorielle est de 2,0 à 2,8 mm, elle contient de 75 000 à 150 000 fibres nerveuses myélinisées d'un diamètre allant principalement jusqu'à 5 microns. L'épaisseur de la racine du moteur est inférieure à 0,8-1,4 mm. Il contient de 6 000 à 15 000 fibres nerveuses myélinisées d'un diamètre généralement supérieur à 5 microns.
La racine sensorielle avec son ganglion trijumeau et la racine motrice constituent ensemble le tronc du nerf trijumeau d'un diamètre de 2,3 à 3,1 mm, contenant de 80 000 à 165 000 fibres nerveuses myélinisées. Racine du moteur
traverse le ganglion trijumeau et devient une partie du nerf mandibulaire.
Les ganglions nerveux parasympathiques sont reliés aux 3 branches principales du nerf trijumeau : le ganglion ciliaire - avec le nerf ophtalmique, le ganglion ptérygopalatin - avec le nerf maxillaire, les ganglions auriculaires et sous-mandibulaires - avec les nerfs mandibulaires.
Le plan général de ramification des branches ophtalmiques du nerf trijumeau est le suivant : chaque nerf (ophtalmique, maxillaire et mandibulaire) dégage une branche vers la dure-mère ; branches internes à la membrane muqueuse des sinus accessoires, des cavités et organes buccaux et nasaux (glande lacrymale, globe oculaire, glandes salivaires, dents) ; branches externes : médiale - à la peau des zones antérieures du visage et latérale - à la peau des zones latérales du visage.
NERF OPHIQUE
nerf optique,n. ophtalmique, est la première branche la plus fine du nerf trijumeau. Fonctionnellement, le nerf est principalement sensoriel. Il innerve la peau du front et la partie antérieure des régions temporale et pariétale, la paupière supérieure, l'arrière du nez, ainsi que partiellement la muqueuse de la cavité nasale, les membranes du globe oculaire et la glande lacrymale ( Figure 231).
Le nerf a une épaisseur de 2 à 3 mm, est constitué de 30 à 70 faisceaux relativement petits et contient de 20 000 à 54 000 fibres nerveuses myélinisées, pour la plupart de petit diamètre (jusqu'à 5 microns). En partant du ganglion trijumeau, le nerf traverse la paroi externe du sinus caverneux, où il libère de fines branches vers les nerfs oculomoteur, trochléaire et abducens, la branche tentoire, r. tentoireà la tente du cervelet et reçoit plusieurs branches du plexus carotide interne. Près de la fissure orbitaire supérieure, le nerf optique est divisé en 3 branches : les nerfs lacrymal, frontal et nasociliaire (Fig. 232).
1. nerf lacrymal,n. lacrymal, situé près de la paroi extérieure de l'orbite, où il se connecte branche de connexion avec nerf zygomatique, r. communicans cum n.zygomatico. Innerve la glande lacrymale, ainsi que la peau de la paupière supérieure et du canthus latéral.
2. nerf frontal,n. frontalis, - la branche la plus épaisse du nerf optique. Il passe sous la paroi supérieure de l'orbite et se divise en deux branches : nerf supraorbitaire,n. supraorbital, passant par l'encoche supra-orbitaire jusqu'à la peau du front, et nerf supratrochléaire,n. supratrochléaire, sortir-

Riz. 231. Nerf ophtalmique.
provenant de l'orbite au niveau de sa paroi interne et innervant la peau de la paupière supérieure et du coin médial de l'œil.
3. Nerf nasociliaire,n. nasociliaris, se situe dans l'orbite au niveau de sa paroi médiale et, sous le bloc du muscle oblique supérieur, quitte l'orbite sous la forme d'une branche terminale - la sous-trochléaire nerf,n. infratrochléaire, qui innerve sac lacrymal, la conjonctive et le coin médial de l'œil. Sur toute sa longueur, le nerf nasociliaire dégage les branches suivantes : 1) longs nerfs ciliaires, pp. cils longs, au globe oculaire; 2) nerf ethmoïdal postérieur, n. ethmoidalis postérieur,à la membrane muqueuse du sinus sphénoïdal et aux cellules postérieures du labyrinthe ethmoïdal ; 3) nerf ethmoïdal antérieur, n. ethmoidalis antérieur,à la membrane muqueuse du sinus frontal et de la cavité nasale (rr. nasales medialis et lateralis) et sur la peau de la pointe et de l'aile du nez. De plus, une branche de connexion part du nerf nasociliaire vers le ganglion ciliaire.
noeud ciliaire,ganglion ciliaire(Fig. 233), mesurant jusqu'à 2 mm de long, se trouve sur la face latérale du nerf optique, approximativement à la frontière entre la partie postérieure et la partie postérieure du nerf optique. tiers médians longueur de l'orbite. Dans le ganglion ciliaire, comme dans d'autres ganglions parasympathiques du nerf trijumeau, il existe des cellules nerveuses parasympathiques multiprocessus (multipolaires), sur lesquelles les fibres préganglionnaires, formant des synapses, passent aux fibres postganglionnaires. Les fibres sympathiques et sensorielles traversent le nœud en transit.

Riz. 232. Nerfs de l'orbite ; vue d'en-haut.
1 - muscle qui soulève la paupière supérieure ; 2 - glande lacrymale; 3 - muscle droit supérieur ; 4 - nerf lacrymal ; 5 - muscle droit latéral ; 6 - fosse crânienne moyenne ; 7 - muscle temporal ; 8 - muscle ptérygoïdien latéral ; 9 - nerf mandibulaire ; 10 - nerf accessoire; 11 - nerf vague; 12 - nerf glossopharyngé; 13 - partie cochléaire du nerf vestibulocochléaire ; 14 - partie vestibulaire du nerf vestibulocochléaire ; 15 - nerf facial; 16 - nerf abducens; 17 - nerf trijumeau ; 18, 25 - nerf trochléaire ; 19 - nerf trijumeau ; 20 - nerf oculomoteur ; 21 - artère carotide interne ; 22 - nerf maxillaire ; 23 - nerf optique; 24 - nerf optique; 26 - muscle oblique supérieur ; 27 - plaque criblée ; 28 - nerf nasociliaire ; 29 - crête de coq; 30 - nerf supraorbitaire ; 31 - nerf frontal ; 32 - bloc ; 33 - sinus frontal.
Les branches de liaison sous la forme de ses racines s'approchent du nœud : 1) sensible, base nasociliaire, - du nerf naso-ciliaire ; 2) parasympathique, base oculomotrice, - du nerf oculomoteur ; 3) sympathique, base sympathique, - du plexus entourant a. ophtalmique. De 4 à 10 s'étendent du nœud ciliaire court

Riz. 233. Nœud ciliaire (schéma).
1 - branche de connexion blanche ; 2 - nœud cervical supérieur du tronc sympathique ; 3 - plexus carotide interne ; 4 - racine sympathique ; 5 - nœud ciliaire ; 6 - racine nasociliaire ; 7 - nerf oculomoteur ; 8 - racine oculomotrice ; 9 - nerfs ciliaires courts ; 10 - fibres parasympathiques préganglionnaires ; 11 - fibres parasympathiques postganglionnaires ; 12 - fibres sensibles ; 13 - fibres sympathiques postganglionnaires ; 14 - noyau sympathique ; 15 - nerf spinal; 16 - fibres sympathiques préganglionnaires ; 17 - fibres motrices.
nerfs ciliaires, pp. cils courts, entrer dans le globe oculaire. Ils contiennent des fibres parasympathiques postganglionnaires innervant le muscle ciliaire et le sphincter de la pupille, des fibres sensorielles innervant les membranes du globe oculaire, ainsi que des fibres sympathiques au muscle qui dilate la pupille.
NERF MAXILLAIRE
nerf maxillaire,n. maxillaire, - deuxième branche du nerf trijumeau, principalement sensorielle. Il a une épaisseur de 2,5 à 4,5 mm et se compose de 25 à 70 petits faisceaux contenant de 30 000 à 80 000 fibres nerveuses myélinisées, pour la plupart de petit diamètre (jusqu'à 5 microns).
Le nerf maxillaire innerve la dure-mère du cerveau, la peau de la paupière inférieure, le coin latéral de l'œil, la région temporale antérieure, la partie supérieure de la joue, les ailes du nez, la peau et les muqueuses. la lèvre supérieure, muqueuse des parties postérieure et parties inférieures cavité nasale, muqueuse du sinus sphénoïde, palais, dents mâchoire supérieure(Fig. 234). En sortant du crâne par le foramen rotundum, le nerf pénètre dans la fosse ptérygopalatine, passe d'arrière en avant et de l'intérieur vers l'extérieur. La longueur du segment et sa position dans la fosse dépendent de la forme du crâne. Dans un crâne brachycéphale, la longueur du segment nerveux dans la fosse est de 15 à 22 mm, il est situé profondément dans la fosse - jusqu'à 5 cm du milieu de l'arc zygomatique. Parfois, le nerf de la fosse ptérygopalatine est recouvert d'une crête osseuse. Dans un crâne dolichocéphale, la longueur de la section nerveuse en question est de 10 à 15 mm et elle est située plus superficiellement - jusqu'à 4 cm du milieu de l'arc zygomatique.
Au sein de la fosse ptérygopalatine, le nerf maxillaire dégage branche méningée, r. méningée,à la dure-mère et est divisé en 3 branches : 1) branches nodales allant au ganglion ptérygopalatin, 2) le nerf zygomatique et 3) le nerf infraorbitaire, qui est une continuation directe du nerf maxillaire.
1. Branches nodales,rr. ganglionnaires, numérotés de 1 à 7, partez du nerf maxillaire à une distance de 1,0 à 2,5 mm du foramen rond et allez au nœud ptérygopalatin, en donnant des fibres sensorielles aux nerfs à partir du nœud. Certaines branches nodales contournent le nœud et rejoignent ses branches.
Ganglion ptérygopalatin,ganglion ptérygopalatin, - formation de la partie parasympathique du système nerveux autonome. Le nœud est de forme triangulaire, de 3 à 5 mm de long, contient des cellules multipolaires

Riz. 234. Nerf maxillaire.
et a 3 racines : 1) sensible - branches nodales,p. ptérygopalatini; 2) parasympathique - nerf pétreux majeur,n. petrosus major(branche du nerf intermédiaire), contient des fibres vers les glandes de la cavité nasale, du palais, de la glande lacrymale ; 3) sympathique - nerf pétreux profond,n. petrosus profundus, provient du plexus carotidien interne et contient des fibres nerveuses sympathiques postganglionnaires provenant des ganglions cervicaux. Des branches s'étendent à partir du nœud, qui contiennent des fibres sécrétoires (parasympathiques et sympathiques) et sensorielles (Fig. 235) :
1) branches orbitales,rr. orbitales, 2-3 troncs minces pénètrent dans la fissure orbitaire inférieure puis, avec le nerf ethmoïdal postérieur, traversent les petites ouvertures de la suture sphénoïde-ethmoïdale jusqu'à la membrane muqueuse des cellules postérieures du labyrinthe ethmoïdal et du sinus sphénoïdal ;
2) branches nasales postéro-supérieures,rr. nasales postérieures supérieures, Au nombre de 8 à 14, ils émergent de la fosse ptérygopalatine à travers le foramen sphénopalatin jusqu'à la cavité nasale et sont divisés en deux groupes : latéral et médial. Branches latérales rr. nasales postérieures supérieures latérales(6-10), allez à la membrane muqueuse des sections postérieures de la conque nasale supérieure et moyenne et des voies nasales, aux cellules postérieures de l'os ethmoïde, à la surface supérieure des choanes et à l'ouverture pharyngée du tube auditif. Branches médiales rr. nasales postérieures supérieures médiales(2-3), branche dans la membrane muqueuse de la partie supérieure

Riz. 235. Nœud ptérygopalatin (schéma).
1 - nerf maxillaire ; 2 - fibres parasympathiques préganglionnaires du nerf grand pétreux ; 3 - fibres sympathiques postganglionnaires du nerf pétreux profond ; 4 - nerfs palatins ; 5 - fibres parasympathiques postganglionnaires ; 6 - nerf zygomatique ; 7 - branche de connexion des nerfs zygomatiques et lacrymaux; 8 - nerf lacrymal; 9 - glande lacrymale; 10 - nerf du canal ptérygoïdien ; 11 - branches nodales du nerf maxillaire ; 12 - nerfs nasaux postérieurs ; 13 - fibres sensibles.
cloison nasale. L'une des branches médiales est nerf naso-palatin,
n. nasopalatinus, passe entre le périoste et la membrane muqueuse de la cloison avec l'artère postérieure de la cloison nasale vers l'avant, jusqu'à l'ouverture nasale du canal incisif, à travers laquelle elle atteint la membrane muqueuse de la partie antérieure du palais. Forme une connexion avec la branche nasale du nerf alvéolaire supérieur (Fig. 236).
nerfs palatins,p. Palatini, se propagent du nœud au canal grand palatin, formant 3 groupes de nerfs :
1) nerf grand palatin,n. palatinus major, - la branche la plus épaisse sort par le grand foramen palatin jusqu'au palais, où elle se divise en 3-4 branches qui innervent la majeure partie de la membrane muqueuse du palais et ses glandes dans la zone allant des canines aux palais mou;

Riz. 236. Nerf olfactif, ganglion ptérygopalatin et branches du nerf trijumeau. 1 - passage nasal inférieur; 2, 4, 7 - cornets inférieurs, moyens et supérieurs, respectivement ; 3 - passage nasal moyen; 5 - bulbe olfactif ; 6 - nerfs olfactifs ; 8 - sinus sphénoïdal ; 9 - nerf optique; 10, 23 - artère carotide interne ; 11 - nerf oculomoteur ; 12 - nœud ptérygopalatin ; 13 - nerf optique ; 14 - nerf maxillaire ; 15 - nœud trijumeau ; 16 - nerf du canal ptérygoïdien ; 17 - nerf trijumeau ; 18 - nerf pétreux majeur ; 19 - nerf pétreux profond ; 20, 31 - nerf facial ; 21 - nerf vestibulocochléaire ; 22 - plexus du nerf carotide interne ; 24 - nerf lingual; 25 - nerf alvéolaire inférieur ; 26 - corde de tambour ; 27 - artère méningée moyenne ; 28 - artère maxillaire ; 29 - processus styloïde ; 30 - processus mastoïde; 32 - glande salivaire parotide ; 33 - plaque perpendiculaire de l'os palatin ; 34 - muscle ptérygoïdien médial ; 35 - nerfs palatins ; 36 - palais mou; 37 - palais dur; 38 - lèvre supérieure.
2) petits nerfs palatins,p. Palatini Minores, pénétrer dans la cavité buccale par les petites ouvertures palatines et se ramifier dans la membrane muqueuse du palais mou et de la région amygdale;
3) branches nasales postérieures inférieures,rr. nasales postérieures inférieures, Ils pénètrent dans le canal grand palatin, en sortent par de petites ouvertures et, au niveau du cornet inférieur, pénètrent dans la cavité nasale, innervant la membrane muqueuse du cornet inférieur, les voies nasales moyennes et inférieures et le sinus maxillaire.
2. Nerf zygomatique,n. zygomatique, se ramifie à partir du nerf maxillaire dans la fosse ptérygopalatine et pénètre par la fissure orbitaire inférieure dans l'orbite, où il longe la paroi externe, sort par le foramen zygomatico-orbitaire et se divise en deux branches :
1) branche zygomaticofaciale,r. zygomaticofacialis, sort par le foramen zygomaticofacial sur la surface antérieure de l'os zygomatique, dans la peau de la partie supérieure de la joue il dégage une branche vers la zone du canthus externe et une branche de connexion vers le nerf facial ;
2) branche zygomaticotemporale,r. zygomaticotemporalis, sort de l'orbite par l'ouverture du même nom dans l'os zygomatique, perce le muscle temporal et son fascia et innerve la peau de la partie antérieure de la partie temporale et postérieure des régions frontales. Dégage une branche de connexion au nerf lacrymal, contenant des fibres parasympathiques sécrétoires vers la glande lacrymale.
3. nerf infra-orbitaire,n. infra-orbitaire, est une continuation du nerf maxillaire et tire son nom de l'origine des branches mentionnées précédemment de ce dernier. Le nerf infraorbitaire quitte la fosse ptérygopalatine par la fissure orbitaire inférieure, passe le long de la paroi inférieure de l'orbite avec les vaisseaux du même nom dans le sillon infraorbitaire (dans 15 % des cas, au lieu d'un sillon, il y a un canal osseux) et sort par le foramen infra-orbitaire sous le muscle qui soulève la lèvre supérieure, se divisant vers les branches terminales. La longueur du nerf sous-orbitaire est différente : chez les brachycéphales, le tronc nerveux est de 20 à 27 mm et chez les dolichocéphales, il est de 27 à 32 mm. La position du nerf dans l'orbite correspond au plan parasagittal tracé à travers le foramen sous-orbitaire.
La nature de l'origine des branches peut également être différente : dispersées, dans lesquelles de nombreux nerfs fins avec un grand nombre de connexions partent du tronc, ou principales avec un petit nombre de gros nerfs. Sur son trajet, le nerf infra-orbitaire dégage les branches suivantes :
1) nerfs alvéolaires supérieurs,p. alvéolaires supérieures, innerver les dents et la mâchoire supérieure (Fig. 237). Il existe 3 groupes de branches des nerfs alvéolaires supérieurs :
UN) branches alvéolaires postéro-supérieures, rr. alvéolaires supérieures postérieures, Ils partent généralement du nerf infraorbitaire dans la fosse ptérygopalatine, au nombre de 4 à 8 et situés avec les vaisseaux du même nom le long de la surface du tubercule de la mâchoire supérieure. Certains des nerfs les plus postérieurs longent la surface externe du tubercule jusqu'au processus alvéolaire, le reste entre par les nerfs postérieurs.

Riz. 237. Nerf maxillaire.
1 - branches alvéolaires postéro-supérieures ; 2 - nerf zygomatique ; 3 - nerf maxillaire ; 4 - nerf du canal ptérygoïdien ; 5 - nerf optique ; 6 - nerf trijumeau ; 7 - nerf mandibulaire ; 8 - corde de tambour ; 9 - nœud d'oreille; 10 - branches reliant le ganglion ptérygopalatin au nerf maxillaire; 11 - nerf masticateur; 12 - nerf alvéolaire inférieur ; 13 - nerf lingual ; 14 - nœud ptérygopalatin ; 15 - nerf sous-orbitaire ; 16 - branches alvéolaires antéro-supérieures.
ouvertures alvéolaires supérieures dans les canaux alvéolaires. Se ramifiant avec d'autres branches alvéolaires supérieures, elles forment le système nerveux plexus dentaire supérieur,plexus dentaire supérieur, qui se situe dans le processus alvéolaire de la mâchoire supérieure au-dessus des apex des racines. Le plexus est assez dense, largement bouclé, s'étendant sur toute la longueur du processus alvéolaire. Les branches gingivales supérieures s'étendent du plexus, rr. gingivales supérieures, au parodonte et au parodonte au niveau des molaires supérieures et des branches dentaires supérieures, rr. dentaires supérieures, jusqu'à l'extrémité des racines des grosses molaires, dans la cavité pulpaire de laquelle elles se ramifient. De plus, les branches alvéolaires postéro-supérieures envoient de fins nerfs à la membrane muqueuse du sinus maxillaire ;
b) branche alvéolaire supérieure moyenne, r. alvéolaire moyen supérieur, sous la forme d'un ou, moins souvent, de deux troncs, il se ramifie à partir du nerf infra-orbitaire, le plus souvent dans la fosse ptérygopalatine et moins souvent à l'intérieur de l'orbite, passe dans l'un des canaux alvéolaires et se ramifie dans
tubules osseux de la mâchoire supérieure faisant partie du plexus dentaire supérieur. Il a des branches de connexion avec les branches alvéolaires postérieures et antéro-supérieures. Innerve le parodonte et le parodonte au niveau des prémolaires supérieures à travers les branches gingivales supérieures et des prémolaires supérieures à travers les branches dentaires supérieures ;
V) branches alvéolaires antéro-supérieures, rr. alvéolaires supérieures antérieures, naissent du nerf sous-orbitaire dans la partie antérieure de l'orbite, qui sort par les canaux alvéolaires et pénètre dans la paroi antérieure du sinus maxillaire, où ils font partie du plexus dentaire supérieur. Les branches gingivales supérieures innervent la membrane muqueuse du processus alvéolaire et les parois des alvéoles au niveau des canines et incisives supérieures, les branches dentaires supérieures - les canines et incisives supérieures. Les branches alvéolaires antéro-supérieures envoient une fine branche nasale à la membrane muqueuse du plancher antérieur de la cavité nasale ;
2) branches inférieures des paupières,rr. palpébrales inférieures, ils partent du nerf infra-orbitaire lorsqu'ils sortent du foramen infra-orbitaire, pénètrent à travers le muscle releveur des lèvres supérieures et, se ramifiant, innervent la peau de la paupière inférieure ;
3) branches nasales externes,rr. nasales externes, innerver la peau au niveau de l'aile du nez;
4) branches nasales internes,rr. nasales internes, approchez-vous de la membrane muqueuse du vestibule de la cavité nasale;
5) branches labiales supérieures,rr. labiales supérieures, numéro 3-4, passer entre la mâchoire supérieure et le muscle qui soulève la lèvre supérieure, vers le bas ; innerver la peau et les muqueuses de la lèvre supérieure jusqu'à la commissure de la bouche.
Toutes les branches externes répertoriées du nerf infra-orbitaire forment des connexions avec les branches du nerf facial.
NERF MANDIBULAIRE
nerf mandibulaire,n.mandibulaire, - la troisième branche du nerf trijumeau est un nerf mixte et est formée de fibres nerveuses sensorielles provenant du ganglion trijumeau et de fibres motrices de la racine motrice. L'épaisseur du tronc nerveux varie de 3,5 à 7,5 mm et la longueur de la partie extracrânienne du tronc est de 0,5 à 2,0 cm. Le nerf est constitué de 30 à 80 faisceaux de fibres, dont de 50 000 à 120 000 fibres nerveuses myélinisées.
Le nerf mandibulaire assure l'innervation sensorielle de la dure-mère du cerveau et de la peau lèvre inférieure, menton, joue inférieure, partie antérieure de l'oreillette et partie externe le conduit auditif, parties de la surface du tympan, de la muqueuse buccale, du plancher buccal et des deux tiers antérieurs de la langue, dents mâchoire inférieure, ainsi que l'innervation motrice de tous les muscles masticateurs, du muscle mylohyoïdien, du ventre antérieur du muscle digastrique et des muscles qui sollicitent le tympan et le voile palatin.
De la cavité crânienne, le nerf mandibulaire sort par le foramen ovale et pénètre dans la fosse infratemporale, où il se divise près du site de sortie en un certain nombre de branches. La ramification du nerf mandibulaire est possible soit type lâche(plus souvent chez les dolichocéphales) - le nerf se divise en plusieurs branches (8-11), ou le long type de coffre(plus souvent chez les brachycéphales) avec ramification en un petit nombre de troncs (4-5), communs à plusieurs nerfs.
Trois nœuds du système nerveux autonome sont associés aux branches du nerf mandibulaire : oreille,ganglion otique;sous-maxillaire,ganglion sous-maxillaire;sublingual,ganglion sublingual. Des ganglions, les fibres sécrétoires parasympathiques postganglionnaires vont aux glandes salivaires.
Le nerf mandibulaire dégage un certain nombre de branches (Fig. 238, 239).
1. branche méningée,r. méningée, traverse le foramen spinosum avec l'artère méningée moyenne dans la cavité crânienne, où elle se ramifie dans la dure-mère.
2. Nerf massétérique,n. massetericus, principalement moteur, souvent (en particulier dans la forme principale de ramification du nerf mandibulaire) a une origine commune avec d'autres nerfs des muscles masticateurs. Il passe vers l'extérieur sur le bord supérieur du muscle ptérygoïdien latéral à travers l'encoche de la mandibule et est intégré dans le muscle masséter. Avant de pénétrer dans le muscle, il envoie une fine branche à l'articulation temporo-mandibulaire, assurant son innervation sensible.
3. Nerfs temporaux profondsp. temporales profondes, moteur, longe la base externe du crâne vers l'extérieur, se courbe autour de la crête infratemporale et pénètre dans le muscle temporal depuis sa surface interne vers l'avant (n. temporalis profond antérieur) et arrière (élément temporal profond postérieur) départements

Riz. 238. La structure du nerf mandibulaire.
3. Nerf ptérygoïdien latéral,n. ptérygoïde latéral, moteur, quitte généralement un tronc commun avec le nerf buccal, se rapproche du muscle du même nom, dans lequel il se ramifie.
4. Nerf ptérygoïdien médial,n. ptérygoïde médial, principalement moteur. Il traverse le ganglion de l'oreille ou est adjacent à sa surface et suit vers l'avant et vers le bas jusqu'à la surface interne du muscle du même nom, dans lequel il pénètre près de son bord supérieur. De plus, près du nœud de l'oreille, il dégage n. tensoris tympani, n. tensoris veli palatini et une branche de connexion au nœud.
5. nerf buccal,n. buccalis, sensible, pénètre entre les deux têtes du muscle ptérygoïdien latéral et longe la surface interne du muscle temporal, s'étendant davantage avec les vaisseaux buccaux le long de la surface externe du muscle buccal jusqu'à la commissure de la bouche. Sur son chemin, il dégage de fines branches qui transpercent le muscle buccal et innervent la muqueuse de la joue (jusqu'à la gencive de la 2ème prémolaire et de la 1ère molaire) et des branches jusqu'à la peau de la joue et de la commissure de la bouche. Forme une branche de liaison avec la branche du nerf facial et avec le ganglion de l'oreille.

Riz. 239. Nerf mandibulaire.
1 - nerf maxillaire ; 2 - nerf alvéolaire supérieur ; 3, 4 - nerf sous-orbitaire ; 5 - nerf buccal ; 6 - muscle buccal : 7, 10 - nerf alvéolaire inférieur ; 8 - muscle masticateur (coupé et détourné) ; 9 - nerf lingual ; 11 - muscle ptérygoïdien latéral ; 12 - nerf masticateur; 13 - nerf facial ; 14 - nerf auriculotemporal ; 15 - muscle temporal.
6. Nerf auriculotemporal,n.auriculotemporalis, sensible, part de la face postérieure du nerf mandibulaire avec deux racines recouvrant l'artère méningée moyenne, qui se connectent ensuite en un tronc commun. Dégage une branche de connexion au nœud de l’oreille. Près du col de l'apophyse articulaire de la mâchoire inférieure, le nerf auriculotemporal monte et traverse la parotide. glande salivaire s'étend dans la région temporale, où il se ramifie en branches terminales - temporelles superficielles, r. temporales superficielles. Sur son trajet, le nerf auriculotemporal dégage les branches suivantes :
1) articulaire,r. articulaires,à l'articulation temporo-mandibulaire ;
2) parotide,r. parotidei,à la glande salivaire parotide. Ces branches contiennent, en plus des fibres sensorielles, des fibres sécrétoires parasympathiques provenant du ganglion de l'oreille ;
3) nerf du conduit auditif externe,n. méat acustici externe,à la peau du conduit auditif externe et du tympan ;
4) nerfs auriculaires antérieursn. auriculaires antérieures,à la peau de la partie antérieure de l'oreillette et de la partie médiane de la région temporale.
7. nerf lingual,n. lingualis, sensible. Il provient du nerf mandibulaire près du foramen ovale et est situé entre les muscles ptérygoïdiens en avant du nerf alvéolaire inférieur. Au bord supérieur du muscle ptérygoïdien médial ou légèrement en dessous, il rejoint le nerf corde de tambour,corde tympanique, qui est une continuation du nerf intermédiaire. Faisant partie de la corde tympanique, le nerf lingual comprend des fibres sécrétoires qui vont aux ganglions nerveux sous-maxillaires et sublinguals, et des fibres gustatives jusqu'aux papilles de la langue. Ensuite, le nerf lingual passe entre la surface interne de la mâchoire inférieure et le muscle ptérygoïdien médial, au-dessus de la glande salivaire sous-maxillaire le long de la surface externe du muscle hyoïde jusqu'à la surface latérale de la langue. Entre les muscles hyoglosse et génioglosse, le nerf se divise en branches linguales terminales, rr. linguales.
Le long du parcours du nerf, des branches de liaison avec le nerf hypoglosse et la corde tympanique se forment. Dans la cavité buccale, le nerf lingual dégage les branches suivantes :
1) branches de l'isthme du pharynx,rr. isthme faucium, innerver la membrane muqueuse du pharynx et du plancher postérieur de la bouche ;
2) nerf hypoglosse,n.sublingualis, part du nerf lingual au bord postérieur du ganglion hypoglosse sous la forme d'une fine branche de connexion et s'étend vers l'avant le long de la surface latérale du ganglion hypoglosse glande salivaire. Innerve la membrane muqueuse du plancher buccal, les gencives et la glande salivaire sublinguale ;
3) branches linguales,rr. linguistiques, passer avec les artères et les veines profondes de la langue à travers les muscles de la langue vers l'avant et se terminer dans la membrane muqueuse du sommet de la langue et son corps le long de la ligne frontière. Faisant partie des branches linguales, les fibres gustatives passent aux papilles de la langue, en passant par la corde tympanique.
8. nerf alvéolaire inférieur,n. alvéolaire inférieure, mixte. C'est la plus grande branche du nerf mandibulaire. Le tronc se situe entre les muscles ptérygoïdiens en arrière et latéraux du nerf lingual, entre la mandibule et le ligament sphénomandibulaire. Le nerf pénètre, avec les vaisseaux du même nom, dans le canal mandibulaire, où il dégage de multiples branches qui s'anastomosent les unes avec les autres et forment plexus dentaire inférieur,plexus dentaire inférieur(dans 15% des cas), ou directement les dents inférieures
branches ny et gingivales. Il quitte le canal par le foramen mentonnier, se divise avant de sortir sur le nerf mentonnier et la branche incisive. Donne les branches suivantes :
1) nerf mylohyoïdien, Et. mylohyoïdeus naît près de l'entrée du nerf alvéolaire inférieur dans le foramen mandibulaire, se situe dans le sillon du même nom dans la branche de la mandibule et se dirige vers le muscle mylohyoïdien et le ventre antérieur du muscle digastrique ;
2) Dents inférieures Et branches de gomme,rr. dentaires et gingivales inférieures, proviennent du nerf alvéolaire inférieur du canal mandibulaire ; innerver les gencives, les alvéoles de la partie alvéolaire de la mâchoire et les dents (prémolaires et molaires) ;
3) nerf mental,n. mentalis, est une continuation du tronc du nerf alvéolaire inférieur lorsqu'il sort par le foramen mentonnier du canal de la mâchoire inférieure, où le nerf est divisé en forme d'éventail en 4 à 8 branches, parmi lesquelles on distingue : a) mentonnière, rr. mental,à la peau du menton ; b) les labiales inférieures, rr. labiates inférieures, sur la peau et les muqueuses de la lèvre inférieure.
nœud d'oreille,ganglion otique, - corps rond d'un diamètre de 3 à 5 mm; situé sous le foramen ovale sur la surface postéro-médiale du nerf mandibulaire. Le petit nerf pétreux (issu du glossopharyngé) s'en approche, amenant les fibres parasympathiques préganglionnaires. Un certain nombre de branches de connexion partent du nœud : 1) vers le nerf auriculotemporal, qui reçoit les fibres sécrétoires parasympathiques postganglionnaires, qui font ensuite partie des branches parotides jusqu'à la glande salivaire parotide ; 2) à la branche méningée, contenant des fibres alimentant les vaisseaux de la dure-mère du cerveau ; 3) à la corde du tambour ; 4) aux ganglions ptérygopalatins et trigéminaux (Fig. 240).
Nœud sous-maxillaire,ganglion sous-mandibulaire, De 3,0 à 3,5 mm, situé sous le tronc du nerf lingual et relié à celui-ci par des branches nodales, rr. ganglionnaires. Le long de ces branches, ils vont jusqu'au nœud et les fibres de la corde du tambour s'y terminent. Les branches postganglionnaires s'étendant à partir du nœud innervent les glandes salivaires sous-mandibulaires et sublinguales (voir Fig. 235).
Parfois (jusqu'à 30 % des cas), il existe un nœud sublingual,ganglion sublingual.
VI PAIRE - ABONDANCE DES NERFS
nerf abducens, n. abducens- moteur. Noyau du nerf abducensnoyau n. abducentis, situé dans la partie antérieure du bas du quatrième ventricule. Le nerf quitte le cerveau par l'arrière

Riz. 240. Nœuds auriculaires et sous-mandibulaires (schéma).
1 - nerf mandibulaire ; 2, 10 - fibres parasympathiques préganglionnaires ; 3 - nerf pétreux inférieur ; 4 - branche reliant le nœud de l'oreille au nerf auriculotemporal ; 5, 15 - fibres parasympathiques postganglionnaires ; 6 - artère moyenne de la dure-mère ; 7 - nerf auriculotemporal ; 8, 16 - fibres sensibles ; 9 - corde de tambour ; 11 - branches nodales du nerf lingual ; 12, 19 - passage des fibres préganglionnaires aux fibres postganglionnaires ; 13 - nerf sous-maxillaire ; 14 - branches glandulaires; 17 - nerf lingual; 18 - branche reliant le nœud de l'oreille au nerf buccal; 20 - nœud d'oreille; 21 - branches nodales du nerf mandibulaire.

Riz. 241. Nerf facial (schéma).
1 - bas du ventricule IV ; 2 - noyau du nerf facial ; 3 - foramen stylomastoïdien ; 4 - muscle de l'oreille postérieure ; 5 - veine occipitale ; 6 - ventre postérieur du muscle digastrique ; 7 - muscle stylo-hyoïdien ; 8 - branches du nerf facial vers les muscles du visage et le platysma ; 9 - muscle qui abaisse l'angle de la bouche ; 10 - muscle mental; 11 - muscle qui abaisse la lèvre inférieure ; 12 - muscle buccal; 13 - muscle orbiculaire de l'or; 14 - muscle qui soulève la lèvre supérieure ; 15 - muscle canin ; 16 - muscle zygomatique ; 17 - muscle circulaire de l'œil ; 18 - muscle qui ride le sourcil ; 19 - muscle frontal; 20 - corde de tambour; 21 - nerf lingual; 22 - nœud ptérygopalatin ; 23 - nœud trijumeau ; 24 - artère carotide interne ; 25 - nerf intermédiaire; 26 - nerf facial; 27 - nerf vestibulocochléaire.
le bord du pont, entre celui-ci et la pyramide de la moelle allongée, et bientôt, à l'extérieur de l'arrière de la selle turcique, il pénètre dans le sinus caverneux, où il se trouve le long de la surface externe de l'artère carotide interne. Il pénètre ensuite à travers la fissure orbitaire supérieure dans l'orbite et suit le nerf oculomoteur. Dans le sinus caverneux, les branches de connexion du plexus carotide interne contenant des fibres nerveuses sympathiques passent au nerf. Innerve le muscle droit externe de l’œil.
VII PAIRE - NERFS FACIAUX
nerf facial,n. facialis, se développe en relation avec la formation du deuxième arc branchial (Fig. 241), il innerve donc tous les mimiques
1 2 3 4 5 6 7 8

Riz. 242. Nerfs des canaux de l'os temporal.
1 - nerf stapédien ; 2 - corde de tambour ; 3 - plexus tympanique ; 4 - branche reliant le nerf facial au plexus tympanique ; 5 - ensemble coude ; 6 - nerf facial ; 7 - nerf intermédiaire; 8 - nerf vestibulocochléaire ; 9, 19 - branche de connexion du nœud du genou au plexus de l'artère méningée moyenne ; 10 - nerf pétreux majeur; 11 - nerf carotide-tympanique ; 12 - nerf pétreux inférieur ; 13 - plexus du nerf carotide interne ; 14 - nerf pétreux profond ; 15 - nerf du canal ptérygoïdien ; 16 - nerfs ptérygopalatins ; 17 - nerf maxillaire ; 18 - nœud ptérygopalatin ; 20 - plexus nerveux autour de l'artère méningée moyenne ; 21 - nœud d'oreille; 22 - branches du ganglion de l'oreille jusqu'au nerf auriculotemporal ; 23 - branche de connexion entre le nœud de l'oreille et la corde du tambour ; 24 - nerf masticateur; 25 - nerf mandibulaire ; 26 - nerf lingual; 27 - nerf alvéolaire inférieur ; 28 - nerf auriculotemporal ; 29 - nerf tympanique ; 30 - nerf glossopharyngé; 31 - nœud supérieur du nerf vague ; 32 - branche auriculaire du nerf vague ; 33 - branche de liaison du nerf facial avec la branche auriculaire du nerf vague ; 34 - branches du nerf facial jusqu'au muscle stylo-hyoïdien ; 35 - branches du nerf facial jusqu'au ventre postérieur du muscle digastrique ; 36 - nerf auriculaire postérieur ; 37 - processus mastoïde.
quelques muscles. Le nerf est mixte, comprenant des fibres motrices issues de son noyau médullaire efférent, ainsi que des fibres sensorielles et autonomes (gustatives et sécrétoires) appartenant au nerf facial. nerf intermédiairen. intermédiaire.
Noyau moteur du nerf facialnerf facial du noyau, situé au bas du ventricule IV, dans la région latérale de la formation réticulaire. La racine du nerf facial quitte le cerveau avec la racine du nerf intermédiaire devant le nerf vestibulocochléaire, entre le bord postérieur du pont et l'olive de la moelle allongée. Ensuite, les nerfs faciaux et intermédiaires pénètrent dans le conduit auditif interne et pénètrent dans le canal facial. Dans le canal facial, les deux nerfs forment un tronc commun, faisant deux tours selon les courbures du canal (Fig. 242).
Premièrement, le tronc commun est positionné horizontalement, se dirigeant vers l’avant et latéralement au-dessus de la cavité tympanique. Puis, selon la courbure du canal facial, le canon se retourne à angle droit, formant un genou, génicule n. facialis, et l'ensemble manivelle, ganglion génique, appartenant au nerf intermédiaire. Après avoir passé au-dessus de la cavité tympanique, le tronc effectue un deuxième tour vers le bas, situé derrière la cavité de l'oreille moyenne. Dans cette zone, les branches du nerf intermédiaire partent du tronc commun ; le nerf facial quitte le canal par le foramen stylomastoïdien et pénètre bientôt dans la glande salivaire parotide. La longueur du tronc de la partie extracrânienne du nerf facial varie de 0,8 à 2,3 cm (généralement 1,5 cm) et l'épaisseur de 0,7 à 1,4 mm ; le nerf contient 3 500 à 9 500 fibres nerveuses myélinisées, parmi lesquelles prédominent les plus épaisses.
Dans la glande salivaire parotide, à une profondeur de 0,5 à 1,0 cm de sa surface externe, le nerf facial est divisé en 2 à 5 branches primaires, qui sont divisées en branches secondaires, formant plexus parotide,plexus intraparotideus.
Il existe deux formes de structure externe du plexus parotide : réticulaire et tronc. À forme réticulée le tronc nerveux est court (0,8-1,5 cm), dans l'épaisseur de la glande, il est divisé en de nombreuses branches qui ont de multiples connexions entre elles, ce qui entraîne la formation d'un plexus à boucle étroite. De multiples connexions avec les branches du nerf trijumeau sont observées. À ligne principale (formulaire le tronc nerveux est relativement long (1,5-2,3 cm), divisé en deux branches (supérieure et inférieure), qui donnent naissance à plusieurs branches secondaires ; il y a peu de connexions entre les branches secondaires, le plexus est largement bouclé (Fig. 243).
Tout au long de son trajet, le nerf facial dégage des branches à son passage dans le canal et à sa sortie. À l’intérieur du canal, de nombreuses branches en partent.
1. Nerf pétreux majeur,n. petrosus major, prend naissance près du ganglion du genu, quitte le canal nerveux facial par la fente du canal nerveux grand pétreux et passe le long du sillon du même nom jusqu'au foramen lacerum. Après avoir pénétré le cartilage jusqu'à la base externe du crâne, le nerf se connecte au nerf pétreux profond, formant nerf du canal ptérygoïdien,n. canalis ptérygoidei, entrer dans le canal ptérygoïdien et atteindre le nœud ptérygopalatin.
Le nerf contient des fibres parasympathiques du ganglion ptérygopalatin, ainsi que des fibres sensorielles provenant des cellules du ganglion genu. Certaines des fibres sensorielles du nerf grand pétreux proviennent du ganglion ptérygopalatin qui fait partie du nerf facial.

Riz. 243. Différences dans la structure du nerf facial.
a - structure de type réseau ; b - structure principale.
1 - nerf facial ; 2 - muscle masticateur.
2. nerf stapédien,n. stapédien, - un tronc mince, se ramifiant dans le canal facial au deuxième tour, pénètre dans la cavité tympanique, où il innerve le muscle stapédien.
3. corde de tambour,corde tympanique, est une continuation du nerf intermédiaire, se sépare du nerf facial dans la partie inférieure du canal au-dessus du foramen stylomastoïdien et pénètre par le canalicule de la corde tympanique dans la cavité tympanique, où il se trouve sous la membrane muqueuse entre la longue jambe de l'enclume et le manche du marteau. Par la fissure pétrotympanique, la corde tympanique sort vers la base externe du crâne et fusionne avec le nerf lingual dans la fosse infratemporale.
Au point d'intersection avec le nerf alvéolaire inférieur, la corde tympanique dégage une branche de liaison avec le ganglion auriculaire. La corde tympanique est constituée de fibres parasympathiques préganglionnaires du ganglion sous-maxillaire et de fibres gustatives des deux tiers antérieurs de la langue.
4. Branche de liaison avec le plexus tympanique,r. communicans cum plexo tympanico, - branche mince; part du ganglion genu ou du nerf grand pétreux, traverse le toit de la cavité tympanique jusqu'au plexus tympanique.
À la sortie du canal, les branches suivantes partent du nerf facial.
1. Nerf auriculaire postérieurn.auriculaire postérieur, part du nerf facial immédiatement après la sortie du foramen stylomastoïdien, remonte et remonte le long de la face antérieure de l'apophyse mastoïde, se divisant en deux branches : l'auriculaire, r. auriculaire, innervant le muscle auriculaire postérieur et l'occipital, r. occipital innervant le ventre occipital du muscle supracrânien.
2. Branche digastriquer. digastrique, apparaît un peu plus bas nerf auriculaire et, en descendant, innerve le ventre postérieur du muscle digastrique et du muscle stylo-hyoïdien.
3. Branche de liaison avec le nerf glossopharyngé,r. communicans cum n. glossopharyngé, se ramifie près du foramen stylomastoïdien et s’étend en avant et vers le bas du muscle stylo-pharyngé, se connectant aux branches du nerf glossopharyngé.
Branches du plexus parotide :
1. Branches temporelles,rr. temporelles, au nombre de 2-4, montent et sont répartis en 3 groupes : antérieur, innervant la partie supérieure muscle orbiculaire les yeux et le muscle ondulateur ; milieu, innervant le muscle frontal ; postérieur, innervant les muscles rudimentaires de l'oreillette.
2. Branches zygomatiques,rr. zygomatiques, en quantité de 3-4, s'étendant vers l'avant et vers le haut jusqu'aux parties inférieures et latérales du muscle orbiculaire de l'oeil et du muscle zygomatique, qu'il innerve.
3. branches buccales,rr. buccales, en quantité de 3 à 5, ils s'étendent horizontalement vers l'avant le long de la surface externe du muscle masticateur et alimentent les muscles autour du nez et de la bouche.
4. Branche marginale de la mandibule,r. marginalis mandibulaire, court le long du bord de la mâchoire inférieure et innerve les muscles qui abaissent l'angle de la bouche et la lèvre inférieure, le muscle mental et le muscle du rire.
5. branche cervicale, r. Collie, descend jusqu'au cou, se connecte au nerf transverse du cou et innerve T. platysme.
Nerf intermédiaire,n. intermédiaire, se compose de fibres parasympathiques et sensorielles préganglionnaires. Les cellules unipolaires sensibles sont situées dans le ganglion du genu. Les processus centraux des cellules montent dans le cadre de la racine nerveuse et se terminent dans le noyau du tractus solitaire. Les processus périphériques des cellules sensorielles traversent la corde tympanique et le nerf grand pétreux jusqu'à la membrane muqueuse de la langue et du palais mou.
Les fibres parasympathiques sécrétoires proviennent du noyau salivaire supérieur de la moelle allongée. La racine du nerf intermédiaire quitte le cerveau entre les nerfs facial et vestibulocochléaire, rejoint le nerf facial et traverse le canal facial. Les fibres du nerf intermédiaire quittent le tronc facial, passent dans la corde tympanique et le nerf grand pétreux, atteignant les nœuds sous-maxillaires et sublinguaux et le nœud ptérygopalatin.
QUESTIONS POUR LA Maîtrise de soi
1. Quels nerfs crâniens sont d’origine mixte ?
2. Quels nerfs crâniens se développent à partir du cerveau antérieur ?
3. Énumérez les nerfs qui innervent les muscles oculaires.
4. Par quelles branches s'effectue l'innervation sensible des nerfs optiques ? Indiquez les zones de cette innervation.
5. Quelles branches naissent du nerf optique ?
6. Par quels nerfs sont-ils innervés ? dents du haut? D'où viennent ces nerfs ?
7. Énumérez les branches du nerf mandibulaire.
8. Quels nerfs traversent la corde tympanique ?
9. Quelles branches partent du nerf facial à l'intérieur de leur canal ? Qu’est-ce qu’ils innervent ?
10. Quelles branches naissent du nerf facial au niveau du plexus parotide ? Qu’est-ce qu’ils innervent ?
VIII PAIRE - NERFS VESTIBULOCOCOCHLAR
nerf vestibulocochléaire,n. vestibulocochléaris, - sensible, se compose de deux fonctions diverses pièces: vestibule Et cochléaire.
nerf vestibulaire, n. vestibulaire, conduit les impulsions de l'appareil statique du vestibule et des canaux semi-circulaires du labyrinthe oreille interne. nerf cochléaire, n. cochléaire, assure la transmission des stimuli sonores de l'organe spiral de la cochlée. Chaque partie du nerf possède ses propres nœuds sensoriels contenant des cellules nerveuses bipolaires : la partie vestibulaire - nœud vestibulaire,ganglion vestibulaire, situé au bas de l'auditif interne passage; partie cochléaire - ganglion cochléaire[ganglion spiral de la cochlée], ganglion cochléaire, qui est situé dans la cochlée.
Le nœud vestibulaire est allongé, il comporte deux parties : la supérieure, pars supérieur et plus bas pars inférieur. Les processus périphériques des cellules de la partie supérieure forment les nerfs suivants :
1) nerf sacculaire elliptique,n.utriculaire, aux cellules du sac elliptique du vestibule de la cochlée ;
2) nerf ampullaire antérieur,n. ampullaris antérieur, aux cellules des bandes sensibles de l'ampoule membraneuse antérieure du canal semi-circulaire antérieur ;
3) nerf ampullaire latéral,n. ampullaris lateralis,à l’ampoule membraneuse latérale.
De la partie inférieure du ganglion vestibulaire, les processus périphériques des cellules entrent dans la composition nerf sacculaire sphérique,n. saccularis,à la macula auditive du saccule ; nerf ampullaire postérieur,n. ampullaris postérieur,à l'ampoule membraneuse postérieure.
Les processus centraux des cellules du ganglion vestibulaire se forment vestibule(supérieur)colonne vertébrale,base vestibulaire (supérieure), qui sort par le foramen auditif interne derrière les nerfs facial et intermédiaire et pénètre dans le cerveau à côté de la sortie du nerf facial, atteignant les 4 noyaux vestibulaires du pont : médial, latéral, supérieur et inférieur.
Du ganglion cochléaire, les processus périphériques de ses cellules nerveuses bipolaires se dirigent vers les cellules épithéliales sensibles de la moelle épinière.

Riz. 244. Nerf glossopharyngé (schéma).
1 - nerf facial ; 2 - nerf tympanique ; 3 - nœud inférieur du nerf glossopharyngé ; 4 - nerf glossopharyngé ; 5 - nœud auriculaire du nerf glossopharyngé ; 6 - nœud ptérygopalatin ; 7 - nerf trijumeau ; 8 - nerf pétreux inférieur ; 9 - nerf pétreux majeur.
l'organe central de la cochlée, formant collectivement la partie cochléaire du nerf. Les processus centraux des cellules du ganglion cochléaire forment la racine cochléaire (inférieure), base cochléaire (inférieure), accompagnant la racine supérieure dans le cerveau jusqu'aux noyaux cochléaires dorsal et ventral.
NERFS GLOSPHARYNGIENS
nerf glossopharyngé,n. glossopharyngeus, - nerf du troisième arc branchial, mixte. Innerve la muqueuse tiers postérieur langue, arcs palatins, pharynx, cavité tympanique, glande salivaire parotide et muscle stylopharyngé (Fig. 244). Le nerf contient 3 types de fibres nerveuses : 1) sensorielles, 2) motrices, 3) parasympathiques.
Fibres sensibles - processus cellulaires afférents nœuds supérieurs et inférieurs,ganglions supérieurs et inférieurs. Les processus périphériques suivent le nerf jusqu'aux organes où ils forment des récepteurs, les processus centraux vont à la moelle allongée, au noyau sensible du tractus solitaire, noyau solitaire.
Fibres moteur partir des cellules nerveuses communes avec le nerf vague du double noyau, noyau ambigu et passe en tant que partie du nerf jusqu'au muscle stylopharyngé.
Fibres parasympathiques proviennent du noyau salivaire inférieur parasympathique autonome, noyau salivateur inférieur, qui est situé dans la moelle oblongate.
La racine du nerf glossopharyngé émerge de la moelle allongée derrière le site de sortie du nerf vestibulocochléaire et, avec le nerf vague, quitte le crâne par le foramen jugulaire. Dans ce trou, le nerf a sa première extension - noeud supérieur,ganglion supérieur et à la sortie du trou - une seconde expansion - nœud inférieur,ganglion inférieur.
À l'extérieur du crâne, le nerf glossopharyngé se situe d'abord entre le nerf interne artère carotide et interne veine jugulaire, et puis
il se courbe autour du muscle stylopharyngé en un arc peu profond depuis l'arrière et l'extérieur et s'approche de la racine de la langue depuis l'intérieur du muscle hyoglossus, se divisant en branches terminales.
Branches du nerf glossopharyngé :
1. nerf tympanique,n. tympanique, bifurque du ganglion inférieur et traverse le canalicule tympanique jusqu'à la cavité tympanique, où il se forme avec les nerfs carotide-tympanique plexus tympanique,plexus tympanique. Le plexus tympanique innerve la membrane muqueuse de la cavité tympanique et du tube auditif. Le nerf tympanique quitte la cavité tympanique par sa paroi supérieure. nerf petit pétreux,n. petrosus mineur, et va au nœud de l'oreille. Les fibres sécrétoires parasympathiques préganglionnaires, qui font partie du nerf pétreux inférieur, sont interrompues dans le ganglion de l'oreille, et les fibres sécrétoires postganglionnaires pénètrent dans le nerf auriculotemporal et atteignent la glande salivaire parotide dans sa composition.
2. Branche du muscle stylopharyngér. musculi stylopharyngiens, va au muscle du même nom et à la muqueuse du pharynx.
3. branche sinusale,r. sinus carotique, sensibles, branches dans le glomus carotidien.
4. branches d'amandiers,rr. amygdales, sont dirigés vers la membrane muqueuse de l'amygdale palatine et des arcs.
5. Branches pharyngées,rr. pharyngé, en quantité de 3-4, approchez-vous du pharynx et, avec les branches pharyngées du nerf vague et du tronc sympathique, formez-vous sur la surface externe du pharynx plexus pharyngé,plexus pharyngé. Des branches s'étendent jusqu'aux muscles du pharynx et de la membrane muqueuse, qui forment à leur tour des plexus nerveux intra-muros.
6. branches linguales,rr. linguales, - branches terminales du nerf glossopharyngé : contiennent des fibres sensorielles gustatives jusqu'à la membrane muqueuse du tiers postérieur de la langue.
PAIRE X - NERFS VAGUS
Nervus vague,n. vague, mixte, se développe du 4-5ème branchies arc, se propage largement, d'où son nom. Innerve les organes respiratoires, les organes du système digestif (jusqu'au côlon sigmoïde), les glandes thyroïde et parathyroïde, les glandes surrénales, les reins, et participe à l'innervation du cœur et des vaisseaux sanguins.
Le nerf vague contient des fibres parasympathiques et sympathiques sensorielles, motrices et autonomes, ainsi que de petits ganglions nerveux intra-tronc (Fig. 245).

Riz. 245. Nerfs vagues et accessoires (schéma).
1 - branche reliant le nerf vague au nerf facial; 2 - nerf glossopharyngé ; 3 - nerf accessoire ; 4 - branche de connexion du nerf vague avec le nerf hypoglosse; 5 - branche de connexion du nerf vague avec le tronc sympathique ; 6 - langue; 7 - os hyoïde ; 8 - larynx; 9 - trachée ; 10 - nerf laryngé récurrent droit ;
11 - nerf laryngé récurrent gauche ; 12 - nerf vague gauche ; 13 - crosse aortique ; 14 - poumon gauche ; 15 - coeur; 16 - diaphragme; 17 - estomac; 18 - foie; 19 - nœud semi-lunaire droit du plexus du nerf coeliaque ; 20 - nœud nerveux sur l'aorte ascendante ; 21 - poumon droit ; 22 - œsophage; 23 - branches du nerf laryngé récurrent droit ; 24 - nerf laryngé supérieur ; 25 - muscle trapèze; 26 - muscle sternocléidomastoïdien ; 27 - nerf accessoire ; 28 - noyaux des nerfs vagues et accessoires; 29 - noyau du nerf vague ; 30 - nerf facial.
Les fibres nerveuses sensibles du nerf vague proviennent de cellules nerveuses pseudounipolaires afférentes, dont les amas forment 2 ganglions sensoriels du nerf : supérieur, ganglion supérieur situé dans le foramen jugulaire et plus bas, ganglion inférieur, couché à la sortie du trou. Les processus centraux des cellules pénètrent dans la moelle allongée jusqu'au noyau sensible - noyau du tractus solitaire,noyau solitaire et les périphériques - dans le cadre du nerf menant aux vaisseaux, au cœur et aux organes internes, où ils se terminent par un appareil récepteur.
Les fibres motrices des muscles du palais mou, du pharynx et du larynx proviennent des cellules supérieures du système moteur. double noyau.
Les fibres parasympathiques proviennent du système autonome noyau dorsalnoyau dorsal n. Vagi, et se propage dans le cadre du nerf jusqu'au muscle cardiaque, au tissu musculaire des membranes des vaisseaux sanguins et des organes internes. Les impulsions voyageant le long des fibres parasympathiques réduisent la fréquence cardiaque, dilatent les vaisseaux sanguins, rétrécissent les bronches et augmentent le péristaltisme des organes tubulaires du tractus gastro-intestinal.
Les fibres sympathiques postganglionnaires autonomes pénètrent dans le nerf vague le long de ses branches de connexion avec le tronc sympathique à partir des cellules des ganglions sympathiques et se propagent le long des branches du nerf vague jusqu'au cœur, aux vaisseaux sanguins et aux organes internes.
Comme indiqué, les nerfs glossopharyngé et accessoires sont séparés du nerf vague au cours du développement, de sorte que le nerf vague maintient des connexions avec ces nerfs, ainsi qu'avec le nerf hypoglosse et le tronc sympathique par l'intermédiaire de branches de connexion.
Le nerf vague quitte la moelle allongée derrière l'olivier à travers de nombreuses racines, se fondant dans un tronc commun, qui quitte le crâne par le foramen jugulaire. Ensuite, le nerf vague descend dans le cadre du col de l'utérus. faisceau neurovasculaire, entre la veine jugulaire interne et l'artère carotide interne, et en dessous du niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde - entre la même veine et l'artère carotide commune. Par l'ouverture supérieure poitrine Le nerf vague pénètre entre la veine et l'artère sous-clavières à droite et devant la crosse aortique à gauche dans le médiastin postérieur. Ici, il se forme devant l'œsophage (nerf gauche) et derrière lui (nerf droit) par ramifications et connexions entre branches plexus nerveux œsophagien,plexus oesophagien qui est à proximité hiatus le diaphragme forme 2 troncs vagues : antérieur, tronc vagalis antérieur, et à l'arrière, tronc vagalis postérieur, par conséquent
affectant les nerfs vagues gauche et droit. Les deux troncs sortent de la cavité thoracique par l'ouverture œsophagienne, donnent des branches à l'estomac et se terminent par un certain nombre de branches terminales en plexus coeliaque. A partir du plexus, les fibres du nerf vague se propagent le long des branches de ce plexus. Sur toute la longueur du nerf vague, des branches en partent (Fig. 246).
Branches du nerf vague cérébral :
1. branche méningée,r. méningée, part du nœud supérieur et traverse le foramen jugulaire pour atteindre la dure-mère de la fosse postérieure du crâne.
2. branche d'oreille,r. auriculaire, va du nœud supérieur le long de la surface antérolatérale du bulbe de la veine jugulaire jusqu'à l'entrée du canal mastoïde et plus loin le long de celui-ci jusqu'à la paroi postérieure du conduit auditif externe et une partie de la peau de l'oreillette. Sur son chemin, il forme des branches de liaison avec les nerfs glossopharyngé et facial.
Branches du nerf vague cervical :
1. Branches pharyngées,rr. pharyngé, proviennent du nœud inférieur ou immédiatement en dessous. Ils reçoivent de fines branches du ganglion cervical supérieur du tronc sympathique et, entre les artères carotides externe et interne, pénètrent jusqu'à la paroi latérale du pharynx, sur laquelle, avec les branches pharyngées du nerf glossopharyngé et du tronc sympathique, ils forment le plexus pharyngé.
2. nerf laryngé supérieur,n. laryngé supérieur, se divise à partir du nœud inférieur et descend vers le bas et vers l'avant le long de la paroi latérale du pharynx, en dedans de l'artère carotide interne. Au niveau de la grande corne, l'os hyoïde est divisé en deux branches : la externe, r. externe, et interne r. interne. La branche externe se connecte aux branches du ganglion cervical supérieur du tronc sympathique et longe le bord postérieur du cartilage thyroïde jusqu'au muscle cricothyroïdien et au constricteur inférieur du pharynx, et donne également par intermittence des branches aux muscles aryténoïdes et crico-aryténoïdes latéraux. De plus, des branches s'étendent jusqu'à la membrane muqueuse du pharynx et de la glande thyroïde. La branche interne est plus épaisse, plus sensible, perce la membrane thyrohyoïdienne et se ramifie dans la muqueuse du larynx au-dessus de la glotte, ainsi que dans la muqueuse de l'épiglotte et la paroi antérieure du pharynx nasal. Forme une branche de connexion avec le nerf laryngé inférieur.
3. Branches cardiaques cervicales supérieures,rr. cardiaques cervicales supérieures, - Les branches, d'épaisseur et de niveau variables, sont généralement fines, naissent entre les nerfs laryngés supérieur et récurrent et descendent jusqu'au plexus nerveux cervicothoracique.

Riz. 246. Nerfs vagues et glossopharyngés et tronc sympathique. 1 - branches cardiaques cervicales inférieures du nerf vague ; 2 - nerf laryngé récurrent ; 3 - branches cardiaques cervicales supérieures ; 4 - plexus pharyngé ; 5 - nerf hypoglosse ; 6 - nerf laryngé supérieur ; 7 - nerf lingual ; 8 - branches pharyngées du nerf vague; 9 - nerf glossopharyngé; 10, 11 - branches du nerf accessoire ; 12, 15, 17, 19 - 2e, 3e, 4e et 5e nerfs spinaux cervicaux ; 13 - nœud cervical supérieur du tronc sympathique ; 14, 16 - nerf vague ; 18 - nerf phrénique ; 20 - nœud cervical moyen du tronc sympathique ; 21 - plexus brachial; 22 - nœud cervical inférieur du tronc sympathique ; 23, 24, 26, 28 - 2e, 3e, 4e et 5e nœuds thoraciques du tronc sympathique ; 25 - nerf laryngé récurrent; 27 - plexus pulmonaire.
4. Branches cardiaques cervicales inférieures,rr. cardiaques cervicales inférieures, partir du nerf récurrent laryngé et du tronc du nerf vague ; participer à la formation du plexus nerveux cervicothoracique.
Branches thoracique nerf vague:
1. Nerf laryngé récurrent,n. le larynx récidive, naît du nerf vague lorsqu’il pénètre dans la cavité thoracique. Le nerf laryngé récurrent droit s'incurve vers le bas et vers l'arrière. artère sous-clavière, et celui de gauche est la crosse aortique. Les deux nerfs montent dans le sillon situé entre l’œsophage et la trachée, donnant des branches à ces organes. Branche finale - nerf laryngé inférieur,n. laryngé inférieur, se rapproche du larynx et innerve tous les muscles du larynx, à l'exception de la cricothyroïde et de la membrane muqueuse du larynx située sous les cordes vocales.
Les branches du nerf laryngé récurrent s'étendent jusqu'à la trachée, l'œsophage, la thyroïde et les glandes parathyroïdes.
2. Branches cardiaques thoraciquesrr. coeurs thoraciques commencer par les nerfs récurrents vague et laryngé gauche ; participer à la formation du plexus cervicothoracique.
3. Branches trachéales allez à la trachée thoracique.
4. Branches bronchiques sont dirigés vers les bronches.
5. Branches œsophagiennes approcher l’œsophage thoracique.
6. Branches péricardiques innerver le péricarde.
Dans les cavités du cou et de la poitrine, les branches des troncs vagues, récurrents et sympathiques forment le plexus nerveux cervicothoracique, qui comprend les plexus organiques suivants : thyroïdienne, trachéale, œsophagienne, pulmonaire, cardiaque.
Branches des troncs vagues (partie ventrale) :
1. Branches gastriques antérieures partir du tronc antérieur et former le plexus gastrique antérieur sur la face antérieure de l'estomac.
2. Branches gastriques postérieures proviennent du tronc postérieur et forment le plexus gastrique postérieur.
3. Branches coeliaques Ils naissent principalement du tronc postérieur et participent à la formation du plexus coeliaque.
4. Branches hépatiques font partie du plexus hépatique.
5. Branches rénales former des plexus rénaux.
XI PAIRE - NERVE ACCESSOIRE
nerf accessoire,n. accessorius, principalement moteur, séparé au cours du développement du nerf vague. Commence
en deux parties - le vague et la moelle épinière - à partir des noyaux moteurs correspondants de la moelle allongée et de la moelle épinière. Les fibres afférentes pénètrent dans le tronc par la partie vertébrale à partir des cellules des nœuds sensoriels.
La partie errante sort racines crâniennes,Radices crâniennes,à partir de la moelle allongée, sous la sortie du nerf vague, la partie vertébrale est formée de racines vertébrales,les racines spinales,émergeant de la moelle épinière entre les racines dorsale et antérieure. La partie spinale du nerf s'élève jusqu'au foramen magnum, pénètre par celui-ci dans la cavité crânienne, où elle se connecte à la partie vague et forme le tronc commun du nerf.
Dans la cavité crânienne, le nerf accessoire se divise en deux branches : interne Et externe
1. Branche intérieurer. interne, se rapproche du nerf vague. Grâce à cette branche, les fibres nerveuses motrices sont incluses dans le nerf vague, qui le quittent par les nerfs laryngés. On peut supposer que les fibres sensorielles passent également dans le nerf vague et plus loin dans le nerf laryngé.
2. branche extérieure,r. externe, sort de la cavité crânienne par le foramen jugulaire jusqu'au cou et passe d'abord derrière le ventre postérieur du muscle digastrique, puis depuis l'intérieur du muscle sternocléidomastoïdien. Perforant la dernière, la branche extérieure descend et se termine en muscle trapèze. Des connexions conjonctives se forment entre les nerfs accessoires et cervicaux. Innerve les muscles sternocléidomastoïdiens et trapèzes.
XII PAIRE - NERF HYPOGLEUX
nerf hypoglosse,n. hypoglosse, principalement moteur, formé à la suite de la fusion de plusieurs nerfs segmentaires spinaux primaires innervant les muscles hypoglosses. Le nerf hypoglosse contient également d’autres types de fibres. Les fibres nerveuses sensorielles proviennent des cellules du ganglion inférieur du nerf vague et, éventuellement, des cellules des ganglions spinaux le long des branches de liaison entre les nerfs hypoglosse, vague et cervical. Les fibres sympathiques pénètrent dans le nerf hypoglosse le long de sa branche de connexion avec le nœud supérieur du tronc sympathique (Fig. 247).
Les fibres nerveuses qui composent le nerf hypoglosse s'étendent à partir de ses cellules noyau de moteur, situé dans la moelle oblongate. Le nerf en émerge entre la pyramide et l'olivier à plusieurs racines. Le tronc nerveux formé traverse le

Riz. 247. Nerf hypoglosse (schéma).
1 - fosse en forme de losange ; 2 - canal du nerf hypoglosse ; 3 - branches reliant les nerfs hypoglosses au nœud cervical supérieur du tronc sympathique et au nœud inférieur du nerf vague ; 4 - nerf hypoglosse ; 5, 6 - branches vers les muscles de la langue ; 7 - branches vers le muscle génio-hyoïdien ; 8 - os hyoïde; 9 - branche vers le muscle sterno-hyoïdien ; 10 - branches vers le muscle sterno-hyoïdien ; 11 - branches vers le muscle sternothyroïdien ; 12 - branche vers le muscle omohyoïdien ; 13 - veine jugulaire interne ; 14 - racine inférieure de l'anse hyoïde ; 15 - racine supérieure de l'anse hyoïde ; 16 - veine jugulaire interne ; 17 - artère carotide interne ; 18 - 1er et 3ème nerfs spinaux cervicaux ; 19 - noyau du nerf hypoglosse.
le canal lingual jusqu'au cou, où il se situe d'abord entre les artères carotides externe (extérieure) et interne, puis descend sous le ventre postérieur du muscle digastrique sous la forme d'un arc ouvert vers le haut le long de la surface latérale du muscle hyoglosse , constituant le côté supérieur du triangle de Pirogov ; branche dans le terminal branches linguales,rr. linguistiques, muscles innervants de la langue.
Du milieu de l'arc nerveux descend le long de l'artère carotide commune racine supérieure de l'anse cervicale,base supérieure qui se connecte avec elle colonne vertébrale inférieurebase inférieure, du plexus cervical, entraînant la formation boucle de cou,anse cervicale. Plusieurs branches s'étendent de l'anse cervicale jusqu'aux muscles du cou situés sous l'os hyoïde.
La position du nerf hypoglosse dans le cou peut varier. Chez les personnes au cou long, l'arc formé par le nerf est relativement bas, tandis que chez les personnes au cou court, il est haut. Ceci est important à prendre en compte lors des opérations nerveuses (Tableau 15).
Tableau 15. Zones d'innervation, composition des fibres et noms des noyaux des nerfs crâniens

Suite du tableau. 15

Fin de tableau. 15

QUESTIONS POUR LA Maîtrise de soi
1. Quels nerfs proviennent du ganglion vestibulaire ?
2. Énumérez les branches du nerf glossopharyngé.
3. Quelles branches naissent des parties cérébrales et cervicales du nerf vague ? Qu’est-ce qu’ils innervent ?
4. Énumérez les branches du nerf vague thoracique et abdominal. Qu’est-ce qu’ils innervent ?
5. Qu'innervent les nerfs accessoire et hypoglosse ?
Les nerfs issus du tronc cérébral sont appelés nerfs crâniens (crâniens). Chaque nerf crânien, émergeant à la base du cerveau, est dirigé vers une ouverture spécifique du crâne, par laquelle il sort de sa cavité. Avant de sortir de la cavité crânienne, les nerfs crâniens sont accompagnés des méninges. Les humains possèdent 12 paires de nerfs crâniens :
je fais la paire- nerf olfactif (lat. nervus olfactorius)
IIe paire- nerf optique (lat. nervus opticus)
III paire
- nerf oculomoteur (lat. nervus oculomotorius)
Paire IV- nerf trochléaire (lat. nervus trochlearis)
V paire- nerf trijumeau (lat. nerf trijumeau)
VI paire- nerf abducens (lat. nervus abducens)
VIIe paire- nerf facial (lat. nervus facialis)
VIIIe paire- nerf vestibulocochléaire (lat. nervus vestibulocochlearis)
IXe paire- nerf glossopharyngé (lat. nervus glossopharyngeus)
X paire- nerf vague (lat. nerf vague)
XIe paire- nerf accessoire (lat. nervus accessorius)
XIIe paire- nerf hypoglosse (lat. nerf hypoglosse)
Certains de ces nerfs sont mixtes, c'est-à-dire contiennent simultanément des fibres nerveuses motrices, sensorielles et autonomes (III, V, VIII, IX, X), d'autres - exclusivement motrices (paires VI, IV, XI et XII) ou des nerfs purement sensoriels (paires I, II, VIII).
Pour mieux mémoriser les noms de ces nerfs, les comptines suivantes sont proposées :
Sentez, bougez les yeux, enlevez le bloc trijumeau, le visage, l’ouïe, la langue et la gorge, ne parcourez pas le monde, ajoutez-le sous vos langues.
Je fais la paire – Nerf olfactif, n. olfactif (sensible)
Commence à partir de récepteurs olfactifs la membrane muqueuse de la cavité nasale, dont les processus, sous la forme de 15 à 20 filaments nerveux, pénètrent à travers la plaque perforée de l'os ethmoïde dans la cavité crânienne, où ils pénètrent dans les bulbes olfactifs, d'où partent les voies olfactives, direction les triangles olfactifs ; à partir d'eux, les fibres du nerf olfactif traversent la substance perforée antérieure et atteignent les centres olfactifs du cortex cérébral, situés dans la partie antérieure des lobes temporaux.
II paire – Nerf optique, n. opticus (sensible)
Cela commence par des processus de cellules sensibles de la rétine dans la zone de la tache aveugle et pénètre de l'orbite dans la cavité crânienne par le canal du nerf optique. A la base du cerveau, les nerfs optiques droit et gauche se rejoignent et forment un chiasma optique incomplet, c'est-à-dire la partie médiale des fibres de chaque nerf passe du côté opposé, où elle se connecte aux fibres de la partie latérale et forme le tractus optique.
Ainsi, le tractus optique droit contient des fibres provenant de moitié droite rétines des deux yeux et celle de gauche - de la moitié gauche de la rétine des deux yeux. Chaque tractus optique s'incurve autour du pédoncule cérébral du côté latéral et atteint les centres visuels sous-corticaux situés dans le corps géniculé latéral et le coussin thalamique. diencéphale, ainsi que dans les colliculi supérieurs du mésencéphale. Les fibres provenant de ces centres sous-corticaux sont dirigées vers le centre visuel du cortex, situé dans le lobe occipital des hémisphères.
III paire – Nerf oculomoteur, n. oculomoteur (mixte)
Il part des noyaux du mésencéphale, situés au fond de l'aqueduc cérébral. Ses racines s'étendent jusqu'à la base du cerveau depuis la face médiale des pédoncules cérébraux dans la fosse interpédonculaire. Ensuite, le nerf oculomoteur pénètre par la fissure orbitaire supérieure dans l'orbite, se divisant en 2 branches :
A) branche supérieure - innerve le muscle droit supérieur de l'œil et le muscle qui soulève la paupière supérieure ;
B) branche inférieure - contient des fibres motrices innervant les muscles droits inférieur et médial et les muscles obliques inférieurs de l'œil. De plus, les fibres parasympathiques s'étendent de la branche inférieure jusqu'au ganglion ciliaire, ce qui donne des branches végétatives au muscle qui contracte la pupille et au muscle ciliaire (augmente la convexité du cristallin).
Paire IV – Nerf trochléaire, n. trochléaire (moteur)
Il part des noyaux du mésencéphale, situés au fond de l'aqueduc cérébral. Ses racines s'enroulent autour du pédoncule cérébral depuis le côté latéral, pénètrent dans l'orbite par la fissure orbitaire supérieure et innervent le muscle oblique supérieur de l'œil.
Paire V – Nerf trijumeau, n. tridème (mixte)
Le plus épais de tous les nerfs crâniens. Il part des noyaux du pont, émergeant sur sa surface latérale avec des racines motrices plus épaisses, sensibles et plus fines. Les deux racines sont dirigées vers la surface antérieure de la pyramide de l'os temporal, où la racine sensorielle forme un épaississement - le ganglion trijumeau (un groupe de corps de neurones sensoriels) d'où partent les fibres sensorielles des trois branches du nerf trijumeau. La racine motrice contourne le ganglion trijumeau par l’intérieur et rejoint la troisième branche du nerf trijumeau. De plus, chemin faisant, des fibres parasympathiques rejoignent chacune des branches.
Branches du nerf trijumeau :
1) Première branche nerf trijumeau – nerf optique – quitte le crâne par la fissure orbitaire supérieure et pénètre dans l'orbite, où il se divise en 3 branches principales :
A) Nerf frontal - longe la paroi supérieure de l'orbite jusqu'à os frontal et innerve la peau du front, la racine du nez, la peau et la conjonctive de la paupière supérieure, et se connecte également à la branche parasympathique, qui innerve le sac lacrymal.
B) Nerf lacrymal - longe la paroi latérale de l'orbite et innerve la peau du coin externe de l'œil et de la paupière supérieure. Sur son chemin, le nerf lacrymal se connecte à la branche parasympathique du ganglion ciliaire et innerve la glande lacrymale.
C) Nerf nasociliaire - longe la paroi interne de l'orbite, donnant des branches à la membrane muqueuse des sinus frontaux, sphénoïdaux, ethmoïdaux, à la peau et à la membrane muqueuse du nez, à la sclérotique et à la choroïde du globe oculaire, et se connecte également au parasympathique branche du ganglion ciliaire, qui innerve le sac lacrymal.
2) Deuxième branche nerf trijumeau - nerf maxillaire. Il quitte la cavité crânienne par le foramen rotundum et pénètre dans la fosse ptérygopalatine, où il se divise en :
A) Nerf sous-orbitaire - de la fosse ptérygopalatine à travers la fissure orbitaire inférieure pénètre dans la cavité de l'orbite, puis à travers le canal sous-orbitaire il sort vers la surface antérieure de la mâchoire supérieure, dégageant des branches pour innerver la peau de la paupière inférieure, la paroi latérale du nez, le sinus maxillaire, la lèvre supérieure, les dents et les gencives de la mâchoire supérieure.
B) Nerf zygomatique - depuis la fosse ptérygopalatine, il pénètre avec le nerf infra-orbitaire à travers la fissure orbitaire inférieure jusqu'à l'orbite, dégageant une branche avec des fibres parasympathiques le long du chemin menant à la glande lacrymale. Ensuite, le nerf zygomatique pénètre dans le foramen orbitaire zygomatique et se divise en branches qui innervent la peau des zones temporale, zygomatique et buccale.
B) Nerf ptérygopalatin - donne des branches au nœud ptérygopalatin, ainsi qu'à la membrane muqueuse de la cavité nasale, du palais dur et mou.
3) Troisième branche du nerf trijumeau– nerf mandibulaire – est formé par une branche sensible s'étendant du ganglion trijumeau, à laquelle se joint la racine motrice du nerf trijumeau. Le nerf mandibulaire sort du crâne par le foramen ovale. Ses branches motrices innervent les muscles de la mastication, le muscle tenseur palatin et le muscle tenseur du tympan.
Les branches sensorielles du nerf mandibulaire comprennent :
A) Linguel - innerve la membrane muqueuse de la cavité buccale et les papilles gustatives des deux tiers antérieurs de la langue, les amygdales palatines, et contient également des fibres parasympathiques allant aux glandes salivaires sous-maxillaires et sublinguales.
B) Nerf alvéolaire inférieur (alvéolaire) - donne des branches aux dents et aux gencives de la mâchoire inférieure, à la peau du menton et de la lèvre inférieure.
B) Buccal – peau et muqueuses de la joue et du coin de la bouche.
D) Nerf auriculotemporal - la peau de la région temporale, de l'oreillette, du conduit auditif externe, du tympan et contient également des fibres parasympathiques allant à la glande salivaire parotide.
Paire VI – Nerf Abducens, n. abducens (moteur)
Il part des noyaux pontiques situés dans la zone du triangle supérieur de la fosse rhomboïde. Ses racines s'étendent jusqu'à la base du cerveau dans le sillon situé entre le pont et la pyramide de la moelle allongée. Il quitte la cavité crânienne par la fissure orbitaire supérieure et, en pénétrant dans l'orbite, innerve le muscle droit latéral de l'œil.
VII paire – Nerf facial, n. facialis (mixte)
Il part des noyaux pontiques situés dans la zone du triangle supérieur de la fosse rhomboïde. Ses racines émergent dans le sillon entre le pont et la moelle allongée et sont dirigées vers le conduit auditif interne, situé dans la pyramide de l'os temporal. Le nerf facial quitte la cavité crânienne par le foramen stylomastoïdien. À l’intérieur de la pyramide, un certain nombre de branches partent du nerf facial :
A) Nerf grand pétreux - donne des fibres parasympathiques à la glande lacrymale et au ganglion alaire-palatin.
B) Cordon tympanique - comprend les fibres sensorielles allant aux papilles gustatives des 2/3 antérieurs de la langue, ainsi que les fibres parasympathiques allant aux glandes salivaires sous-maxillaires et sublinguales.
B) Nerf stapédique - se compose de fibres motrices qui innervent le muscle stapédique.
Ayant quitté la pyramide de l'os temporal par le foramen stylomastoïdien, le nerf facial pénètre dans la glande salivaire parotide et donne un grand nombre de branches motrices innervant les muscles du visage, ainsi que le muscle sous-cutané du cou.
VIII paire – nerf vestibulocochléaire, n. veslibulocochlearis (sensible) part des noyaux du pont dans la région du triangle supérieur de la fosse rhomboïde et s'étend jusqu'à la base du cerveau avec des racines dans le sillon entre le pont et la moelle allongée. Ensuite, il est envoyé dans le conduit auditif interne de la pyramide de l'os temporal, où il est divisé en 2 parties :
A) Nerf du vestibule - se termine par des récepteurs dans les canaux semi-circulaires du labyrinthe membraneux de l'oreille interne et régule l'équilibre du corps.
B) Nerf cochléaire - se termine dans l'organe spiral (corti) de la cochlée et est responsable de la transmission vibrations sonores(audience).
Paire IX – Nerf glossopharyngé, n. glossopharyngeus (mixte)
Il part des noyaux de la moelle allongée dans la région du triangle supérieur de la fosse rhomboïde. Ses racines émergent dans le sillon latéral postérieur derrière les olives de la moelle allongée. Quitte la cavité crânienne par le foramen jugulaire. Les branches sensorielles du nerf glossopharyngé comprennent :
A) Linguel – innerve Papilles gustatives tiers postérieur de la langue.
B) Tympanique - innerve la membrane muqueuse de la cavité tympanique et de la trompe d'Eustache.
B) Amygdale - innerve les arcs palatins et les amygdales.
Les branches parasympathiques comprennent le petit nerf pétreux - il innerve la glande salivaire parotide. Les branches motrices du nerf glossopharyngé innervent les muscles du pharynx.
Paire X – Nerf vague, n. vague (mixte)
C'est le plus long des nerfs crâniens. Il part des noyaux du bulbe rachidien, émerge avec des racines derrière les olives du bulbe rachidien et se dirige vers le foramen jugulaire. Le nerf vague contient des fibres sensorielles, motrices et parasympathiques et possède une très grande zone d'innervation. Topographiquement, le nerf vague peut être divisé en sections céphalique, cervicale, thoracique et abdominale. Les branches s'étendent de la division céphalique du nerf vague jusqu'à coquille dure cerveau, peau du pavillon de l'oreille et du conduit auditif externe.
De la région cervicale - branches jusqu'au pharynx, à l'œsophage, au larynx, à la trachée et au cœur ;
De la région thoracique - à l'œsophage, aux bronches, aux poumons, au cœur ;
De la région abdominale jusqu'à l'estomac, le pancréas, l'intestin grêle et le gros intestin, le foie, la rate et les reins.
Paire XI – Nerf accessoire, n. accessoire (moteur)
Un noyau du nerf accessoire - cérébral - est situé dans la moelle oblongate et l'autre - spinal - dans les cornes antérieures matière grise moelle épinière dans les 5 à 6 segments cervicaux supérieurs. Au niveau du foramen magnum, les racines crâniennes et spinales se confondent en un tronc commun du nerf accessoire qui, en entrant dans le foramen jugulaire, se divise en 2 branches. L'un d'eux fusionne avec le nerf vague et l'autre assure l'innervation des muscles sternocléidomastoïdien et trapèze.
Paire XII – Nerf hypoglosse, n. hypoglosse (moteur)
Il part des noyaux de la moelle allongée et émerge avec des racines dans le sillon situé entre la pyramide et l'olivier. Quitte la cavité crânienne par le canal nerveux hypoglosse. Innerve tous les muscles de la langue et certains muscles du cou.
Comment trouver les 12 nerfs crâniens ?
1.
n.olfactorius - olfactif (dans les foramens cribrosa). Les filaments nerveux (fila olfactoria) s'approchent des bulbes olfactifs (bulbi olfactorii) depuis la cavité nasale par les ouvertures de l'os ethmoïde, qui forment le nerf. Ils continuent ensuite dans le tractus olfactif (tractus olfactorii). Le nerf se trouve dans le sillon olfactif.
2.
n.opticus - visuel (dans canalis opticus). Sort de l’orbite dans la cavité crânienne par le canal optique. Les deux nerfs forment un chiasma optique. Tractus opticus dexter contient des fibres provenant des moitiés droites des deux rétines et tr.opticus sinistre - des moitiés gauches. En fait, ce nerf est une excroissance des méninges.
3.
n.oculomotorius - oculomoteur (dans la fissura orbitalis supérieure). Derrière les corps mastoïdes (corpora mamillaria) se trouve la fosse interpédonculaire (fossa interpeduncularis). Le fond de la fosse est percé d'ouvertures pour les vaisseaux sanguins (substantia perforata postérieure). Le nerf sort à côté de cette substance dans la région de la surface médiale du pédoncule cérébral (pedunculi cerebri).
4.
n.trochlearis - trochlée (dans la fissura orbitalis supérieure). Il va du côté des pédoncules cérébraux. Le seul nerf crânien qui naît du cerveau sur sa face postérieure, du voile médullaire supérieur.
5.
n.trigeminus - trijumeau.
(1). n.ophtalmicus - ophtalmique (dans la fissura orbitalis supérieure)
(2). n.maxillaris - maxillaire (dans le foramen rotundum)
(3). n.mandibularis - mandibulaire (dans le foramen ovale).
Derrière les pédoncules cérébraux se trouve le pont qui plonge dans le cervelet. Les parties latérales du pont sont appelées pédoncules cérébelleux moyens (pedunculi cerebralles medii). Un nerf émerge à la frontière entre eux et le pont.
6.
n.abducens - abducens (dans la fissura orbitalis supérieure). Entre le pont et la moelle allongée.
7. n.facialis - facial (dans le porus acusticus internus). Il émerge de la base du cerveau, au bord postérieur du pont, au-dessus de la moelle oblongue olive.
8.
n.vestibulocochlearis - vestibulocochlearis (dans porus acusticus internus). Pénètre dans l'épaisseur de la moelle allongée, médialement à partir des pédoncules cérébelleux inférieurs. Il passe directement à côté de la 7ème paire de nerfs crâniens.
9.
n.glossopharyngeus - glossopharyngeus (dans le foramen jugulaire). Il émerge d'une rainure derrière l'olive. Avec les 10e et 11e paires de nerfs crâniens, ils forment le groupe vagal.
10.
n.vagus - errant (dans le foramen jugulaire). Il émerge d'une rainure derrière l'olive.
11.
n.accessorius - supplémentaire (dans le foramen jugulaire). Il émerge d'une rainure derrière l'olive.
12.
n.hypoglosseus - sublingual (dans le canal hypoglosseus). Entre la pyramide et l'olive de la moelle oblongate.
Fonctions des nerfs crâniens
1. Nerf olfactif (lat. nerfs olfactifs) est le premier des nerfs crâniens responsables de la sensibilité olfactive.
2. Nerf optique (lat. nerf optique) - la deuxième paire de nerfs crâniens par lesquels les stimuli visuels perçus par les cellules sensibles de la rétine sont transmis au cerveau.
3. Nerf oculomoteur (lat. nerf oculomoteur) - III paire de nerfs crâniens, responsables du mouvement du globe oculaire, de l'élévation de la paupière et de la réaction des pupilles à la lumière.
4. Nerf trochléaire (lat. nerf trochléaire) - IV paire de nerfs crâniens, qui innervent le muscle oblique supérieur (lat. m.obliquus supérieur), qui fait tourner le globe oculaire vers l'extérieur et vers le bas.
5. Nerf trijumeau est mixte. Ses trois branches (ramus ophtalmicus - V1, ramus maxillaris - V2, ramus mandibularis - V3) à travers le ganglion gassérien (ganglion trijumeau) transportent respectivement les informations des tiers supérieur, moyen et inférieur du visage. Chaque branche transporte les informations provenant des muscles, de la peau et des récepteurs de la douleur de chaque tiers du visage. Dans le nœud gasérien, les informations sont triées par type et les informations provenant des muscles de tout le visage vont au noyau sensible du nerf trijumeau, situé principalement dans le mésencéphale (pénétre partiellement dans le pont) ; les informations cutanées de l'ensemble du visage vont au « noyau principal » (nucleus pontinus nervi trigemini), situé dans le pont ; et la sensibilité à la douleur se situe dans le noyau spinalis nervi trigemini, venant du pont en passant par la moelle oblongate jusqu'à la moelle épinière.
Le nerf trijumeau appartient également au noyau moteur (lat. nucleus motorius nervi trigemini), qui se trouve dans le pont et est responsable de l'innervation des muscles masticateurs.
6. Nerf Abducens (lat. nerf abducens) - VI paire de nerfs crâniens, qui innerve le muscle droit latéral (lat. m. rectus lateralis) et est responsable de l'abduction du globe oculaire.
7. Nerf facial (lat. nerf facial), le septième (VII) des douze nerfs crâniens, sort du cerveau entre le pont et la moelle allongée. Le nerf facial innerve les muscles du visage. Le nerf facial comprend également le nerf intermédiaire, responsable de l'innervation de la glande lacrymale, du muscle stapédien et de la sensibilité gustative des deux tiers antérieurs de la langue.
8. Nerf vestibulocochléaire (lat. nerf vestibulocochléaire) - un nerf d'une sensibilité particulière responsable de la transmission des impulsions auditives et des impulsions émanant de la partie vestibulaire de l'oreille interne.
9. Nerf glossopharyngé (lat. nerf glossopharyngé) - IX paire de nerfs crâniens. Est mixte. Fournit :
1) innervation motrice du muscle stylopharyngé (lat. m. stylopharyngeus), releveur du pharynx
2) innervation glande parotide(lat. glandula parotidea) assurant sa fonction sécrétoire
3) sensibilité générale du pharynx, des amygdales, du palais mou, de la trompe d'Eustache, de la cavité tympanique
4) sensibilité gustative du tiers postérieur de la langue.
10. Nerf vague (lat. n.vagus) - X paire de nerfs crâniens. Est mixte. Fournit :
1) innervation motrice des muscles du palais mou, du pharynx, du larynx, ainsi que des muscles striés de l'œsophage
2) innervation parasympathique des muscles lisses des poumons, de l'œsophage, de l'estomac et des intestins (jusqu'à l'angle splénique du côlon), ainsi que des muscles du cœur. Affecte également la sécrétion des glandes de l'estomac et du pancréas
3) innervation sensible de la membrane muqueuse de la partie inférieure du pharynx et du larynx, de la peau derrière l'oreille et d'une partie du conduit auditif externe, du tympan et de la dure-mère de la fosse crânienne postérieure.
Le noyau dorsal du nerf vague, noyau dorsalis nervi vagi, est situé dans la moelle allongée, latéralement au noyau du nerf hypoglosse.
11. Nerf accessoire (lat. nerf accessoire) - XI paire de nerfs crâniens. Contient des fibres nerveuses motrices qui innervent les muscles responsables de la rotation de la tête, de l'élévation de l'épaule et de l'adduction de l'omoplate à la colonne vertébrale.
12. Nerf hypoglosse (lat. nerf hypoglosse) - XII paire de nerfs crâniens. Responsable du mouvement de la langue.
Introduction.
Conférence n°49.
Sujet : « Caractéristiques de 1 à 12 paires de nerfs crâniens. Leur fonction."
Plan:
Système nerveux périphérique
Le système nerveux périphérique est formé de nerfs spinaux et crâniens, ainsi que de ganglions, de terminaisons nerveuses, de récepteurs (sensibles) et d'effecteurs.
Selon la localisation, l'origine des nerfs et les ganglions nerveux qui leur sont associés, on distingue les nerfs crâniens et spinaux.
Nerfs crâniens
12 paires de nerfs crâniens proviennent du tronc cérébral. Chaque paire de nerfs crâniens possède son propre nom et son propre numéro de série, indiqués par des chiffres romains. Il existe trois groupes de nerfs crâniens : sensoriels, moteurs et mixtes.
Les nerfs sensoriels comprennent les nerfs crâniens olfactifs (I paire de nerfs crâniens), optiques (II paire) et vestibulocochléaires (VIII paire) |
Les nerfs crâniens moteurs sont le nerf oculomoteur | paire), trochléaire (paire IV), abducens (paire VI), nerfs accessoires (paire XI), nerfs hypoglosses (paire XII).
Les nerfs crâniens mixtes sont les nerfs trijumeau, facial, glossopharyngé et vague.
Nerfs olfactifs(nervi olfactorii) sont constitués de processus centraux de cellules sensibles (réceptrices) situées dans la membrane muqueuse de la région olfactive de la cavité nasale. Les nerfs olfactifs au nombre de 15 à 20 filaments (nerfs) pénètrent dans la cavité crânienne par la plaque criblée de la paroi supérieure de la cavité nasale et se terminent au deuxième neurone des bulbes olfactifs. De là, les impulsions olfactives sont transmises le long du tractus olfactif et d'autres formations du cerveau olfactif jusqu'aux hémisphères cérébraux.
Nerf optique(nervus opticus) est formé par des processus de cellules nerveuses de la rétine de l'œil. Le nerf quitte l'orbite dans la cavité crânienne par le canal corporel et, devant la selle turcique, forme un chiasma (incomplet) des nerfs optiques. Les fibres nerveuses provenant de la partie médiale (« nasale ») de la rétine se croisent (passent de l’autre côté). Ainsi, les voies optiques s'étendant à partir du chiasma optique contiennent des fibres provenant de la partie latérale de la rétine de l'œil de leur côté et de la partie médiale de la rétine du côté opposé. Chaque tractus optique se dirige vers le corps géniculé latéral puis vers le colliculus supérieur de la plaque quadrijumeau, qui sont des centres visuels sous-corticaux.
Nerf oculomoteur(n. oculomotorius) est constitué de fibres motrices et parasympathiques émergeant des noyaux accessoires moteurs et autonomes situés dans le mésencéphale sous l'aqueduc cérébral au niveau des colliculi supérieurs (antérieurs). Ce nerf passe dans l’orbite par la fissure orbitaire supérieure. Les fibres motrices innervent les muscles du globe oculaire : supérieur, inférieur et médial, droit, oblique inférieur ainsi que le muscle qui soulève la paupière supérieure. Les fibres parasympathiques se terminent sur les cellules du ganglion ciliaire dont les processus (fibres) suivent le muscle qui contracte la pupille et le muscle ciliaire du globe oculaire.
Nerf trochléaire(n. trochlearis) part du noyau moteur, qui se trouve également dans le mésencéphale sous l'aqueduc cérébral, au niveau des colliculi inférieurs (postérieurs). Le nerf passe dans l’orbite par la fissure orbitaire supérieure et innerve le muscle oblique supérieur de l’œil.
Nerf trijumeau(n. trigeminus) quitte le pont avec deux racines : sensible (plus grande) et motrice (plus petite). La racine motrice contient des processus de cellules du noyau moteur du nerf trijumeau. Les fibres sensorielles sont les processus centraux des cellules situées dans le ganglion trijumeau, situé au sommet de la pyramide de l'os temporal. Les fibres motrices contiennent des processus de cellules du noyau moteur du nerf trijumeau.
Les processus périphériques de ces cellules forment trois branches du nerf trijumeau : la première, la deuxième et la troisième. Les deux premières branches sont sensibles dans leur composition, la troisième branche est mixte, puisqu'elle comprend des fibres sensorielles et motrices.
La première branche, le nerf ophtalmique, passe dans l'orbite par la fissure orbitaire supérieure, où elle se divise en trois branches : les nerfs lacrymal, frontal et nasociliaire. Les branches de ces nerfs innervent le globe oculaire, la paupière supérieure, la peau du front, la membrane muqueuse de la partie antérieure de la cavité nasale, les sinus frontaux, sphénoïdaux et les cellules de l'os ethmoïde.
La deuxième branche, le nerf maxillaire, traverse la rotonde du foramen dans la fosse ptérygopalatine, où elle dégage les nerfs infra-orbitaux et zygomatiques, ainsi que des branches nodales se dirigeant vers le nœud ptérygopalatin. Les branches des nerfs infraorbitaires et zygomatiques innervent la membrane muqueuse de la cavité nasale, le palais dur et mou, la peau de la région zygomatique et de la paupière inférieure, la peau du nez et de la lèvre supérieure, les dents de la mâchoire supérieure et la peau du nez et de la lèvre supérieure. dure-mère du cerveau dans la zone de la fosse crânienne moyenne. Dans la fosse ptérygopalatine, le ganglion ptérygopalatin parasympathique est adjacent au nerf maxillaire. Les processus des cellules de ce nœud parasympathique, faisant partie des branches du nerf maxillaire, se dirigent vers les glandes de la membrane muqueuse des cavités nasale et buccale, ainsi que dans l'orbite de la glande lacrymale.
La troisième branche, le nerf mandibulaire, quitte la cavité crânienne par le foramen ovale et est divisée en un certain nombre de branches : les nerfs auriculotemporal, buccal, lingual et alvéolaire inférieur, et donne également des branches à la dure-mère du cerveau au milieu. fosse crânienne. Les branches motrices du nerf mandibulaire se rapprochent des muscles masséters, ptérygoïdiens temporaux, médiaux et latéraux (masséter), ainsi que du mylohyoïdien, ventre antérieur du muscle digastrique, du muscle tenseur du palais mou et du muscle tenseur du tympan. Le nerf auriculotemporal innerve la peau de la région temporale, de l'auricule et du conduit auditif externe. Il contient des fibres parasympathiques (du nerf glossopharyngé) jusqu'à la glande salivaire parotide. Le nerf buccal va jusqu'à la muqueuse buccale. Le nerf lingual innerve la muqueuse et les deux tiers antérieurs (2/3) de la langue. Le nerf lingual est rejoint par une corde irrégulière (venant du nerf facial), contenant des fibres gustatives et parasympathiques. Les fibres gustatives vont aux papilles gustatives de la langue et les fibres parasympathiques aux nœuds sous-maxillaires et sublinguaux, d'où sont innervées les glandes salivaires du même nom.
Le nerf alvéolaire inférieur pénètre dans le canal mandibulaire, innerve les dents et les gencives, puis sort du canal par le foramen mentonnier pour innerver la peau du menton.
nerf abducens(n. abducens) part du noyau moteur situé dans le tegmentum du pont. Le nerf passe dans l’orbite par la fissure orbitaire supérieure et innerve le muscle droit latéral de l’œil.
Nerf facial(n. facialis) contient des fibres motrices, sensorielles et autonomes (parasympathiques).
Les fibres motrices sont des processus du noyau moteur du nerf facial. Les cellules sensibles du nerf facial sont situées dans le canal facial, leurs processus centraux vont dans le pont et se terminent sur les cellules du noyau du tractus solitaire. Les processus périphériques participent à la formation du nerf facial et de ses branches. Les fibres parasympathiques sont des branches du noyau salivaire supérieur parasympathique. Tous les noyaux du nerf facial sont situés dans le pont. Le nerf facial pénètre par le méat auditif interne dans le canal du nerf facial.
Dans le canal, le nerf facial dégage le nerf grand pétreux, qui transporte les fibres parasympathiques jusqu'au ganglion ptérygoïdien, ainsi que le nerf stapédien et la corde tympanique. Le nerf grand pétreux sort du canal facial par le foramen du même nom sur la surface supérieure de la pyramide. Le nerf stapédien va au muscle du même nom, situé dans la cavité tympanique. La corde tympanique part du nerf facial à sa sortie du canal ; à la sortie de la cavité tympanique, la corde tympanique rejoint le nerf lingual. Il transporte les fibres gustatives jusqu'à la langue et les fibres parasympathiques pour innerver les glandes salivaires sous-maxillaires et sublinguales. Le nerf facial quitte le canal facial par le foramen stylomastoïdien, donne des branches au ventre occipital du muscle supracrânien, aux muscles auriculaires, puis perce la glande salivaire parotide et se divise en ses branches terminales, qui se rapprochent des muscles faciaux et du muscle sous-cutané de le cou.
Le nerf vestibulaire-cochléaire (n. vestibulocochlearis) est formé par la partie cochléaire qui conduit sensations auditives de l'organe spiral (Corti) de la cochlée et de la partie vestibulaire, qui conduit les sensations de l'appareil statique intégré dans le vestibule et les canaux semi-circulaires du labyrinthe membraneux de l'oreille interne. Les deux parties sont constituées de processus centraux de neurones bipolaires situés dans les nœuds vestibulaires et cochléaires. Les processus périphériques de ces cellules des ganglions vestibulaires et cochléaires forment des faisceaux qui se terminent par des récepteurs, respectivement, dans la partie vestibulaire du labyrinthe membraneux de l'oreille interne et dans l'organe spiral du canal cochléaire. Les processus centraux de ces cellules bipolaires sont dirigés vers les noyaux situés dans le tegmentum du pont à la frontière avec la moelle allongée.
Le nerf glossopharyngé (n. glossopharyngeus) contient des fibres motrices, sensorielles et parasympathiques. Ses noyaux, ainsi que les noyaux du nerf vague, sont situés dans la moelle allongée. Le nerf sort de la cavité crânienne par le foramen jugulaire. Les fibres motrices du nerf glossopharyngé sont des processus des cellules du double noyau (commun avec le nerf vague) et innervent les muscles du pharynx. Les corps des cellules sensibles forment les nœuds supérieurs et inférieurs. Les processus périphériques de ces cellules sont dirigés vers la membrane muqueuse du pharynx et le tiers postérieur de la langue. Les fibres parasympathiques du nerf glossopharyngé, émergeant du noyau salivaire inférieur, sont dirigées vers le ganglion de l'oreille.
Le nerf vague est le vague (n. vagus), le plus long des nerfs crâniens. Il contient des fibres motrices, sensorielles et parasympathiques, sort de la cavité crânienne par le foramen jugulaire ainsi que les nerfs glossopharyngés et accessoires et la veine jugulaire interne. Fibres moteur nerfs vagues innerver les muscles du palais mou, du pharynx et du larynx. Les fibres sensorielles forment les nœuds supérieur et inférieur du nerf vague. Ces fibres conduisent les impulsions sensibles provenant des organes internes, de l’oreille externe et de la dure-mère du cerveau dans la fosse crânienne postérieure.
Les fibres parasympathiques, qui sont des processus du noyau postérieur (dorsal) du nerf vague, innervent le cœur, les organes respiratoires, la rate, le foie, le pancréas, les reins, la majeure partie du système digestif jusqu'au côlon descendant. Dans la région du cou, le nerf vague est situé à côté de l'artère carotide commune et de la veine jugulaire interne et donne des branches au larynx, au pharynx, au cœur, à l'œsophage et à la trachée. Dans la région thoracique, les branches du nerf vague innervent le cœur, les poumons et l'œsophage. Dans la cavité abdominale, le nerf vague est divisé en troncs antérieur et postérieur. Le tronc vague antérieur passe de la face antérieure de l'œsophage à la face antérieure de l'estomac et innerve la paroi antérieure de l'estomac et du foie. Le tronc vague postérieur passe de l'œsophage à la paroi postérieure de l'estomac et l'innerve, et il dégage également des branches coeliaques qui vont à la formation du plexus coeliaque ainsi que des fibres sympathiques.
Le nerf accessoire (n. accessorius) est formé de plusieurs racines motrices émergeant des noyaux situés dans la moelle oblongate et dans les segments supérieurs de la moelle épinière. Le nerf sort du crâne par le foramen jugulaire (avec les nerfs glossopharyngé et vague) et innerve les muscles sternocléidomastoïdien et trapèze.
Le nerf hypoglosse (n. hypoglossus) possède un noyau moteur situé dans la moelle allongée. Les processus des cellules de ce noyau forment un nerf qui sort de la cavité crânienne par le canal du nerf hypoglosse et innerve les muscles de la langue. La racine supérieure s'écarte du nerf hypoglosse, qui se connecte à la racine inférieure du plexus cervical, entraînant la formation d'une anse cervicale qui innerve les muscles situés sous l'os hyoïde.
11.4.1. Caractéristiques générales des nerfs crâniens.
11.4.2. [-IV paires de nerfs crâniens.
11.4.3. Les branches principales des paires V-VIII de nerfs crâniens.
11.4.4. Zones d'innervation des paires IX-XII de nerfs crâniens.
OBJECTIF : Connaître le nom, la topographie des noyaux et les fonctions de douze paires de nerfs crâniens.
Représentent les zones d'innervation des nerfs crâniens.
Être capable de montrer sur le squelette de la tête où les nerfs crâniens sortent de la cavité crânienne.
11.4.1. Les nerfs crâniens (nervi crâniales, seu encephalici) sont des nerfs issus du tronc cérébral. Dans celui-ci, soit ils commencent à partir des noyaux correspondants, soit ils se terminent. Il existe 12 paires de nerfs crâniens. Chaque paire possède un numéro de série, indiqué par un chiffre romain, et un nom. Le numéro de série reflète la séquence de sortie nerveuse :
J'apparie - nerfs olfactifs (nervi olfactorii);
Et la paire est le nerf optique (nervus opticus) ;
III paire - nerf oculomoteur (nervus oculomotorius);
Paire IV - nerf trochléaire (nervus trochlearis);
Nerf trijumeau (nervus trijumeau);
Nerf abducens (nervus abducens);
Nerf facial (nervus facialis);
nerf vestibulaire-cochléaire (nervus vestibulocochlearis);
Nerf glossopharyngé (nervus glossopharyngeus);
Nerf vague (nervus vague);
Nerf accessoire (nervus accessorius);
Nerf hypoglosse (nervus hypoglosse).
En quittant le cerveau, les nerfs crâniens sont dirigés vers les ouvertures correspondantes à la base du crâne, à travers lesquelles ils quittent la cavité crânienne et se ramifient dans la tête, le cou et le nerf vague (paire X) également dans la poitrine et l'abdomen. caries.
Tous les nerfs crâniens varient en termes de composition et de fonction des fibres nerveuses. Contrairement aux nerfs spinaux, qui sont formés à partir des racines antérieures et postérieures, sont mélangés et seulement à la périphérie sont divisés en nerfs sensoriels et moteurs, les nerfs crâniens sont l'une de ces deux racines qui, dans la région de la tête, ne sont jamais réunies. Les nerfs olfactifs et optiques se développent à partir des excroissances de la vessie médullaire antérieure et sont des processus de cellules situées dans la membrane muqueuse de la cavité nasale (l'organe de l'odorat) ou dans la rétine de l'œil. Les nerfs sensoriels restants sont formés par l'expulsion de jeunes cellules nerveuses du cerveau en développement, dont les processus forment des nerfs sensoriels (par exemple, le nerf vestibulocochléaire) ou des fibres sensorielles (afférentes) de nerfs mixtes (nerfs trijumeau, facial, glossopharyngé, vague). ). Les nerfs crâniens moteurs (nerfs trochléaires, abducens, accessoires, hypoglosses) ont été formés à partir de fibres nerveuses motrices (efférentes), qui sont des processus des noyaux moteurs situés dans le tronc cérébral. Ainsi, certains nerfs crâniens sont sensibles : paires I, II, VIII, d'autres : paires III, IV, VI, XI et XII sont moteurs, et le troisième : paires V, VII, IX, X sont mixtes. Dans le cadre des paires de nerfs III, VII, IX et X, les fibres parasympathiques passent avec d'autres fibres nerveuses.
11.4.2. Je paire - nerfs olfactifs, sensibles, formés par de longs processus (axones) de cellules olfactives, situées dans la membrane muqueuse de la région olfactive de la cavité nasale. Un tronc nerveux les fibres nerveuses olfactives ne se forment pas, mais sont collectées sous la forme de 15 à 20 nerfs olfactifs minces (fils), qui traversent les ouvertures de la plaque criblée du même os, pénètrent dans le bulbe olfactif et entrent en contact avec les cellules mitrales (deuxième neurone ). Les axones des cellules mitrales dans l'épaisseur du tractus olfactif sont envoyés vers le triangle olfactif, puis dans le cadre du triangle latéral
les rayures se prolongent dans le gyrus parahippocampique et dans l'uncus, qui contient le centre cortical de l'odorat.
II paire - nerf optique, sensible, formé par les axones des cellules ganglionnaires de la rétine de l'œil. C'est un conducteur d'impulsions visuelles qui naissent dans les cellules photosensibles de l'œil : bâtonnets et cônes et sont d'abord transmises aux cellules bipolaires (neurocytes), et d'elles aux neurocytes ganglionnaires. Les processus des cellules ganglionnaires forment le nerf optique, qui depuis l'orbite jusqu'au canal optique l'os sphénoïde pénètre dans la cavité crânienne. Là, il forme immédiatement une décussation partielle - un chiasma avec le nerf optique du côté opposé et continue dans le tractus optique. Les voies visuelles se rapprochent des centres visuels sous-corticaux : les noyaux du corps géniculé latéral, les coussinets thalamiques et le colliculus supérieur du toit du mésencéphale. Les noyaux du colliculus supérieur sont reliés aux noyaux du nerf oculomoteur (le noyau parasympathique accessoire de N.M. Yakubovich - à travers lui, le réflexe de constriction pupillaire de la pupille en lumière vive et l'accommodation de l'œil sont réalisés) et avec les noyaux des cornes antérieures à travers le tractus tégnospinal (pour la mise en œuvre du réflexe indicatif d'une légère irritation soudaine). Des noyaux du corps géniculé latéral et des coussins thalamiques, les axones du 4ème neurone suivent jusqu'au lobe occipital du cortex (jusqu'au sulcus calcarin), où s'effectuent une analyse supérieure et une synthèse des perceptions visuelles.
Paire III - le nerf oculomoteur est constitué de fibres nerveuses parasympathiques somatiques et efférentes motrices. Ces fibres sont des axones du noyau moteur et du noyau parasympathique accessoire de N.M. Yakubovich, situés au bas de l'aqueduc cérébral - au niveau des collicules supérieurs du toit du mésencéphale. Le nerf sort de la cavité crânienne par la fissure orbitaire supérieure dans l'orbite et se divise en deux branches : supérieure et inférieure. Les fibres somatiques motrices de ces branches innervent les 5 muscles striés du globe oculaire : le droit supérieur, inférieur et médial, l'oblique inférieur et le muscle qui soulève la paupière supérieure, et les fibres parasympathiques - le muscle qui contracte la pupille et le ciliaire. , ou ciliaire, muscle (tous deux lisses). Les fibres parasympathiques se dirigeant vers les muscles commutent dans le ganglion ciliaire, situé dans la partie postérieure de l'orbite.
Paire IV - nerf trochléaire, moteur, fin, part du noyau situé au fond de l'aqueduc cérébral au niveau des collicules inférieurs du toit du mésencéphale. Le nerf passe dans l'orbite par la fissure orbitaire supérieure au-dessus et latéralement au nerf oculomoteur, atteint le muscle oblique supérieur du globe oculaire et l'innerve.
11.4.3. V paire - nerf trijumeau, mixte, le plus épais de tous les nerfs crâniens. Se compose de fibres nerveuses sensorielles et motrices. Les fibres nerveuses sensibles sont les dendrites des neurones du ganglion trijumeau (Gassérien), situé au sommet de la pyramide de l'os temporal. Ces fibres nerveuses (dendrites) forment 3 branches du nerf : la première est le nerf ophtalmique, la seconde est le nerf maxillaire et la troisième est le nerf mandibulaire. Les processus centraux (axones) des neurones du ganglion trijumeau constituent la racine sensorielle du nerf trijumeau, qui pénètre dans le cerveau jusqu'aux noyaux sensoriels du pont et de la moelle allongée (un noyau). De ces noyaux, les axones des deuxièmes neurones vont au thalamus, et de celui-ci les axones des troisièmes neurones vont aux parties inférieures du gyrus postcentral du cortex cérébral.
Les fibres motrices du nerf trijumeau sont les axones des neurones de son noyau moteur, situés dans le pont. Ces fibres, à la sortie du cerveau, forment une racine motrice qui, contournant le ganglion trijumeau, rejoint le nerf mandibulaire. Ainsi, les nerfs ophtalmique et maxillaire sont purement sensoriels et le nerf mandibulaire est mixte. Chemin faisant, des fibres parasympathiques issues du nerf facial ou glossopharyngé, qui se terminent dans les glandes lacrymales et salivaires, rejoignent chacune des branches. Ces fibres sont des processus postganglionnaires (axones) de cellules de la partie parasympathique du système nerveux autonome, qui ont migré vers ces zones au cours de l'embryogenèse depuis rhombencéphale(ptérygopalatin, ganglions auriculaires).
1) Le nerf ophtalmique pénètre dans l’orbite par la fissure orbitaire supérieure et est divisé en nerfs lacrymal, frontal et nasociliaire. Donne des branches sensibles et parasympathiques (de la paire VII) à la glande lacrymale, au globe oculaire, à la peau de la paupière supérieure, au front, à la conjonctive de la paupière supérieure, à la muqueuse nasale, aux sinus frontaux, sphénoïdaux et ethmoïdaux.
2) Le nerf maxillaire sort de la cavité crânienne par la rotonde du foramen dans la fosse ptérygopalatine, d'où en partent les nerfs infraorbitaux et zygomatiques. Le nerf sous-orbitaire pénètre par la fissure orbitaire inférieure dans la cavité de l'orbite, de là par le canal sous-orbitaire, il sort vers la surface antérieure de la mâchoire supérieure. Chemin faisant, dans le canal infra-orbitaire, il dégage des branches pour innerver les dents et les gencives de la mâchoire supérieure ; sur le visage, il innerve la peau de la paupière inférieure, du nez et de la lèvre supérieure. Le nerf zygomatique entre également dans l'orbite par la fissure orbitaire inférieure, dégageant le chemin vers nerf optique fibres sécrétoires parasympathiques (de la paire VII) pour la glande lacrymale. Il pénètre ensuite dans le foramen zygomatico-orbitaire de l'os zygomatique et se divise en deux branches. L'un sort dans la fosse temporale (par le foramen zygomaticotemporal de l'os zygomatique) et innerve la peau de la région temporale et du coin latéral de l'œil, l'autre apparaît sur la face antérieure de l'os zygomatique (par le foramen zygomatico-facial de l'os zygomatique). os zygomatique), innervant la peau des zones zygomatiques et buccales. Faisant partie des branches terminales du nerf maxillaire, les fibres parasympathiques du nerf facial se rapprochent de la membrane muqueuse et des glandes de la cavité nasale, du palais dur et mou et du pharynx du ganglion ptérygopalatin.
3) Le nerf mandibulaire sort de la cavité crânienne par le foramen ovale et pénètre dans la fosse infratemporale. Avec ses branches motrices il innerve tous les muscles masticateurs, les muscles tenseurs du voile palatin, le tympan, le muscle mylohyoïdien et le ventre antérieur du muscle digastrique. Les fibres sensorielles font partie de cinq branches principales, innervant principalement la peau du bas du visage et la région temporale.
a) La branche méningée retourne dans la cavité crânienne par le foramen spinosum (accompagnant l'artère méningée moyenne) pour innerver la dure-mère dans la région de la fosse crânienne moyenne.
b) Le nerf buccal innerve la peau et les muqueuses de la joue.
c) Le nerf auriculotemporal innerve la peau du pavillon de l'oreille, le conduit auditif externe, le tympan et la peau de la région temporale. Dans sa composition, les fibres parasympathiques sécrétoires du nerf glossopharyngé passent à la glande salivaire parotide, commutant dans le nœud de l'oreille au niveau de l'ouverture ovale à partir du petit nerf pétreux.
d) Le nerf lingual perçoit la sensation générale de la muqueuse des deux tiers antérieurs de la langue et de la muqueuse buccale. Les fibres parasympathiques de la corde tympanique du nerf facial rejoignent le nerf lingual pour l'innervation sécrétoire des glandes salivaires sous-maxillaires et sublinguales.
e) Le nerf alvéolaire inférieur est la plus grande de toutes les branches du nerf mandibulaire. Il pénètre dans le canal mandibulaire par le foramen du même nom, innerve les dents et les gencives de la mâchoire inférieure, puis sort par le foramen mentonnier et innerve la peau du menton et de la lèvre inférieure.
VI paire - nerf abducens, moteur, formé par les axones des cellules motrices du noyau de ce nerf, qui se trouve dans le tegmentum du pont. Il pénètre dans l’orbite par la fissure orbitaire supérieure et innerve le muscle droit latéral (externe) du globe oculaire.
VII paire - le nerf facial, ou intermédiaire-facial, mixte, unit deux nerfs : le nerf facial lui-même, formé par les fibres motrices des cellules du noyau du nerf facial, et le nerf intermédiaire, représenté par les sens gustatif et fibres autonomes (parasympathiques) et les noyaux correspondants. Tous les noyaux du nerf facial se trouvent dans le pont. Les nerfs faciaux et intermédiaires quittent le cerveau côte à côte, pénètrent dans le conduit auditif interne et s'unissent en un seul tronc - le nerf facial, passant dans le canal nerveux facial. Dans le canal facial de la pyramide de l'os temporal, 3 branches partent du nerf facial :
1) le nerf grand pétreux, transportant les fibres parasympathiques jusqu'au ganglion ptérygopalatin, et de là les fibres sécrétoires postganglionnaires faisant partie du nerf zygomatique et d'autres nerfs de la deuxième branche du nerf trijumeau s'approchent de la glande lacrymale, glandes de la muqueuse nasale cavité, bouche et pharynx ;
2) la corde tympanique traverse la cavité tympanique et, après en avoir quitté, rejoint le nerf lingual à partir de la troisième branche du nerf trijumeau ; il contient des fibres gustatives pour les papilles gustatives du corps et du bout de la langue (deux tiers antérieurs) et des fibres parasympathiques sécrétoires pour les glandes salivaires sous-maxillaires et sublinguales ;
3) le nerf stapédien innerve le muscle stapédien de la cavité tympanique.
Après avoir dégagé ses branches dans le canal facial, le nerf facial en sort par le foramen stylomastoïdien. Après sa sortie, le nerf facial dégage des branches motrices vers le ventre postérieur du muscle supracrânien, le muscle auriculaire postérieur, le ventre postérieur du muscle digastrique et le muscle stylohyoïdien. Ensuite, le nerf facial pénètre dans la glande salivaire parotide et se divise dans son épaisseur en une glande en forme d'éventail, formant ce qu'on appelle la glande majeure. patte d'oie- plexus parotide. Ce plexus est constitué uniquement de fibres motrices qui innervent tous les muscles faciaux de la tête et une partie des muscles du cou (muscle sous-cutané du cou, etc.).
VIII paire - nerf vestibulocochléaire, sensible, formé de fibres nerveuses sensorielles provenant de l'organe de l'audition et de l'équilibre. Il se compose de deux parties : vestibulaire et cochléaire, qui sont différentes par leurs fonctions. La partie vestibulaire est un conducteur d'impulsions provenant de l'appareil statique situé dans le vestibule et les conduits semi-circulaires du labyrinthe de l'oreille interne, et la partie cochléaire conduit les impulsions auditives de l'organe spiral situé dans la cochlée, qui perçoit les stimuli sonores. Les deux parties possèdent des ganglions nerveux constitués de cellules bipolaires situées dans la pyramide de l'os temporal. Les processus périphériques (dendrites) des cellules du ganglion vestibulaire se terminent sur les cellules réceptrices Appareil vestibulaire dans le vestibule et les ampoules des conduits semi-circulaires et les cellules du ganglion cochléaire - sur les cellules réceptrices de l'organe spiral de la cochlée de l'oreille interne. Les processus centraux (axones) de ces nœuds se connectent dans le conduit auditif interne pour former le nerf vestibulaire-cochléaire, qui sort de la pyramide par l'ouverture auditive interne et se termine dans les noyaux pontins (dans la zone du champ vestibulaire du fosse rhomboïde). Les axones des cellules des noyaux vestibulaires (le deuxième neurone) sont dirigés vers les noyaux cérébelleux et vers moelle épinière, formant le tractus vestibulospinal. Une partie des fibres de la partie vestibulaire du nerf vestibulocochléaire va directement au cervelet, en contournant noyaux vestibulaires. La partie vestibulaire du nerf vestibulocochléaire participe à la régulation de la position de la tête, du torse et des membres dans l'espace, ainsi qu'au système de coordination des mouvements. Les axones des cellules des noyaux cochléaires antérieur et postérieur du pont (le deuxième neurone) sont dirigés vers les centres auditifs sous-corticaux : le corps géniculé médial et le colliculus inférieur du toit du mésencéphale. Une partie des fibres des noyaux cochléaires du pont se termine dans le corps genouillé médial, où se trouve le troisième neurone, transmettant des impulsions le long de son axone au centre auditif cortical, situé dans le gyrus temporal supérieur (gyri de R. Heschl). Une autre partie des fibres des noyaux cochléaires du pont passe en transit à travers le corps géniculé médial, puis par l'anse du colliculus inférieur pénètre dans son noyau, où il se termine. Ici commence l'un des voies extrapyramidales (voie tégnospinale), qui transmet les impulsions des colliculi inférieurs de la plaque du toit du mésencéphale aux cellules des noyaux moteurs des cornes antérieures de la moelle épinière.
11.4.4. Paire IX - nerf glossopharyngé, mixte, contient des fibres nerveuses sensorielles, motrices et autonomes, mais les fibres sensorielles y prédominent. Les noyaux du nerf glossopharyngé sont situés dans la moelle allongée : moteur - noyau double, commun avec le nerf vague ; végétatif (parasympathique) - noyau salivaire inférieur ; noyau du tractus solitarius, où se terminent les fibres nerveuses sensorielles. Les fibres de ces noyaux forment le nerf glossopharyngé, qui sort de la cavité crânienne par le foramen jugulaire avec les nerfs vagues et accessoires. Au niveau du foramen jugulaire, le nerf glossopharyngé forme deux nœuds sensoriels : le supérieur et le plus grand inférieur. Les axones des neurones de ces nœuds se terminent dans le noyau du tractus solitaire du bulbe rachidien, et les processus périphériques (dendrites) se dirigent vers les récepteurs de la membrane muqueuse du tiers postérieur de la langue, vers la membrane muqueuse du pharynx, oreille moyenne, ainsi qu'aux sinus carotidiens et au glomérule. Les principales branches du nerf glossopharyngé :
1) le nerf tympanique assure une innervation sensible de la membrane muqueuse de la cavité tympanique et du tube auditif ; par la branche terminale de ce nerf, le nerf petit pétreux, les fibres sécrétoires parasympathiques de la glande salivaire parotide sont amenées du noyau salivaire inférieur. Après une rupture du ganglion auriculaire, les fibres sécrétoires se rapprochent de la glande dans le cadre du nerf auriculotemporal à partir de la troisième branche du nerf trijumeau ;
2) branches d'amygdales - jusqu'à la membrane muqueuse des arcs palatins et des amygdales ;
3) branche sinusale - vers le sinus carotidien et le glomérule carotidien ;
4) une branche du muscle stylopharyngé pour son innervation motrice ;
5) les branches pharyngées, avec les branches du nerf vague et les branches du tronc sympathique, forment le plexus pharyngé ;
6) la branche de connexion rejoint la branche auriculaire du nerf vague.
Les branches terminales du nerf glossopharyngé, les branches linguales, assurent l'innervation sensorielle et gustative de la membrane muqueuse du tiers postérieur de la langue.
Paire X - le nerf vague, mixte, est le plus long des nerfs crâniens. Il contient des fibres sensorielles, motrices et parasympathiques. Cependant, les fibres parasympathiques constituent la majeure partie du nerf. En termes de composition en fibres et de zone d'innervation, le nerf vague est le principal nerf parasympathique. Les noyaux du nerf vague (sensoriel, moteur et parasympathique) sont situés dans la moelle allongée. Le nerf sort de la cavité crânienne par le foramen jugulaire, où la partie sensible du nerf comporte deux nœuds : supérieur et inférieur. Les processus périphériques (dendrites) des neurones de ces nœuds font partie de fibres sensorielles qui se ramifient en diverses les organes internes où se trouvent les terminaisons nerveuses sensibles - les viscérorécepteurs. Les processus centraux (axones) des neurones nodulaires sont regroupés en un faisceau qui se termine par le noyau sensible du tractus solitaire de la moelle allongée. L'une des branches sensorielles, le nerf dépresseur, se termine par des récepteurs dans la crosse aortique et joue un rôle important dans la régulation de la pression artérielle. D'autres branches sensorielles plus fines du nerf vague innervent une partie de la dure-mère du cerveau et la peau du conduit auditif externe et du pavillon de l'oreille.
Les fibres somatiques motrices innervent les muscles du pharynx, du palais mou (à l'exception du muscle qui tend le voile palatin) et les muscles du larynx. Les fibres parasympathiques (efférentes) émanant du noyau autonome de la moelle allongée innervent les organes du cou, de la poitrine et cavités abdominales, à l'exception du côlon sigmoïde et des organes pelviens. Les fibres du nerf vague transportent des impulsions qui ralentissent la fréquence cardiaque, dilatent les vaisseaux sanguins, rétrécissent les bronches, augmentent le péristaltisme et détendent les sphincters du tube digestif, augmentent la sécrétion des glandes digestives, etc.
Topographiquement, le nerf vague est divisé en 4 sections : tête, cervicale, thoracique et abdominale.
Les branches s'étendent de la tête jusqu'à la dure-mère du cerveau (branche méningée) et jusqu'à la peau de la paroi postérieure du conduit auditif externe et une partie du pavillon d'oreille (branche auriculaire).
De la région cervicale partent les branches pharyngées (vers le pharynx et les muscles du palais mou), les branches cardiaques cervicales supérieures (vers le plexus cardiaque), les nerfs laryngés supérieurs et récurrents (vers les muscles et la muqueuse du larynx, vers la trachée, l'œsophage, le plexus cardiaque).
De la région thoracique, les branches cardiaques thoraciques s'étendent jusqu'au plexus cardiaque, les branches bronchiques jusqu'au plexus pulmonaire et les branches œsophagiennes jusqu'au plexus œsophagien.
La section abdominale est représentée par les troncs vagues antérieur et postérieur, qui sont des branches du plexus œsophagien. Le tronc vague antérieur provient de la surface antérieure de l'estomac et dégage des branches vers l'estomac et le foie. Le tronc vague postérieur est situé sur la paroi postérieure de l'estomac et dégage des branches vers l'estomac et le plexus coeliaque, puis vers le foie, le pancréas, la rate, les reins, l'intestin grêle et une partie du gros intestin (jusqu'au côlon descendant).
Paire XI - nerf accessoire, moteur, possède deux noyaux : l'un se trouve dans la moelle oblongate et l'autre dans la moelle épinière. Le nerf commence par plusieurs racines crâniennes et spinales. Ces derniers s'élèvent vers le haut, pénètrent dans la cavité crânienne par le foramen magnum, se confondent avec les racines crâniennes et forment le tronc du nerf accessoire. Ce tronc, pénétrant dans le foramen jugulaire, est divisé en deux branches. L'une d'elles, la branche interne, rejoint le tronc du nerf vague, et l'autre, la branche externe, après être sortie du foramen jugulaire, descend et innerve les muscles pectoraux nocléidomastoïdiens et trapèzes.
Paire XII - nerf hypoglosse, moteur. Son noyau est situé dans la moelle allongée. Le nerf émerge à travers de nombreuses racines dans le sillon situé entre la pyramide et l'olivier. Il quitte la cavité crânienne par le canal du nerf hypoglosse de l'os occipital, puis se dirige de manière arquée vers la langue, innervant tous ses muscles et partiellement certains muscles du cou. L'une des branches du nerf hypoglosse (descendant) forme, avec les branches du plexus cervical, ce qu'on appelle l'anse cervicale (boucle du nerf hypoglosse). Les branches de cette anse innervent les muscles du cou situés sous l'os hyoïde.