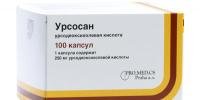Que signifie l'instabilité des vertèbres cervicales ? Symptômes et traitement de l'instabilité de la colonne cervicale. Gymnastique thérapeutique, exercices - vidéo
L'instabilité de la colonne cervicale signifie l'incapacité de maintenir la relation entre ses vertèbres. Seul un médecin prescrit un traitement, il ne peut y avoir ici d'automédication.
Dans cet article, vous apprendrez en détail tout ce qui concerne l'instabilité de la vertèbre cervicale, ainsi que le traitement de l'instabilité. L'article parle également de l'instabilité de la colonne cervicale chez les enfants. Mais la chose la plus importante à savoir est que l’instabilité n’est pas mortelle, tout cela peut être résolu par la chirurgie.
Cet article sera utile à tous ceux qui ont personnellement rencontré ce problème, ou à vos proches. Vous pouvez également regarder des vidéos qui parleront de toutes les conséquences de l’instabilité cervicale.
Instabilité de la colonne cervicaleL'instabilité des vertèbres cervicales n'est pas un phénomène très courant, mais extrêmement désagréable. L’émergence d’un tel problème peut changer radicalement la vie d’une personne, et pas pour le mieux. Cependant, si ce problème est diagnostiqué à temps et que le traitement approprié est prescrit, la situation peut être corrigée. Mais pour ce faire, vous devez comprendre ce qu'est cette maladie.
La colonne cervicale est composée de 7 vertèbres. La colonne vertébrale combine deux fonctions : mobilité et stabilité. Grâce à la mobilité, nous pouvons librement plier et redresser notre cou et tourner la tête. La stabilité de la colonne vertébrale permet de maintenir la relation entre les vertèbres et de les protéger de la déformation.
En raison de blessures ou d'ostéochondrose, la mobilité des vertèbres de la région cervicale peut augmenter. Dans ce cas, la relation entre les vertèbres adjacentes est perturbée, l'amplitude des mouvements augmente et une instabilité de la colonne cervicale se produit. Elle s'accompagne souvent d'un déplacement des vertèbres. Un déplacement des vertèbres de 3 à 4 mm vers l'avant ou vers l'arrière est considéré comme un signe de maladie.
Il ne faut pas oublier que la région cervicale est la partie la plus mobile de la colonne vertébrale. Il offre une plus grande liberté d'action, permettant de plier et de redresser le cou, d'effectuer des flexions latérales, d'effectuer des mouvements circulaires, etc. mais en même temps, la colonne cervicale doit allier mobilité et stabilité. En parallèle d'assurer la mobilité nécessaire, cette partie de la colonne vertébrale doit conserver certaines proportions et pouvoir se protéger des déformations et des douleurs lors de l'activité physique.
Cependant, certains troubles conduisent à une violation d'un paramètre tel que la stabilité, ce qui entraîne une mobilité (pathologique) excessive de la colonne cervicale, appelée instabilité des vertèbres cervicales.
Mais quelles sont les causes d'un problème tel que l'instabilité des vertèbres cervicales ? Diverses maladies apparaissant dans la région cervicale, ainsi que des blessures dans cette partie de la colonne vertébrale, peuvent se manifester par une destruction des structures fondamentales antérieures et postérieures, entraînant une diminution de l'activité de soutien. En conséquence, il y a une violation de la stabilité de ce département, qui en médecine est défini par le terme « instabilité ».
En général, l'instabilité vertébrale s'entend comme la perte de la capacité à maintenir des proportions naturelles entre les vertèbres de cette partie de la colonne vertébrale, entraînant une mobilité excessive dans cette partie. Cela peut se manifester par une augmentation de l’amplitude des mouvements normaux.
Mais un signe caractéristique du problème est le déplacement des vertèbres. Certes, il existe des situations où le déplacement des vertèbres dans la colonne cervicale n'est pas le signe d'une maladie, mais dans ce cas, il se déroule sans douleur, tandis que l'instabilité s'accompagne toujours de douleur.
L'instabilité vertébrale est comprise comme une mobilité excessive de ses éléments les uns par rapport aux autres, à la suite de laquelle la colonne vertébrale perd la capacité de maintenir une position et une relation normales entre les éléments pendant les mouvements ou au repos. Les vertèbres glissent librement vers l’avant, vers l’arrière ou sur le côté, irritant les racines nerveuses et provoquant une gêne.
Il est important de préciser que l'instabilité segmentaire de la colonne vertébrale n'est pas une position incorrecte et stable des vertèbres les unes par rapport aux autres, mais leur mouvement pathologique incontrôlé, qui peut gravement déformer canal rachidien. Le plus souvent, les vertèbres sont déplacées lors de divers mouvements. Si un ou plusieurs éléments sont instables, la colonne vertébrale ressemble à une pyramide construite par un enfant à partir de cubes.
Lorsqu'il est incliné, l'un des cubes commence à glisser vers l'avant ou vers l'arrière, ce qui entraîne la structure entière à bouger et à être détruite. Quelque chose de très similaire se produit avec le segment de mouvement de la colonne vertébrale. L'élément instable sort de l'espace entre les processus articulaires, provoquant le déplacement de toute la colonne, blessant les terminaisons nerveuses et la moelle épinière, ce qui peut provoquer de nombreuses maladies, notamment la paralysie.
Signes et symptômes de l'instabilité vertébrale

L'instabilité de la colonne cervicale provoque des douleurs cervicales qui s'aggravent avec l'activité physique. Une gêne apparaît même avec un léger mouvement du cou. Le tonus des muscles de la région cervicale augmente, ils deviennent plus sollicités et se fatiguent plus rapidement. Au fil du temps, les muscles du cou s'affaiblissent et font mal à la palpation.
Lorsque les vaisseaux de la colonne vertébrale sont comprimés, des maux de tête, des étourdissements et des augmentations de la tension artérielle surviennent. Dans les cas graves, la sensibilité est altérée, une faiblesse apparaît dans les bras et les jambes et une paralysie partielle ou complète se produit.
L'instabilité des éléments du segment rachidien est généralement associée aux sensations suivantes :
- Douleurs dans le dos, dans diverses parties de la colonne vertébrale, s'aggravant souvent après l'exercice ;
- Douleur aux jambes;
- Limitation de la mobilité lors de la flexion et de la rotation du corps ;
- Sensation d'inconfort au niveau du cou, du bas du dos ou dans un autre segment où les vertèbres sont instables ; Maux de tête, vertiges (avec déplacement du cou) ;
- Douleurs lombaires, notamment lors du levage d'objets lourds (instabilité des vertèbres lombaires).
- Blessures causées par des chutes ou le port de charges lourdes ;
- Modifications liées à l'âge, y compris les processus dégénératifs du tissu discal ;
- Ostéochondrose ;
- Faiblesse des articulations et des ligaments ;
- Corset musculaire non développé
- Les maux de tête s'aggravent ;
- La zone cervicale reste raide ou au contraire hypermobile ;
- Le sommeil est perturbé ;
- De l'irritabilité et une anxiété excessive apparaissent ;
- La léthargie et la somnolence interfèrent avec un travail productif ;
- Une déficience visuelle survient, l'audition diminue ; Il y a un manque de coordination et des chancellements se produisent lors de la marche.
En raison de la douleur, une tension musculaire constante se produit ; le dos dans la zone endommagée apparaît souvent comme « pétrifié », tandis que d'autres groupes musculaires deviennent flasques et faibles.
Une personne essaie de maintenir son corps dans une position sans douleur, ce qui entraîne une altération du tonus musculaire. Le tissu n’est pas en mesure de soutenir la vertèbre pathologiquement mobile et change constamment de position. Dans certains cas, le déplacement de la vertèbre s'accompagne d'un clic ou d'un craquement lorsqu'elle est inclinée.
L'instabilité est souvent associée à des troubles névrotiques et peut même conduire à une destruction vertébrale.
Seul un neurologue peut procéder à un examen compétent et poser un diagnostic d'instabilité de certaines vertèbres sur la base de données radiologiques. Vous ne pouvez pas vous diagnostiquer vous-même et essayer de traiter l'instabilité. De nombreuses personnes souffrant de cette maladie se tournent vers des « chiropraticiens » locaux pour des ajustements de la colonne vertébrale.
Cela peut entraîner une aggravation de l'état, car l'instabilité segmentaire de la colonne vertébrale nécessite un diagnostic professionnel et un choix compétent de méthodes de traitement. Avant de prescrire un traitement, un médecin professionnel ne se limite pas à un examen radiologique : il détermine le degré d'instabilité en évaluant un certain nombre de critères à l'aide d'un système de notation.
Parmi les principales raisons de l'apparition d'éléments excessivement mobiles dans l'une ou l'autre partie de la colonne vertébrale figurent les suivantes :
Un indicateur de l'instabilité de la colonne vertébrale est le déplacement de ses vertèbres, qui peut être détecté à la suite d'un examen aux rayons X. Le processus de déplacement vertébral lui-même peut se produire sans douleur, mais l'instabilité vertébrale s'accompagne de douleur.
Les signes caractéristiques d'instabilité sont une violation de la capacité portante de la colonne vertébrale humaine, qui est une conséquence de l'impact de charges externes sur celle-ci (par exemple excessives ou physiologiques), ainsi que la perte de la capacité de la colonne vertébrale à maintenir certains paramètres entre ses vertèbres.
L'état d'instabilité s'accompagne de douleurs, de troubles neurologiques, de limitations de mouvements et de tensions musculaires. De plus, l'instabilité entraîne une irritation de la membrane médullaire, un rétrécissement du canal rachidien et l'apparition de lumbagos.
La cause de l'instabilité de la colonne cervicale est souvent due aux caractéristiques structurelles des vertèbres de cette section. L'instabilité peut également être causée par des blessures (de route ou sportives), de l'ostéochondrose (changement dégénératif-dystrophique), une intervention chirurgicale au cours de laquelle l'intégrité des articulations de soutien est violée, ainsi qu'une infériorité congénitale du disque intervertébral.
Au niveau de la colonne cervicale, chez les patients présentant une instabilité de l'articulation atlanto-occipitale, des douleurs peuvent survenir périodiquement et augmenter après une activité physique. L'instabilité la plus fréquente se situe au niveau de la colonne lombo-sacrée et cervicale.
Conséquences

Les conséquences d'un diagnostic erroné et d'un traitement intempestif peuvent être très graves :
Il est important de diagnostiquer à temps une maladie dangereuse dont la progression peut entraîner une perte de capacité de travail.
L'instabilité de la colonne cervicale accélère le développement de l'ostéochondrose et conduit à l'arthrose des articulations intervertébrales. Des maux de dos bilatéraux surviennent et s'intensifient lorsque l'on se penche ou que l'on soulève des poids.
Sans traitement de la maladie, les maux de tête s’intensifient, le sommeil d’une personne est perturbé et elle devient irritable. La vision et l'audition se détériorent, une somnolence et une léthargie apparaissent, la coordination est altérée et le patient chancelle en marchant.
Dans de très rares cas, au fil des années, l'instabilité vertébrale est restaurée en raison de la prolifération du tissu osseux - les ostéophytes. En même temps, la douleur s'atténue.
Diagnostic de l'instabilité vertébrale
Les maladies et les blessures de la colonne cervicale s'accompagnent souvent d'une destruction des structures de soutien antérieures ou postérieures, ce qui entraîne une diminution de la fonction de soutien. Un état similaire est défini dans la littérature par un autre terme « instabilité ».
L'instabilité vertébrale se manifeste par toute une série de symptômes qui compliquent grandement le diagnostic topique et provoquent des erreurs de diagnostic. Ces circonstances dictent la nécessité de détecter rapidement l’instabilité et de déterminer ses symptômes uniques.
Cette situation s'applique particulièrement à une approche différenciée du traitement des formes stables et instables de pathologie de la colonne cervicale. Les symptômes d'instabilité tels que la myélopathie progressive, le syndrome radiculaire, le syndrome des artères et nerfs vertébraux et la dyscalgie cervicale sont suffisamment couverts dans la littérature et ne soulèvent pas de doutes.
Dans le même temps, les manifestations cliniques de l'instabilité latente de la colonne vertébrale dans l'ostéochondrose, les lésions d'extension et dans d'autres cas où il n'est pas possible de juger de la défaillance des structures de soutien de la colonne vertébrale sur la base de données radiographiques simples.
La radiographie fonctionnelle peut apporter une aide significative pour établir un diagnostic dans de telles situations. Cependant, l'interprétation des données obtenues et le décodage des radiographies fonctionnelles présentent des difficultés importantes en raison de l'extrême variabilité de l'amplitude de mouvement des différents segments de la colonne vertébrale.
Par conséquent, à ce jour, il n'existe pas de gradation généralement acceptée de mobilité des segments vertébraux cervicaux afin d'évaluer l'état de stabilité de la fonction de soutien. Dans certains cas, l'angiographie fonctionnelle des artères vertébrales peut donner une réponse définitive à la question de la stabilité de la colonne vertébrale, mais cette méthode a des indications strictes et ne peut être utilisée dans la pratique quotidienne d'un traumatologue orthopédiste.
La présence d'une hypermobilité du segment rachidien, provoquée par un glissement et une convergence marginale des vertèbres, ne doit pas être reconnue comme une instabilité. Il s’agit probablement d’une des nombreuses variantes de la fonction motrice normale du segment rachidien cervical. L'instabilité de la colonne cervicale ne présente pas de symptômes cliniques stricts et uniques.
Elle peut provoquer un certain nombre de manifestations cliniques, connues dans la littérature sous le nom de syndromes végétatifs-dystrophiques. À notre avis, l'instabilité clinique la plus probable est le syndrome de l'artère et du nerf vertébraux, qui peut non seulement s'expliquer par la compression de l'artère vertébrale par les processus articulaires des vertèbres, mais aussi être objectivé de manière convaincante par les données d'autres méthodes d'examen, par exemple, la rhéoencéphalographie.
Ainsi, une instabilité cachée de la colonne cervicale peut être détectée par un simple examen radiographique. Cependant, il est conseillé de conclure sur la présence d'une instabilité cachée chez les patients sur la base de la coïncidence des syndromes cliniques les plus typiques avec les données des méthodes d'examen radiologique et électrophysiologique.
Lors de la détermination des indications du traitement chirurgical de l'instabilité, en plus de ce qui précède, il convient de partir de l'efficacité de la stabilisation externe de la colonne cervicale.
Le diagnostic est posé sur la base des plaintes subjectives du patient, de son activité motrice, des résultats de l'examen et des radiographies de la colonne cervicale. Le diagnostic de l'instabilité de la colonne cervicale est réalisé au moyen d'un examen, d'un examen radiographique et de certaines manifestations neurologiques.
Manifestations radiologiques : l'instabilité devient particulièrement visible sur la radiographie. Le plus souvent, deux photographies sont prises, dans la première, la tête de la personne est en position verticale et dans la seconde, elle est penchée vers l'avant.
Dans le premier cas, la déviation est plus perceptible que d'habitude. Dans le second, la colonne vertébrale se plie également, mais vers l'extérieur. Dans certains cas, le déplacement de l'apophyse odontoïde devient également perceptible, car l'os de la mâchoire ne le recouvre pas.
Manifestations neurologiques : en cas d'instabilité de la colonne vertébrale, un rétrécissement notable du canal vertébral se produit, entraînant l'apparition des symptômes suivants. Ils peuvent être regroupés en trois catégories conditionnelles :
- Radiculaire. Cela inclut des symptômes tels que la radiculite, le lumbago, la cervicalgie ;
- Spinal. Parésie, contractions musculaires, faiblesse ou engourdissement des membres ;
- Neurodystrophique. Dans ce cas, un muscle est endommagé, la faiblesse devient prononcée et une périarthrite et un syndrome cardinal peuvent survenir.
Quels types d’instabilité existe-t-il ?

Selon les causes de développement, plusieurs types d'instabilité vertébrale peuvent être distingués :
- l'instabilité dégénérative se développe le plus souvent à la suite de l'ostéochondrose. Dans ce cas, la raison en est qu'en raison de modifications dégénératives, le tissu du disque et l'anneau fibreux sont détruits, ce qui entraîne la perte de ses propriétés de fixation et d'absorption des chocs ;
- instabilité post-traumatique, généralement causée par un traumatisme. Dans certains cas, la cause d’une telle instabilité est un traumatisme à la naissance. En particulier, l'instabilité de la colonne cervicale chez les enfants est la plus courante pour cette raison ;
- une instabilité postopératoire se développe souvent après une intervention chirurgicale en raison d'une perturbation des structures de soutien de la colonne vertébrale elle-même ;
- instabilité dysplasique. Ce problème est généralement dû au syndrome dysplasique. La dysplasie en général est une définition généralisée des conséquences d'un développement ou d'une formation inappropriés des organes internes, des tissus ou du corps dans son ensemble, qui peuvent s'exprimer par des modifications de la taille, de la forme et de la structure des cellules, des tissus ou des organes individuels. Dans ce cas, cela se manifeste au niveau des articulations de la colonne vertébrale et des ligaments intervertébraux, du disque intervertébral ou du corps vertébral lui-même.
Compte tenu de ce qui précède, il devient clair à quel point il est important de détecter l'instabilité en temps opportun, ainsi que d'expliquer les symptômes qui y sont inhérents. Ceci est particulièrement important lors du traitement de diverses formes d’anomalies de cette partie de la colonne vertébrale. En particulier, les manifestations d’instabilité évidente sont bien connues et ont été étudiées de manière assez approfondie. Il s'agit du syndrome radiculaire, de la dyscalgie cervicale, de la myélopathie progressive, des syndromes du nerf vertébral et de l'artère vertébrale.
La situation est beaucoup plus compliquée dans les cas d'instabilité cachée, dont le traitement est beaucoup plus difficile simplement en raison de l'ambiguïté des symptômes, c'est pourquoi des diagnostics erronés sont souvent posés et un mauvais traitement est prescrit. Il existe un certain nombre de cas dans lesquels même un examen radiographique complet ne permet pas de conclure sur l'état insatisfaisant des dispositifs de soutien de la colonne vertébrale dans ce service.
Pour cette raison, la séquence généralement acceptée pour identifier l'instabilité n'a pas encore été déterminée, à savoir une condition dans laquelle l'hypermobilité est provoquée précisément par un glissement excessif des vertèbres sans apparition de leur approche limite. En d'autres termes, l'instabilité est généralement détectée par un étude fonctionnelle radiologique conventionnelle, mais le médecin ne peut conclure sur la présence de la maladie qu'en présence de syndromes cliniques caractéristiques.
Caractéristiques de l'instabilité des vertèbres cervicales pendant l'enfance

Les principaux facteurs de survenue d'une mobilité excessive des segments vertébraux sont la localisation de la colonne vertébrale et l'âge du patient. Ainsi, l'amplitude de mobilité de la colonne vertébrale chez l'enfant est plus grande que chez l'adulte. Ceci est une conséquence de l'absence de disque intervertébral dans l'un des segments de la colonne vertébrale chez l'enfant. Très souvent, l'instabilité de la colonne cervicale supérieure pendant l'enfance devient la cause d'un torticolis aigu.
Les mesures thérapeutiques doivent être réalisées en combinaison. Souvent les mamans disent avoir eu plusieurs séances chez un ostéopathe ou suivi un cours de massage. C'est tout! Ceci a terminé le traitement. C’est une très mauvaise approche pour traiter ces enfants.
Après tout, le but du traitement n’est pas seulement de « remettre les vertèbres cervicales en place » et d’éliminer ainsi l’obstruction de la circulation sanguine dans les artères vertébrales. Il est très important de maximiser davantage ce flux sanguin afin que le cerveau reçoive la meilleure nutrition et un meilleur apport sanguin et commence à se développer plus intensément. Ce n'est qu'alors que les plaintes de maux de tête disparaîtront, que l'enfant se comportera mieux et étudiera mieux. Et cela, mes amis, ne se fait pas rapidement. Et il est impératif d'inclure plusieurs procédures différentes dans le parcours de traitement.
- Ostéopathie.
Cette méthode affecte le tonus des muscles du cou, qui sont situés très profondément. Le massage conventionnel n’affecte que les muscles superficiels du cou. Grâce aux manipulations de l'ostéopathe, les vertèbres cervicales se mettent en place, la pression sur les artères vertébrales est éliminée et la circulation cérébrale s'améliore. Il est strictement interdit de culbuter. Il est préférable de dispenser votre enfant des cours d'éducation physique. Périodiquement, vous devez être examiné par un ostéopathe et maintenir le bon état de la colonne vertébrale. - Massage classique.
Il est également très largement utilisé dans les NSOP. Elle ne peut pas être combinée avec l'ostéopathie. Grâce au massage, les muscles tendus se détendent. Les muscles affaiblis sont renforcés. Un métabolisme intense se produit dans les muscles, la circulation sanguine augmente et la microcirculation s'améliore. Les manifestations cliniques de la maladie disparaissent. - Physiothérapie.
- Physiothérapie.
Généralement combiné avec un massage. Le plus souvent, l'électrophorèse est prescrite avec des médicaments vasodilatateurs, ce qui améliore encore la circulation cérébrale.
Bien entendu, il faut commencer le traitement par le massage, l'ostéopathie et la physiothérapie. Mais pour consolider le résultat – la physiothérapie. Le plus intéressant est que si vous, chers parents, voulez vraiment sauver votre enfant de l'instabilité et prévenir le développement de l'ostéochondrose cervicale à l'avenir, des exercices physiques doivent être pratiqués quotidiennement tout au long de sa vie. Oui oui! Sinon, les muscles reviendront progressivement à leur état d'origine et des symptômes cliniques réapparaîtront.
Ce sera très bien si votre enfant commence à visiter la piscine. La natation améliore la statique de la colonne vertébrale. Il est utile de faire de la gymnastique et de la chorégraphie. De manière générale, renforcez les muscles du cou, ainsi que la ceinture scapulaire, les bras et le torse.
Au cours du traitement, le neurologue prescrira à l'enfant des médicaments symptomatiques : vasodilatateurs, nootropiques, sédatifs et autres médicaments. En général, il est nécessaire de suivre un traitement sous la direction d'un neurologue pédiatrique, qui examinera d'abord l'enfant et, sur la base des données obtenues, établira un programme de traitement. Je le surveillerai.
Quelques années d’attention attentive au problème de l’enfant et tout passera. NSHOP doit être guéri dès l'enfance, afin que plus tard votre fils ou votre fille ne souffre pas d'ostéochondrose cervicale. L'instabilité de la colonne cervicale chez les enfants aggrave sans aucun doute la circulation cérébrale. Même malgré la présence d'une circulation collatérale. Ceci est confirmé par les méthodes d'examen instrumental, notamment l'échographie Doppler.
Il est impossible de permettre une carence en nutriments dans le cerveau d’un enfant. Consultez rapidement un neurologue pédiatrique, faites-vous examiner et suivez un traitement correctif. Dans ce cas, l’enfant aura un bon pronostic et ne souffrira pas par la suite de maux de tête ni de vertiges.
Traitement de l'instabilité cervicale
Le traitement commence généralement par des méthodes conservatrices. Ils sont utilisés chez les patients au stade initial de la maladie qui ne présentent pas de douleur intense ni de symptômes rachidiens.
Les méthodes conservatrices comprennent :
- le respect d'un régime doux;
- massage, physiothérapie;
- porter un corset;
- consommation de médicaments (AINS, sirdulad, novocaïne);
- physiothérapie (échographie, électrophorèse).
Si le traitement conservateur ne donne pas l'effet souhaité et que la douleur persiste pendant une longue période, si une parésie et un dysfonctionnement des organes pelviens apparaissent, un traitement chirurgical est indiqué. L'essence de l'intervention chirurgicale est de stabiliser les corps vertébraux à l'aide de structures spéciales.
Il convient de noter que le traitement conservateur de cette maladie est désormais considéré comme l’option privilégiée. Dans la plupart des cas, cela donne des résultats assez bons et durables. Comme pour d’autres maladies de la colonne vertébrale, le traitement chirurgical est considéré comme un dernier recours, utilisé uniquement lorsque la maladie commence à affecter le fonctionnement des organes internes d’une personne. Cependant, l'instabilité de la colonne cervicale entraîne souvent de tels problèmes, car le canal rachidien est ici assez étroit et le déplacement des vertèbres peut avoir de graves conséquences sur la moelle épinière.
Sinon, les méthodes conservatrices de traitement de cette maladie ne diffèrent pas du traitement de la plupart des autres maladies de la colonne vertébrale, la base étant la gymnastique et le massage pour l'instabilité des vertèbres cervicales. Dans ce cas, le patient doit porter une minerve souple ou dure, qui permet de maintenir les vertèbres dans leur position naturelle.
L’utilisation d’un corset dans le traitement de cette maladie est souvent nécessaire, bien qu’il s’agisse d’une « arme à double tranchant ». Un tel corset permet réellement de maintenir les vertèbres dans la position souhaitée, minimisant ainsi le risque de divers syndromes douloureux et complications. Mais, d'un autre côté, son utilisation prolongée peut entraîner un affaiblissement de la structure musculaire et des ligaments du cou, ce qui signifie que lorsque le corset est retiré, le problème réapparaît immédiatement.
C'est pourquoi l'utilisation d'un corset s'accompagne toujours d'exercices de physiothérapie en cas d'instabilité des vertèbres cervicales. Dans ce cas, des exercices spécifiques doivent être sélectionnés individuellement par le médecin, en tenant compte du problème existant, car l'instabilité est un problème assez complexe et nécessite une attention particulière.
Par ailleurs, il convient de noter que l'instabilité des vertèbres cervicales ne tolère pas les tentatives d'automédication et l'utilisation de méthodes traditionnelles. Ce problème doit être traité par un spécialiste qualifié, sinon la personne risque de compliquer sérieusement la situation et les dangers d'une compression grave ou de lésions de la moelle épinière dans la région cervicale n'ont besoin d'être expliqués à personne.
Cette pathologie est dangereuse car il existe une forme cachée, lorsque les symptômes ne sont pas si évidents et sont très similaires aux manifestations d'autres maladies de la colonne vertébrale. Dans certains cas, même les rayons X ne peuvent pas fournir une image complète permettant de poser un diagnostic correct.
Si une mobilité excessive des vertèbres cervicales apparaît sans approximation limite, il peut être très difficile de déterminer la cause de la douleur et des symptômes. Seul un examen complet du patient et l'observation de l'évolution de la maladie permettront de déterminer les méthodes et méthodes de traitement les plus efficaces. Les manifestations d'instabilité de la colonne cervicale sont traitées de manière conservatrice et chirurgicale.
La chirurgie est pratiquée si la douleur ne disparaît pas après un mois ou deux et si certains médicaments ou procédures sont mal tolérés par le patient. Indications supplémentaires de la chirurgie : subluxation de la vertèbre due à l'hypermobilité, ainsi que préservation des syndromes radiculaires et rachidiens. Pour stabiliser la colonne vertébrale, une méthode spéciale est utilisée : la fusion vertébrale. Il existe deux options : la fusion vertébrale antérieure et postérieure.
L'essence de la méthode consiste à fixer une plaque à l'avant ou à l'arrière de la vertèbre, ce qui aidera à corriger la subluxation et à réduire la pression sur les terminaisons nerveuses. Les deux types de fusion vertébrale sont souvent combinés, dont la antérieure est la moins traumatisante.
Les complications (résorption du greffon ou apparition d'une pseudarthrose) surviennent moins fréquemment après l'abord antérieur. Pour choisir une méthode de traitement chirurgical, divers facteurs sont pris en compte : la gravité de la maladie, l'ampleur du déplacement, le tonus musculaire et le type d'instabilité des vertèbres cervicales.
Prévention et exercice

Pour prévenir le développement d'une instabilité vertébrale dans la région cervicale, il est recommandé de suivre certaines règles :
- Minimisez le risque de blessures domestiques et sportives. Malheureusement, personne n’est à l’abri des accidents de la route ;
- Évitez l'hypothermie soudaine pour prévenir l'inflammation des terminaisons nerveuses ;
- Pratiquer des exercices physiques visant à renforcer les bras et la ceinture scapulaire ;
- Surveiller l'évolution des maladies de la colonne vertébrale et les traiter en temps opportun pour prévenir les complications ;
- Maintenir une hygiène de travail et de repos pour éviter de surcharger la ceinture scapulaire et la colonne vertébrale supérieure ;
- Évitez les mouvements brusques et forts de la tête.
Les parents doivent remarquer les moindres changements dans les mouvements de l’enfant afin d’identifier rapidement les signes d’une pathologie en développement. L'instabilité des vertèbres cervicales est une pathologie grave qui nécessite une étude approfondie et un traitement rapide.
Il est important de diagnostiquer correctement la maladie afin de choisir la méthode de traitement appropriée. Les mesures pertinentes devraient conduire à des changements positifs. Des mesures préventives et un ensemble de mesures de réadaptation vous permettront de maintenir votre capacité de travail et d'assurer une qualité de vie décente.
Le port prolongé de colliers spéciaux lors du traitement de l'instabilité entraîne une diminution de la mobilité de la colonne cervicale. Pour renforcer vos articulations, vous devez effectuer des exercices spéciaux. Il est préférable de les réaliser sous la direction d'un spécialiste sur des simulateurs spéciaux. Tous les patients n'ont pas cette opportunité, d'autant plus que la période active de réalisation de tels exercices dure six mois et que la période d'entretien peut aller jusqu'à plusieurs années.
Par conséquent, un dispositif permettant d'effectuer des exercices peut être fabriqué à partir d'un ressort provenant d'un extenseur pour enfants ou de tout autre système possible, mais pratique, de fixation de la tête. Ainsi, par exemple, au lieu d'un ressort, vous pouvez prendre un bandage en caoutchouc (pas un bandage élastique). Il peut être acheté en pharmacie. Nous plions le bandage d'abord en deux, puis en quatre. Nous attachons ses extrémités d'un côté avec de la ficelle. On obtient une sorte d'anneau en caoutchouc à deux couches. Nous fixons l'extrémité attachée au mur à hauteur des yeux. On serre la tête au niveau du front avec l'autre extrémité. Pendant les exercices, nous sommes assis de manière stable.
Nous effectuons trois séries d'exercices à des intervalles de 1 à 3 minutes. Nous sélectionnons la force de tension du ressort et le nombre de mouvements de tête (oscillations) de manière à ce qu'il n'y ait pas assez de force pour la quatrième approche. Nous faisons cela pendant plusieurs semaines, en augmentant progressivement la charge conformément à cette règle.
Par exemple, vous effectuez dix oscillations de la tête, vous avez réalisé trois approches, mais à la quatrième approche vous ne pouvez effectuer que cinq oscillations au lieu de dix ; vous n’avez pas la force d’en faire plus. Cela signifie que vous effectuez ce volume pendant plusieurs semaines, mais dès que vous pouvez terminer la quatrième approche, vous pouvez augmenter la charge et faire plus d'oscillations en une seule approche.
Si le nombre de mouvements de tête lors d'une approche quadruple a atteint 25, il est alors nécessaire d'ajouter un ressort ou une boucle dans l'élastique, car de plus, ce n'est pas la force musculaire qui augmente, mais leur endurance. Et on sélectionne le nombre de mouvements de tête selon la règle décrite ci-dessus. Lorsque vous effectuez des mouvements de tête dans différentes directions, la charge peut être différente.
Vous devez toujours vous assurer que le ressort est tendu pendant l'exercice et ne s'affaisse pas lors du mouvement inverse.
Le rythme des exercices doit être lent et fluide. Le cou et la tête doivent bouger comme une seule unité. L’axe des mouvements de la tête doit passer par la transition cou-épaule. Le spécialiste choisit une méthode de traitement de l'instabilité cervicale en fonction de son type. L'instabilité post-traumatique sévère avec subluxation vertébrale nécessite une combinaison d'interventions, permettant de bénéficier des avantages de différentes approches.
Source : « vashaspina.ru ; mz-clinique.ru; ruback.ru; ostéocure.ru; pozvonok.ru; startinet12.ru; medbudkiev.ua;"
megan92 () il y a 2 semaines
Dites-moi, comment gère-t-on les douleurs articulaires ? Mes genoux me font terriblement mal ((je prends des analgésiques, mais je comprends que je combats l'effet, pas la cause...
Daria () il y a 2 semaines
J'ai lutté contre mes articulations douloureuses pendant plusieurs années jusqu'à ce que je lise cet article d'un médecin chinois. Et j’ai oublié depuis longtemps les articulations « incurables ». Alors ça va
megan92 () il y a 13 jours
Daria () il y a 12 jours
megan92, c'est ce que j'ai écrit dans mon premier commentaire) je vais le dupliquer juste au cas où - lien vers l'article du professeur.
Sonyail y a 10 jours
N'est-ce pas une arnaque ? Pourquoi vendent-ils sur Internet ?
julek26 (Tver) il y a 10 jours
Sonya, dans quel pays habites-tu ?.. Ils le vendent sur Internet parce que les magasins et les pharmacies facturent une majoration brutale. De plus, le paiement s'effectue uniquement après réception, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord regardé, vérifié et ensuite seulement payé. Et maintenant, ils vendent de tout sur Internet, des vêtements aux téléviseurs et aux meubles.
Réponse de l'éditeur il y a 10 jours
Sonya, bonjour. Ce médicament destiné au traitement des articulations n'est en effet pas vendu dans les chaînes de pharmacies afin d'éviter des prix gonflés. Actuellement, vous ne pouvez commander qu'à partir de Site officiel. Être en bonne santé!
Sonyail y a 10 jours
Je m'excuse, je n'ai pas remarqué les informations sur le paiement à la livraison au début. Alors tout va bien si le paiement est effectué à réception. Merci!!
Margo (Oulianovsk) il y a 8 jours
Quelqu'un a-t-il essayé des méthodes traditionnelles de traitement des articulations ? Grand-mère ne fait pas confiance aux pilules, la pauvre souffre...
Andreï il y a une semaine
Quels que soient les remèdes populaires que j’ai essayés, rien n’y fait...
EkaterinaIl y a une semaine
J’ai essayé de boire une décoction de feuilles de laurier, ça n’a rien donné, je me suis juste ruiné l’estomac !! Je ne crois plus à ces méthodes folkloriques...
Marieil y a 5 jours
J'ai récemment regardé une émission sur Channel One, il s'agissait aussi de ça Programme fédéral de lutte contre les maladies articulaires a parlé. Il est également dirigé par un célèbre professeur chinois. Ils disent avoir trouvé un moyen de guérir définitivement les articulations et le dos, et l'État finance entièrement le traitement de chaque patient.
Les sept vertèbres de la colonne cervicale sont à la fois stables et très mobiles. Ils assurent des mouvements de tête fluides. Les parents entendent souvent le diagnostic d'instabilité de la colonne cervicale chez les enfants. Cela indique la présence de problèmes au niveau de l’appareil ligamentaire ou la présence d’une blessure à la naissance à la colonne vertébrale de l’enfant.
L'instabilité de la colonne cervicale provoque des maux de tête, une diminution des résultats scolaires et le nouveau-né pleure et dort souvent mal. Avec de tels problèmes, les parents se tournent vers un neurologue ou un pédiatre. Pour un traitement approprié, il est important de déterminer le type de trouble. Il existe quatre principaux types d’instabilité :
- Dégénératif (conséquence de processus pathologiques);
- Dysplasique (anomalie des tissus et des articulations) ;
- Instabilité après une blessure ;
- Instabilité après la chirurgie.
Certains types d'instabilité accompagnent un enfant dès la naissance, tandis que d'autres surviennent tout au long de la vie à la suite d'une maladie ou d'une blessure grave.
- Lire aussi : .
Causes
La cause de l'instabilité des vertèbres cervicales est dans la plupart des cas un traumatisme à la naissance. Il est obtenu à la suite d'un déroulement incorrect du processus de naissance. La cause la plus fréquente de perturbations est un travail rapide. Pendant la courte période de la phase active du travail, l'enfant n'a pas le temps de se préparer à l'accouchement et se blesse au cou.
- Lire aussi : .
Un travail prolongé entraîne également un traumatisme. À la suite de nombreuses heures de pression exercée sur le cou de l’enfant, les vertèbres sont endommagées et les tissus environnants gonflent. Un résultat similaire est obtenu grâce au cordon ombilical enlaçant le cou du fœtus.
Les causes de l'instabilité dégénérative sont des processus destructeurs qui apparaissent à la suite d'une maladie (arthrite, ostéochondrose).
De plus, les problèmes de la colonne cervicale résultant d'un traumatisme et d'une intervention chirurgicale ne sont pas rares.
- Assurez-vous de lire :
Symptômes
Le tableau clinique de la maladie n’apparaît pas immédiatement. Souvent, les symptômes d'un traumatisme commencent à gêner un enfant à l'âge de trois ans. A cet âge, l’activité de l’enfant augmente. Ce n'est plus un bébé. Dans le même temps, les muscles du cou se développent et les ligaments cervicaux s'affaiblissent.
Cette position affecte les artères d’approvisionnement en sang, qui sont comprimées et n’alimentent pas le cerveau en sang. Le cerveau souffre d'un manque d'oxygène, l'enfant développe des plaintes : maux de tête constants, vertiges, distraction, fatigue, irritabilité. Avec de tels symptômes, vous devez contacter un neurologue, il déterminera si l'enfant présente une instabilité de la colonne cervicale.
- Lire aussi : .
Parfois, le trouble se manifeste immédiatement après la naissance. Chez un nourrisson, on observe une faiblesse des muscles des membres supérieurs, et un torticolis neurogène peut être détecté. Avec une consultation rapide avec un médecin, ces conditions peuvent être facilement corrigées.
Étant donné que le cerveau n'est pas suffisamment alimenté en oxygène, cela conduit au fait que l'enfant ne parle pas pendant longtemps. Un traitement opportun stimule un saut dans le développement de la parole.

- Lire aussi :
Diagnostique
Un neurologue s'occupe de ce problème. Il réalise un diagnostic en deux étapes. Tout d'abord, une anamnèse est réalisée et un examen du petit patient est effectué. Vient ensuite un diagnostic instrumental (rayons X, échographie).
Inspection préliminaire
Un examen visuel permet déjà de poser un diagnostic préliminaire. Le patient subit des changements dans sa vision : la fissure palpébrale se rétrécit, le globe oculaire lui-même peut s'enfoncer légèrement et la pupille se rétrécit. La combinaison de ces symptômes indique une atteinte des nerfs innervant l'œil.
Malgré sa rareté, l'instabilité de la colonne cervicale est un problème plutôt douloureux pour la société. Cela est dû au fait que son élimination est très difficile. Dans la plupart des cas, une personne malade est laissée seule avec une telle pathologie, notamment lorsqu'elle décide des questions de tactique de traitement. Après tout, aucun spécialiste ne peut garantir le succès des activités de santé à venir. Par conséquent, avant de prendre une décision lors du choix d'une méthode de traitement, il est si important de se familiariser le plus possible avec l'efficacité et les conséquences de chacune d'entre elles.
Première étape : comprendre l’essence du problème et l’identifier
Normalement, la mobilité des segments cervicaux de la colonne vertébrale est très élevée. Elle est provoquée par la somme des petits volumes de déplacement de chaque vertèbre les unes par rapport aux autres. Si les vertèbres voisines violent les limites admissibles de position mutuelle, cela n'augmente pas l'activité motrice du cou et de la tête, mais la réduit. La violation de la stabilité de la colonne vertébrale dans la région cervicale n'est rien de plus que son incapacité à effectuer des mouvements habituels et parfois vitaux. Cela est dû aux luxations, subluxations et déplacements des vertèbres provoqués par la défaillance de l'appareil musculo-ligamentaire et articulaire-disque, conçu pour assurer une mobilité et une stabilité normales des vertèbres cervicales. Dans ce cas, des symptômes tels qu'une douleur intense au cou, une déformation avec une mobilité réduite de la tête et du cou apparaissent. Le critère le plus important pour établir un diagnostic est le caractère passager de ces symptômes. Ils surviennent soudainement lorsque les éléments structurels de la colonne cervicale surmontent un certain type de charge.
Le diagnostic correct n'est pas toujours facile à établir, ce qui provoque l'échec du traitement. Cela est dû à l’existence de formes cachées d’instabilité vertébrale dans la région cervicale. Ils peuvent évoluer de manière atypique, acquérant un masque de diverses maladies (syndrome de l'artère vertébrale, myélopathie, dyscalgie, etc.). Dans ce cas, des symptômes non spécifiques apparaissent : maux de tête, vertiges, troubles de la coordination des mouvements, tension des muscles cervicaux, engourdissement du dos. de la tête et du cou. Même les méthodes de diagnostic instrumentales ne sont pas toujours suffisamment informatives. Par conséquent, le diagnostic doit être déterminé en tenant compte des moindres détails et subtilités que le patient doit porter à l'attention du médecin.

Les radiographies de la colonne cervicale dans différentes positions constituent la principale méthode de diagnostic de son instabilité.
Deuxième étape : déterminer le type de trouble de la stabilité et les tactiques de traitement
En ce qui concerne le choix des tactiques de traitement, l’instabilité de la colonne cervicale peut être envisagée sous différents angles :
- Instabilité sous forme de mobilité pathologique (excessive) périodique des vertèbres, qui est éliminée indépendamment après la cessation de l'action du facteur provoquant. Il n'y a pas de changements structurels ou de déformations prononcés de la colonne vertébrale. Il n'y a que des douleurs dans la région du cou, d'intensité variable. Chez ces patients, on observe un affaiblissement des structures des tissus durs et mous (ligaments, muscles, cartilage articulaire et disques). Les raisons de leur apparition doivent être clarifiées et le traitement vise à éliminer les facteurs provoquants et à renforcer les éléments fragilisés (exercices, massages).
- Instabilité de la colonne cervicale sous la forme d'une violation des relations anatomiques normales entre les vertèbres, qui ne peut être éliminée par elle-même. Dans ce cas, un syndrome douloureux prononcé survient en association avec une déformation, une luxation, une subluxation des vertèbres visibles lors de l'examen, des radiographies ou des tomographies. Le fait même qu’ils ne soient pas éliminés d’eux-mêmes indique de profonds changements structurels dans le segment rachidien. Par conséquent, le traitement doit viser à corriger les relations anatomiques perturbées entre les vertèbres et à prévenir leur réapparition.
- Instabilité de la colonne cervicale, persistante. Dans ce cas, il existe une courbure locale ou générale de l'axe vertébral. Elle s'intensifie pendant l'exercice et s'accompagne de légères douleurs. Surtout, ces troubles de la stabilité se traduisent par une forte limitation de la mobilité de la tête et du cou. Ces patients nécessitent des méthodes de correction manuelles ou chirurgicales énergiques.
- Une combinaison de tout type d'instabilité de la colonne cervicale avec ostéochondrose et hernie discale intervertébrale. Ces patients nécessitent une approche thérapeutique différenciée avec détermination de la maladie dominante. Pour les hernies intervertébrales volumineuses, quel que soit le type d'instabilité, un traitement chirurgical est recommandé. Dans tous les autres cas, le choix du traitement doit dépendre du type d’instabilité.
Important à retenir ! Moins l'instabilité de la colonne cervicale existe, plus elle se manifeste par une douleur aiguë et une déformation minime. L'existence à long terme de cet état pathologique présente les symptômes inverses !
Troisième étape : mise en œuvre stricte de tous les points du programme de traitement
Le traitement de l'instabilité vertébrale dans la région cervicale est représenté par les méthodes suivantes :
- immobilisation des vertèbres à l'aide d'un collier spécial ;
- maintenir un régime moteur doux;
- régime équilibré;
- traitement médical;
- effectuer des blocages de novocaïne ;
- massage et thérapie manuelle;
- exercices de renforcement et physiothérapie complète;
- procédures physiothérapeutiques;
- chirurgie.
Immobilisation du cou
Obtenu en utilisant des colliers de conception dure ou souple. Le choix du produit est fait par un spécialiste en tenant compte du type d'instabilité. Le but de l’immobilisation est de renforcer davantage le segment rachidien affaibli. De cette manière, la stabilité fonctionnelle est obtenue. Un collier dur limite davantage les mouvements du cou qu’un collier souple. Il est utilisé pour une durée limitée dans les formes sévères d'instabilité et en période postopératoire.

L'utilisation d'un collier de fixation est un des points clés dans le traitement des troubles de la stabilité vertébrale
Conformité au mode moteur
Les mouvements de la colonne cervicale doivent être limités. Les virages et inclinaisons brusques de la tête, les charges axiales sur le cou, qui entraînent des douleurs et un déplacement des vertèbres, sont exclus. Les patients doivent s'en souvenir, en particulier au début de la période suivant l'obtention d'une dynamique positive pendant le traitement. En revanche, l'exclusion complète de l'activité motrice pendant une longue période conduit à une atrophie de l'appareil musculo-ligamentaire et ostéo-articulaire de la colonne vertébrale. Les mouvements doivent donc être comparables aux capacités réelles de la colonne vertébrale.
Régime équilibré
Un des éléments importants du programme de traitement. Dans de nombreux cas, la cause de l'instabilité est des processus dégénératifs des os et du tissu conjonctif dus à un apport insuffisant en nutriments (ostéoporose, ostéochondrose, dystrophie musculaire, etc.). Par conséquent, l'alimentation des patients comprend des aliments contenant de fortes concentrations de calcium et d'autres microéléments, vitamines, protéines (légumes, fruits, noix, baies, produits laitiers, plats de viande, œufs).
Thérapie médicamenteuse
Le traitement médicamenteux de l'instabilité de la colonne cervicale est purement symptomatique. Les médicaments utilisés du groupe des analgésiques et des anti-inflammatoires (naklofen, ketanov, analgin, movalis, etc.) n'ont qu'un effet temporaire. Ils sont indiqués en présence de douleurs persistantes. En cas de spasmes musculaires dans le cou, des relaxants musculaires (mydocalm, sirdalud) sont utilisés. De nombreux patients sont indiqués pour une utilisation à long terme de chondroprotecteurs - médicaments pour renforcer les articulations intervertébrales (structum, teraflex, complexe de chondroïtine, etc.)
Blocages de la novocaïne
L'injection locale d'anesthésiques locaux (longocaïne, novocaïne, lidocaïne) dans les points douloureux du cou en cas d'instabilité vertébrale est indiquée dans de rares cas. L'indication peut être une douleur intense ou des spasmes musculaires qui ne peuvent être soulagés par la prise d'analgésiques. Pour l'ostéochondrose et les déformations de la colonne vertébrale, des blocages sont utilisés, notamment un anesthésique avec un anti-inflammatoire stéroïdien (kenalog, hydrocortisone, diprospan).
Massage et thérapie manuelle
Certaines des méthodes clés pour traiter l’instabilité. Grâce au massage, les muscles et les ligaments de la colonne vertébrale sont renforcés. Les techniques manuelles permettent d’éliminer les subluxations aiguës des vertèbres cervicales et de soulager les spasmes musculaires.
Important à retenir ! L'instabilité des vertèbres cervicales nécessite un traitement à long terme. Dans la plupart des cas, sa base est une activité physique appropriée, une thérapie par l'exercice, un massage et une physiothérapie. Ce n'est qu'en renforçant les structures paravertébrales musculaires et ligamentaires affaiblies que la stabilité vertébrale peut être créée !
Physiothérapie
Il est préférable de sélectionner les exercices du complexe de thérapie par l'exercice avec un spécialiste. Le grand principe à respecter est une augmentation progressive du volume et de la force des mouvements effectués. Les exercices sont simples et peuvent être effectués plusieurs fois par jour. Si des résultats positifs sont obtenus, vous pouvez les réaliser à l'aide d'appareils supplémentaires (bandage en caoutchouc). Les exercices peuvent ressembler à ceci :
- plier la tête avec une pression simultanée sur le front avec les deux mains, créant une réaction ;
- extension de la tête avec contre-attaque simultanée des mains sur la région occipitale ;
- inclinaisons latérales de la tête avec contre-attaque des mains sur la zone temporale correspondante ;
- tours de tête en rotation avec opposition avec les mains alternativement dans les deux sens ;
- position de départ debout avec légère rétraction et extension simultanée du cou vers l'arrière. Dans cette position, en pliant le cou, le menton est tiré vers le sternum (leur contact direct n'est pas nécessaire).

Des exercices correctement sélectionnés sont la clé d'un traitement réussi de l'instabilité des vertèbres cervicales
Les exercices sont effectués 8 à 10 fois chacun avec un retard de tension musculaire de 5 à 7 secondes. Si nécessaire, leur nombre et leur temps d'exécution peuvent augmenter ou diminuer.
Physiothérapie
C'est un complément à la thérapie par l'exercice et au massage. Des méthodes d'électrophorèse, de myostimulation, de thérapie magnétique et de procédures à l'eau sont utilisées. En augmentant le flux sanguin dans les muscles, ils sont renforcés, les spasmes et la douleur sont réduits.
Traitement chirurgical
Il est utilisé soit en présence de déformation sévère avec instabilité vertébrale persistante, soit en l'absence d'effet des mesures conservatrices. Elle consiste à créer artificiellement une stabilité en fixant les vertèbres adjacentes avec une plaque métallique (fusion vertébrale).
Le traitement des troubles de la stabilité de la colonne cervicale est un processus long, séquentiel et en plusieurs étapes. Plus il est démarré à temps, meilleurs sont ses résultats.
L'instabilité de la colonne cervicale est une condition dans laquelle le cou ne peut pas maintenir sa position de manière indépendante. La condition n'est pas pathologique, mais elle entraîne des dommages neurologiques chez une personne et peut provoquer des syndromes douloureux dangereux.
La colonne vertébrale contient 33 à 35 vertèbres qui constituent la colonne vertébrale. La région cervicale contient 7 vertèbres, numérotées à partir de la première vertèbre, qui relient la colonne vertébrale au crâne. La première vertèbre s'appelle l'atlas, la seconde s'appelle l'axiale, toutes deux ont une structure atypique. Entre les vertèbres se trouvent des ligaments et des disques intervertébraux qui constituent l'appareil ligamentaire de la colonne vertébrale.
Les vertèbres sont entourées d’une couche musculaire qui les soutient en position verticale et soutient les nerfs et les artères passant à proximité. Toutes les vertèbres forment la colonne vertébrale, qui contient la moelle épinière, qui remplit une fonction réflexe et conductrice. Il transmet les impulsions des muscles squelettiques au cerveau et au dos, et est également responsable de manière indépendante du fonctionnement des organes internes - il effectue la régulation autonome.
Qu'est-ce que l'instabilité
Il existe deux termes : instabilité du cou et hypermobilité d'une vertèbre individuelle. L'instabilité des vertèbres cervicales est un processus non pathologique dans lequel les vertèbres sont incapables de conserver leur forme sans douleur sous la pression de la tête. L'intensité de la douleur correspond à l'ampleur de la charge et au degré de développement de l'instabilité de la colonne cervicale.
L'hypermobilité est un symptôme diagnostique qui signifie une mobilité accrue des surfaces articulaires de la vertèbre, ce qui conduit à son tour au développement d'une instabilité. L’hypermobilité ne conduit pas toujours à l’instabilité, et l’instabilité n’est pas toujours causée par l’hypermobilité.
Développement de symptômes
L'instabilité de la colonne cervicale est divisée en les types suivants :
- Post-traumatique;
- Dysplasique ;
- Dégénératif ;
- Postopératoire.

- Lire aussi : .
L'instabilité post-traumatique résulte de l'impact d'une force importante sur la colonne vertébrale. En règle générale, les blessures surviennent lors d'accidents de la route ou d'activités intenses lors de sports associés à des taux de blessures élevés. L'impact entraîne la destruction des articulations normales de la colonne vertébrale et l'expansion des plans ligamentaires du disque.
Avec une seule blessure, une telle violation se fera toujours connaître et se manifestera par des déplacements répétés. Le plan articulaire perd sa rigidité et ne peut pas conserver sa forme de manière indépendante sous charge.
La dysplasie fait référence à des troubles de la formation osseuse. La maladie se manifeste le plus souvent dans la période juvénile, lors de l'ostéogenèse la plus active. Cette instabilité des vertèbres cervicales est causée par des processus perturbés dans la formation de la structure en nid d'abeille des articulations intervertébrales.
L'instabilité dégénérative est détectée dans le diagnostic des modifications de l'ostéochondrose et est une conséquence de la dégénérescence des surfaces articulaires. L'ostéochondrose est essentiellement la croissance du tissu cartilagineux et son remplacement partiel par du cartilage. Les surfaces des vertèbres s'élargissent, les ligaments peuvent commencer à s'attacher au cartilage et perdre leur stabilité.
- Lire aussi : ?
Parfois, le processus peut aller dans la direction opposée, avec la croissance du tissu osseux, et un processus d'immobilisation de la colonne cervicale sera observé - les vertèbres n'auront pas assez d'espace pour bouger, ce qui provoquera des douleurs et des raideurs. La partie fonctionnelle de la colonne vertébrale est affectée et des problèmes neurologiques seront visibles.
La douleur postopératoire peut se développer à la suite d'interventions chirurgicales radicales, par exemple l'ablation d'un segment de l'arc vertébral pour libérer le nerf rachidien de la pression. Il existe une violation du complexe de soutien de la colonne vertébrale, ce qui entraîne une mobilité excessive du cou. Naturellement, pour la formation d'une mobilité postopératoire, des conditions préalables sont nécessaires, par exemple la présence de blessures et de maladies des vertèbres.
Qu’est-ce que l’instabilité de la colonne cervicale ? Nous discuterons des causes, du diagnostic et des méthodes de traitement dans l'article du Dr Nikitin S.S., neurologue avec 10 ans d'expérience.
Définition de la maladie. Causes de la maladie
Le système musculo-squelettique contient des articulations naturellement immobiles, c’est-à-dire stables. Cette propriété peut être perdue, alors les joints et les articulations deviennent « instables ». Par exemple, la symphyse pubienne ou les articulations sacro-iliaques peuvent perdre leur immobilité après l'accouchement ou en raison de lésions de cette zone anatomique. Les segments de la colonne vertébrale font également référence à des formations qui peuvent perdre leur immobilité, c'est ce qu'on appelle dans la pratique médicale le terme "instabilité". Il est à noter que chez les enfants de moins de 10 ans, l'instabilité est considérée comme normale, puisque les structures responsables de la stabilité de la colonne vertébrale sont dans une phase de croissance active à leur âge.
La colonne vertébrale adulte se compose de 33 ou 34 vertèbres (il existe une variante normale avec six vertèbres lombaires), ce qui représente 25 ou 26 segments de mouvement.
Segment vertébral est l'unité anatomique et fonctionnelle de la colonne vertébrale. Anatomiquement, le segment est constitué du disque intervertébral, de la moitié inférieure de la vertèbre sus-jacente, de la moitié supérieure de la vertèbre sous-jacente, des ligaments longitudinaux antérieur et postérieur, du ligament jaune, des articulations intervertébrales, ainsi que de tous les tissus mous et nerveux. situé à ce niveau.

Les structures suivantes (classées par ordre décroissant) sont responsables de la stabilité du segment : disque intervertébral, ligaments et facettes articulaires, corps vertébraux.
En conséquence, les raisons du développement de l’instabilité affectent précisément les structures répertoriées.
Les raisons sont:
- blessures à la naissance, blessures sportives, blessures de la route, etc. (ligaments, disques et corps vertébraux) ;
- dégénérescence discale (protrusion et hernie);
- interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale (disques, ligaments et facettes) ;
- anomalies du développement de la colonne vertébrale et de ses structures (toute structure).
Symptômes d'instabilité de la colonne cervicale
Le déplacement du disque en tant que manifestation de l'instabilité du segment ne donne pas toujours lieu à des symptômes ou à des plaintes. L’instabilité qui provoque des symptômes spécifiques est dite « cliniquement significative ».
1. Douleur. Cela inclut également les maux de tête. C'est le symptôme le plus courant et il apparaît périodiquement. Apparaît souvent après une activité physique, souvent déjà pendant l'exercice. Cela se produit également après avoir dormi dans une position inconfortable, après une position assise prolongée avec la tête inclinée vers l'avant et vers le bas, ainsi que lorsque vous penchez et redressez la tête. Lorsque vous tournez la tête sur les côtés et qu'il y a une instabilité, un engourdissement des membres et des vertiges peuvent survenir. Il apparaît également souvent lors de l'exécution d'exercices mal sélectionnés qui ne conviennent pas au patient, ou lors de leur exécution incorrecte.
2. Symptômes musculaires. Sensation constante de tension dans les muscles du cou, fatigue. Le stress quotidien provoque des tensions, des douleurs et nécessite du repos.
3. Symptômes neurologiques focaux. Dans ses manifestations, il ressemble à des symptômes radiculaires - douleurs lancinantes, engourdissement et faiblesse des membres supérieurs. A la palpation des points paravertébraux, une douleur est détectée.
4. Syndrome d'hypertension. Cela se manifeste par une augmentation de la pression intracrânienne, qui à son tour augmente les maux de tête et les étourdissements. Elle se manifeste également par une augmentation de la pression artérielle. De nombreux auteurs estiment que ces deux manifestations entraînent le développement d'attaques de panique.
5. Troubles vestibulo-cochléaires et oculo-cochléaires. Ceux-ci incluent les acouphènes et les étourdissements, la vision floue. Les patients se tournent souvent vers des ophtalmologistes ou des oto-rhino-laryngologistes, mais l'examen des organes de la vision et de l'audition ne révèle aucun trouble significatif. Les symptômes sont causés par une compression de l'artère vertébrale, ce qui est possible en cas de modifications de la hauteur des disques intervertébraux et de spondylarthrose, ou d'arthrose des articulations intervertébrales.
6. Déformation de la colonne vertébrale. La douleur est soulagée en gardant le cou fixe, souvent en se penchant sur le côté. Un séjour prolongé dans cette position modifie la forme du cou, provoquant la formation ou le renforcement d'une cyphose (courbure de la colonne vertébrale en forme de bosse). À propos, cette même croissance que beaucoup appellent « accumulation de graisse » peut être un symptôme d’instabilité.
7. Troubles du sommeil. Se développe lorsque la douleur devient chronique. Un sentiment constant d'inconfort, l'incapacité de trouver une position confortable pour dormir, une posture forcée lors des activités quotidiennes - tout cela contribue au névrosisme et, par conséquent, des troubles du sommeil se développent.
Pathogenèse de l'instabilité de la colonne cervicale
La question de l'étude de la pathogenèse de l'instabilité des segments de la colonne cervicale a été étudiée par Krismer et ses élèves. Ils ont prouvé expérimentalement que les fibres de l'anneau fibreux du disque intervertébral limitent encore plus la rotation des vertèbres que les articulations intervertébrales et facettaires. Ils ont également énuméré diverses définitions de l'instabilité, la décrivant comme constituée des anomalies mécaniques suivantes :
- mouvement excessif vers l'avant dans la direction dorsolatérale, résultat de la destruction du disque et de la perturbation de sa structure ;
- synkinésie pathologique (ou double mouvement), qui se développe comme étape suivante lorsque le disque est incapable de remplir sa fonction stabilisatrice et de transférer le centre de gravité vers les vertèbres + disques + ligaments adjacents ;
- une augmentation de la zone neutre, qui est le résultat de l’étape précédente. Tout mouvement est pathologique et touche de nombreuses vertèbres.
- centre de rotation pathologique (mouvement autour de l'axe longitudinal). Dans une situation de destruction progressive du disque, qui s'observe avec les saillies discales et les hernies, les articulations intervertébrales assument la fonction de limitation de la rotation. Pour ces articulations, cette fonction est excessive et de l'arthrose s'y développe. C’est ainsi que progresse l’instabilité dégénérative (ou discogène). Le résultat est le développement d’une spondylarthrose (maladie dégénérative des articulations intervertébrales).

Le développement d’autres types d’instabilité est actuellement controversé. Cependant, compte tenu de la pathogenèse de l'instabilité postopératoire, de nombreux auteurs s'accordent sur le fait que l'opération elle-même est un facteur qui augmente l'instabilité. Après tout, il est difficile d'imaginer une situation dans laquelle il serait nécessaire de supprimer un disque sain.
Classification et stades de développement de l'instabilité de la colonne cervicale
Il existe trois stades d'instabilité :
- Première étape. Se développe entre 2 et 20 ans. A ce stade, des douleurs aiguës localisées près de la colonne vertébrale ou des douleurs radiculaires peuvent être gênantes. Radiologiquement, il n'est souvent pas détecté.
- Deuxième étape. Se développe entre 20 et 60 ans. À ce stade, des douleurs récurrentes fréquentes qui surviennent au niveau des articulations intervertébrales et/ou des ligaments sont inquiétantes. Radiologiquement, parallèlement à des signes d'instabilité, une spondylarthrose à des degrés divers et une diminution de la hauteur des disques sont déterminées.
- Troisième étape. Se développe après 60 ans. À ce stade, la mobilité des articulations intervertébrales est considérablement réduite, ce qui contribue à stabiliser la colonne vertébrale. Cela entraîne une diminution de la fréquence et de l’intensité de la douleur. Il ne faut pas oublier que le syndrome douloureux peut être assez intense avec le développement de maladies systémiques réactives.
Complications de l'instabilité de la colonne cervicale
Les complications les plus courantes sont la compression de l’artère vertébrale (ou syndrome de l’artère vertébrale) et une douleur intense.
Syndrome de l'artère vertébrale se développe dans deux situations :
- lorsque l'artère est comprimée dans les espaces intervertébraux par les ostéophytes lors du développement de la spondylarthrose ;
- au niveau extravertébral avec le muscle oblique inférieur.
La compression de l'artère entraîne le développement de symptômes cérébraux et vestibulaires sous forme de maux de tête, de vertiges et d'effets sonores. En règle générale, en cas de compression aiguë, une crise aiguë se développe sous la forme de vertiges sévères accompagnés de nausées et de vomissements et d'une altération de la fonction vestibulaire. Avec une compression prolongée, un trouble chronique de la circulation cérébrale et vertébrale se développe.
Un trouble de la fonction motrice et de la sensibilité se développe lorsque les muscles et les nerfs situés dans les espaces intermusculaires sont comprimés. Caractérisé par une fonction musculaire limitée et un engourdissement dans la zone d'innervation nerveuse.
Les complications les plus graves de l'instabilité comprennent sténose vertébrale Et compression de la moelle épinière.

Les deux troubles sont dangereux en raison de troubles circulatoires, dont le signe est une lésion des fibres nerveuses conductrices, qui se manifeste cliniquement par une parésie (paralysie) des membres supérieurs et inférieurs, un dysfonctionnement des organes pelviens et une sensibilité cutanée.
Pour être honnête, il convient de noter que de telles complications surviennent extrêmement rarement avec le niveau actuel de diagnostic et de traitement.
Diagnostic de l'instabilité de la colonne cervicale
Recueil des plaintes et antécédents médicaux fait partie intégrante de l’examen du patient. Dans ce cas, le médecin prête attention aux caractéristiques et aux descriptions du syndrome douloureux, à sa localisation, aux symptômes qui l'accompagnent, tels que maux de tête, vertiges, instabilité lors de la marche, etc.
Examen neurologique. Lors de l'examen, le neurologue détermine la douleur des points paravertébraux du rachis cervical, les tensions et douleurs musculaires, les zones de douleur réfléchie et irradiante, les troubles de la sensibilité, l'amplitude des mouvements des muscles et des articulations, l'amplitude des mouvements du rachis cervical.
Examen aux rayons X. Dans les projections standards, les signes d’instabilité sont rarement constatés. Il est obligatoire de réaliser des études radiographiques fonctionnelles. C’est la technique la plus importante, qui a malheureusement été négligée ces derniers temps. Une fois effectué, le déplacement antéropostérieur du corps d'une vertèbre par rapport à une autre vertèbre est déterminé. L'épaisseur généralement acceptée de cette taille est de 4 mm. Une raison possible pour laquelle cette technique est de plus en plus ignorée est le fait qu’il n’existe aucune corrélation entre la gravité des symptômes et l’ampleur du déplacement.

Tomodensitométrie utilisé pour étudier l’ensemble de la colonne cervicale ou une vertèbre. Un scanner de la colonne cervicale peut déterminer la largeur du canal rachidien et le degré de spondylarthrose.
Imagerie par résonance magnétique utilisé pour examiner l’ensemble du rachis cervical, permettant un examen particulièrement approfondi des disques intervertébraux.
Traitement de l'instabilité de la colonne cervicale
En cas d'instabilité, le traitement doit être complet. La prévention joue un rôle énorme.
Le traitement comprend plusieurs étapes.
Traitement médical:
- les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont destinés à soulager l'inflammation, à réduire et à guérir la douleur ;
- les relaxants musculaires aident à réduire les spasmes et le tonus musculaires, aident à réduire la compression des racines nerveuses ;
- Les vitamines B nourrissent le tissu nerveux, le restaurent et le protègent ;
- Des vitamines D et des suppléments de calcium sont prescrits aux patients souffrant d'ostéoporose.
Traitement physiothérapeutique.
C'est un moyen efficace de traiter la douleur, de soulager l'inflammation et de restaurer les tissus nerveux et musculaires. Le traitement physiothérapeutique permet également d'administrer une substance médicinale à la lésion à l'aide d'un courant électrique. Dans le traitement physiothérapeutique, les éléments suivants sont utilisés :
- techniques qui soulagent l'inflammation : électrophorèse, magnétothérapie, thérapie UHF ;
- techniques favorisant la régénération des tissus : thérapie au laser, fangothérapie.
Il s’agit d’une méthode permettant de soulager une douleur aiguë en délivrant une substance médicinale directement à sa source. Elle est réalisée par un neurologue dans un établissement médical (pas à domicile !) après une formation particulière. La substance médicamenteuse peut être une solution de novocaïne à 0,5 % ou une solution de lidocaïne à 2 %. Vous pouvez également ajouter des solutions de vitamines ou d'hormones. La composition de la substance administrée est choisie par le médecin en fonction des indications cliniques en l'absence de contre-indications aux médicaments administrés. Il convient de noter qu'un neurologue ne doit pas injecter la substance dans les articulations intervertébrales, cette procédure ne peut être réalisée que par des neurochirurgiens.

Immobilisation vertébrale.
C'est l'un des premiers remèdes en cas d'exacerbation. Elle est réalisée avec un collier spécial qui limite la mobilité. Il est prescrit uniquement par un médecin et est sélectionné strictement individuellement en fonction de la taille du cou. Il est recommandé que la sélection soit effectuée dans des salons orthopédiques spécialisés. Le mode de port d'un collier est également recommandé en fonction de la cause de l'exacerbation.

C'est un moyen de mobiliser les vertèbres. Il est interdit de jouer pendant la période aiguë de la blessure. Réalisé par un chiropracteur sur recommandation d'un neurologue après examen.
C’est l’un des moyens de prévention et de traitement les plus efficaces. Le cours est élaboré pour le patient en fonction de la cause de l'instabilité, ainsi que de l'état de la colonne vertébrale. Le but de la gymnastique est de renforcer les tissus musculaires (ligaments et muscles). Si la gymnastique est pratiquée après une blessure ou une intervention chirurgicale, elle est réalisée uniquement sous la supervision d'un neurologue ou d'un instructeur-méthodologiste dans la salle de thérapie par l'exercice. Après la formation, le cours s'effectue à domicile en toute autonomie.
Réflexologie, en particulier acupuncture.
C'est un moyen de soulager la douleur, de restaurer les tissus musculaires et nerveux, de traiter les symptômes associés : amélioration de la circulation sanguine, amélioration du sommeil. Elle est réalisée uniquement par un réflexologue à l'aide d'aiguilles spéciales.
Chirurgie.
C'est une pratique rare. Réalisé dans l'enfance en cas d'anomalies structurelles avérées. Dans la pratique adulte, la fusion vertébrale est plus souvent réalisée. Elle consiste à implanter une structure composée de plaques métalliques et d'éléments de fixation. Sa tâche est d'éviter une mobilité excessive de la colonne vertébrale. L'opération est utilisée après des blessures, des distomies et des laminectomies. Les deux derniers sont réalisés pour les hernies rachidiennes.
Prévision. La prévention
Bibliographie
- 1. Kremer Jürgen. Maladies des disques intervertébraux. Par. de l'anglais; sous général éd. prof. VIRGINIE. Shirokova. – M. : MEDpress-inform, 2013. – 472 p. : ill.
- 2. Travell et Simons. Douleur et dysfonctionnement myofascial : un guide des points déclencheurs. En 2 tomes. T.1. // Simons D.G., Travell J.G., Simons L.S. : Trans. de l'anglais – 2e éd., révisée et augmentée. – M. : Médecine, 2005. – 1192 p. : ill.
- 3. Levit K., Zahse J., Yanda V. Médecine manuelle. Par. avec lui. I.I. Skvortsova. – M. : Médecine, 1993. – 456 p. : ill.
- 4. Le Mumentaler Marco. Diagnostic différentiel en neurologie. Guide pour l'évaluation, la classification et le diagnostic différentiel des symptômes neurologiques / Marco Mumenthaler, Claudio Basseti, Christoph Detwiler ; voie avec lui. – 3e éd. – M. : MEDpress-inform, 2012. – 360 pp. : ill.
- 5. Popelyansky Ya.Yu. Neurologie orthopédique (vertébroneurologie) : un guide pour les médecins / Ya.Yu. Popelyanski. – 5e éd. – M. : MEDpress-inform, 2011. – 672 p. : ill.